Gwenaëlle Aubry publie La Folie Elisa aux Editions Mercure de France. Un récit captivant, un refuge de mots, une maison de feuilles pour explorer la Folie. – ENTRETIEN –

La Folie Elisa c’est le récit de quatre femmes, quatre artistes pour qui le fil s’est rompu. Pouvez-vous nous parler de ces femmes brisées par le monde qui les entoure ?
Ce sont des filles qui se sauvent, dans les deux sens du terme : prennent la fuite, et dans cette fuite cherchent leur salut. Le fil, elles le rompent elles-mêmes, elles quittent la scène, elles se retirent du jeu- y compris social. Emy Manifold, une rock star anglaise, décide de ne plus donner de concerts après le Bataclan, Irini Santoni, une sculptrice grecque, hantée par les corps qui s’échouent sur les plages, ne travaille plus que les barbelés et le Vantablack, une matière ultra-noire, Sarah Zygalski, une danseuse israélienne venue vivre à Berlin pour affronter ses fantômes, tombe et ne peut plus danser, Ariane Sile, un soir de dernière à l’Odéon, alors qu’elle joue enfin le rôle de sa vie (Ysé, dans le Partage de midi) se met à parler au public, fait tomber ce qu’au théâtre on appelle le « quatrième mur ». Le livre les saisit à ce point de chute, qui est aussi un point de rupture et de refus. Il fait entendre, à travers leur quatre voix, toutes adressées à L., l’écho diffracté d’une sidération collective, qui a aussi été la mienne à cette période dans laquelle il s’inscrit, 2015-2016. Comme ces quatre-là, j’ai eu le sentiment, tenace, troublant, d’être dépossédée de mes armes et de mes croyances- celle, par exemple, que formule Adorno quand il dit que l’art permet de renvoyer au monde la violence qu’il nous fait. Pour autant, je ne dirais pas qu’elles sont « brisées » : plutôt fissurées, très peu fortifiées, très peu barbelées. À la source de ce roman, il y avait cette envie : creuser le motif des « petites folles » (la formule est de Duras, à propos de Lol V. Stein) que j’avais commencé à explorer à travers la figure de Sylvia Plath dans Lazare mon amour, mais aussi dans des textes antérieurs (Ariane et Sarah sont des personnages récurrents, échappées l’une de mon premier roman, Le diable détacheur, l’autre de Partages, elles me sont revenues lestées d’une histoire qui était aussi une force de propulsion). Creuser le motif des « petites folles », c’est-à-dire interroger un rapport déréglé entre l’intérieur et l’extérieur, cette forme d’extrême porosité au monde, aux autres, qu’Évelyne Grossman décrit si bien dans son beau livre, Éloge de l’hypersensible. Ces filles en fuite sont aussi des filles sans frontières, no borders plus encore que border line. Elles font tomber en elles, autour d’elles, les murs qui partout ailleurs se dressent. « Écrire ne loge pas en soi-même », dit Kafka : Ariane, Emy, Sarah et Irini sont des délogées ; face à une époque qui ferme aussi bien les frontières que les identités, elles se refusent au régime de l’assignation et du « je suis ». Elles sont requises par l’Histoire, traversées par le monde, maximalement ouvertes au dehors : il y a là une forme de fragilité, c’est vrai, mais aussi une grande vitalité. Il faut être un grand vivant, une grande vivante, pour aller vers son point de ravage- et aussi, tout simplement, pour continuer à jouer : à danser, sculpter, chanter ou écrire. Ce qui m’intéresse, c’est ce sursaut vital, cette inversion de la fragilité, voire de l’impuissance, en puissance créatrice. Et la tension entre cette puissance et l’état mortifère du monde.
Votre roman se déroule au cœur d’une actualité terrible, celle des attentats. Plusieurs pages reprennent des titres ou des phrases journalistiques qui montrent une société qui se referme sur elle-même, qui s’étouffe. Etait-ce important de mêler références factuelles et confidences intimes ?
Les attentats, mais aussi le sort fait aux exilés, la mise en danger du droit d’asile, la montée de l’extrême droite. Il y avait là, en effet, un enjeu essentiel : comment s’emparer de l’hyper- contemporain d’une façon à la fois juste et pérenne ? Comment s’emparer de cette matière noire – cette « matière réfractaire», comme on dit en sculpture- sans la réduire ni la redoubler, comme le fait Irini avec son Vantablack. La littérature n’est pas là pour consoler, ni pour déplorer. Il fallait trouver une forme pour agencer cette matière, pour y faire jouer un peu de lumière. J’ai besoin, pour chaque nouveau roman, d’inventer une forme nouvelle, c’est l’unique façon de saisir un pan de réel demeuré jusque-là invisible, illisible. Ce livre-là se construit par chambres, quatre chambres claires où résonnent, sur le mode théâtral de l’adresse, les voix d’Emy, Irini, Ariane et Sarah, une chambre noire, une camera obscura, faite d’un montage d’extraits de la presse européenne entre janvier 2015 et janvier 2016. À travers ce montage, il s’agit d’inscrire la trace brute de ce qui a basculé cette année-là, pour en garder mémoire, mais aussi pour la réactiver. On s’habitue à tout, y compris à l’insupportable, à l’inacceptable- en témoigne cet étrange oxymore d’«état d’urgence », comme si l’urgence était un état dans lequel tranquillement s’installer. Retenir la trace de l’événement, la raviver, c’est aussi une façon de rappeler qu’un événement, c’est contingent, qu’il n’y a rien de nécessaire dans ce mouvement de bascule du monde, qu’on peut, qu’on doit, ne pas s’y habituer, s’y résigner.
Quant aux « confidences intimes », je ne crois pas qu’il s’agisse de ça. Emy, Ariane, Irini et Sarah ne se confient pas, ne s’épanchent pas : elles témoignent de puissances qui les traversent, et qui n’ont rien à voir avec la psychologie. Le ton du livre n’est pas celui du murmure, de la plainte, ni de la confession, sa scansion n’a rien d’élégiaque.
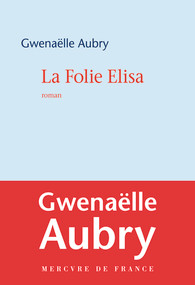 Maintenant, c’est vrai qu’il y a aussi, à la source de ce roman, un événement intime, une « petite affaire privée », comme dirait Deleuze : La Folie Elisa c’est, à l’origine, le vrai nom, d’une vraie maison, que j’aimais, et que j’ai perdue. Perdre une maison, c’est perdre un peu de mémoire, de passé, des murs et des sols intérieurs : mais je n’ai pas voulu « confier » ça, ni en faire un objet direct. Encore moins alors que le monde compte plus de 68 millions de réfugiés et de déplacés. En revanche, j’ai sauvé, à travers la construction du livre, l’architecture de cette maison. Et ce nom de «Folie Elisa» contenait mon projet, il suffisait de le déplier pour ouvrir le livre : «Folie», au sens architectural du terme, du latin folia, feuilles- tout livre est une maison des feuilles-, «Elisa», le palindrome d’asile. Il y avait là de quoi loger mes petites folles, mais aussi de quoi agencer une forme. J’ai fait travailler ce nom comme une contrainte formelle : se donner une contrainte, c’est ouvrir l’espace d’un jeu. Perec le savait, dont La Vie mode d’emploi voisine avec La Folie Elisa, comme La Maison des feuilles de Danielewski, comme l’hacienda et la maison mobile de Chtcheglov. Chacune des lettres de ce nom d’Elisa a déterminé le choix des prénoms des personnages, et en partie présidé à la récurrence d’Ariane et de Sarah, leurs patronymes font aussi varier le mot « feuilles », qui à son tour appelle un système d’échos avec Conrad ou Whitman, etc. Bref, j’ai joué, j’ai recommencé à jouer, puisque c’est là l’une des questions, l’une des inquiétudes qui traversent le roman : comment continuer à jouer, et à quoi ?
Maintenant, c’est vrai qu’il y a aussi, à la source de ce roman, un événement intime, une « petite affaire privée », comme dirait Deleuze : La Folie Elisa c’est, à l’origine, le vrai nom, d’une vraie maison, que j’aimais, et que j’ai perdue. Perdre une maison, c’est perdre un peu de mémoire, de passé, des murs et des sols intérieurs : mais je n’ai pas voulu « confier » ça, ni en faire un objet direct. Encore moins alors que le monde compte plus de 68 millions de réfugiés et de déplacés. En revanche, j’ai sauvé, à travers la construction du livre, l’architecture de cette maison. Et ce nom de «Folie Elisa» contenait mon projet, il suffisait de le déplier pour ouvrir le livre : «Folie», au sens architectural du terme, du latin folia, feuilles- tout livre est une maison des feuilles-, «Elisa», le palindrome d’asile. Il y avait là de quoi loger mes petites folles, mais aussi de quoi agencer une forme. J’ai fait travailler ce nom comme une contrainte formelle : se donner une contrainte, c’est ouvrir l’espace d’un jeu. Perec le savait, dont La Vie mode d’emploi voisine avec La Folie Elisa, comme La Maison des feuilles de Danielewski, comme l’hacienda et la maison mobile de Chtcheglov. Chacune des lettres de ce nom d’Elisa a déterminé le choix des prénoms des personnages, et en partie présidé à la récurrence d’Ariane et de Sarah, leurs patronymes font aussi varier le mot « feuilles », qui à son tour appelle un système d’échos avec Conrad ou Whitman, etc. Bref, j’ai joué, j’ai recommencé à jouer, puisque c’est là l’une des questions, l’une des inquiétudes qui traversent le roman : comment continuer à jouer, et à quoi ?
De nombreux points communs relient les héroïnes, leurs fêlures, leur fuite, leur impossibilité à lutter contre la violence mais aussi leur croyance en l’amour. Etes-vous d’accord si on qualifie ces femmes de grandes amoureuses ?
Oui, bien sûr. Leur porosité au monde, aux autres, fait de ces « petites folles » indissociablement des artistes et des amantes. Et de même, leur goût commun pour l’excès, cette façon qu’elles ont toutes de traquer les moments intensifs. Le livre interroge cette solidarité entre la puissance artistique et la puissance érotique. Comme Perséphone 2014, mon précédent roman, il fait résonner cette phrase de Bataille, dans L’amour d’un être mortel : «Il est vrai que la poussière satisfaite et les soucis dissociés du monde présent envahissent aussi les chambres : les chambres verrouillées n’en demeurent pas moins, dans le vide mental presque illimité, autant d’îlots où les figures de la vie se recomposent ». Les chambres claires de La Folie Elisa, où Irini, Emy, Ariane et Sarah recomposent les figures de leur vie, sont traversées par les réminiscences de chambres verrouillées, clandestines, amoureuses – et c’est d’ailleurs par le souvenir d’hommes aimés qu’elles communiquent, et par le graff bombé de ville en ville par l’un d’entre eux, SMA. La rencontre amoureuse, érotique, fait tomber les murs et les barrières, et en même temps, elle reconstruit un asile, un lieu où vivre enfin, et pleinement, une terre insulaire et souveraine. Maintenant, l’une des questions qui traversent le livre, c’est aussi : comment transformer cette puissance érotique en une puissance collective ? Comment l’orienter vers le dehors ? Comment déverrouiller la chambre des amants pour construire un refuge, un asile, une hacienda, où tous, fous et folles, exilés et damnés, auraient enfin leur place ?
Dans le cas d’Emy, Sarah, Irini et Ariane aucun art n’a réussi à être un refuge contre la barbarie. Ne pensez-vous pas cependant que l’art, dans sa forme la plus variée, peut être un rempart ou peut simplement aider à respirer dans un contexte politique difficile ?
C’est vraiment une question qui oriente le roman- la question de Hölderlin: « À quoi bon des poètes en temps de détresse ?», que je décline selon quatre pratiques qui me sont familières (la danse, le théâtre, la musique), ou non (la sculpture). À travers elles, j’interroge aussi l’écriture, mais l’idée était plutôt d’atteindre, par ces différents biais, quelque chose comme un sol commun, antérieur à la division des arts- et, en effet, d’en sonder l’assise, la solidité. On a quand même de sérieuses raisons de se la poser, cette question, non ? Vient peut-être un moment, un état du monde, où, autant que la chambre verrouillée des amants, il faut quitter la chambre à soi de l’écriture. En tout cas, le livre est né de ce doute, de cette inquiétude-là. Et pourtant je l’ai écrit, j’ai recommencé à jouer. Tout ce que peut faire la littérature, c’est construire de fragiles asiles, des maisons des feuilles, « punir les murs », comme disent les graffeurs, rouvrir des espaces intérieurs, raviver des possibles.
Gwenaëlle Aubry sera présente à la librairie Ombres Banches jeudi 11 Octobre dès 18h30.
Sylvie V.
Gwenaëlle Aubry, La Folie Elisa, Mercure de France, 144 p.
photo : Gwenaëlle Aubry © Francesca Mantovani
