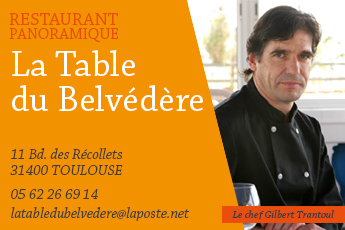C’est au coin du feu ou blotti sous un plaid anglais qu’il faut lire les « Lettres à Jean Voilier » que viennent de publier les éditions Gallimard. Dans ce beau recueil qui rassemble un choix de lettres inédites parmi les six cent cinquante expédiées par leur auteur entre 1937 et 1945, se consume sous nos yeux la passion éperdue d’un monumental poète vieillissant pour une apprentie romancière doublée d’une redoutable séductrice de plus de trente ans sa cadette. Banale histoire ? Pas vraiment, car l’homme emporté par la passion au crépuscule de sa vie n’est autre que l’immense Paul Valéry (1871-1945), le poète de « La Jeune Parque », du « Cimetière marin » et de « Charmes », le père de « Monsieur Teste », l’immortel auteur de la réponse au discours de réception du maréchal Pétain à l’Académie française. Quant à la jeune amazone, il s’agit de Jeanne Loviton (1903-1996) dite Jean Voilier en littérature, femme de tête (avocate, éditrice, romancière) et, par-dessus tout, redoutable amante (Giraudoux, Saint-John-Perse, Malaparte, Denoël… ont succombé à son charme).

C’est cette folle déraison amoureuse de Paul Valéry qui dura près de huit années que relate cette « correspondance des cœurs » inédite, éparpillée en 1982 lors d’une vente publique et conservée depuis à la BNF ainsi qu’à la Médiathèque de la Ville de Sète. On y découvre un Paul Valéry sentimental (« Tout à coup, le cœur l’emporte dans mon système vivant ») et intime sous un jour que l’on ne connaissait pas. Sous l’emprise de cette obsession amoureuse, celui qui fait figure d’écrivain national se livre nu, se dévoile, exprime sa détresse infinie, sa détestation de l’absence de celle dont il est épris, sa jalousie quand il la sait loin de lui ou la devine dans les bras d’un autre, sa dépendance, son allégeance, sa débilité, son impotence (« Je suis comme sans but, sans emploi, sans idées »). Il perd le sommeil, il implore (« Aime-moi, et que je le sente »), il quémande, il attend fiévreux l’arrivée d’une lettre qui ne vient pas ou un prochain séjour au château de Béduer dans le Lot où réside sa belle (et qui sert d’abri aux bobines de films de la Cinémathèque durant l’occupation). Il interroge (« Ce soir, où es-tu ? »), il souffre (« Excuse la douleur qui parle »), il déraisonne, il s’égare (« Je ne suis moi que par une vieille habitude de l’être »), il part à la dérive (« Je suis comme une bouteille à la mer »). Et s’il fait preuve d’une grande inventivité langagière et d’une fantaisie poétique renouvelée, il semble aussi parfois perdre son écriture au point d’en paraître « désécrire ».
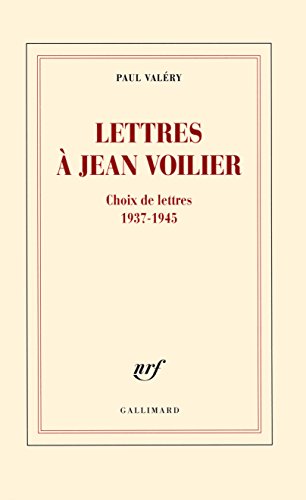 De temps en temps, Paul Valéry observe ses contemporains avec une lucidité jointe à une certaine sévérité (« Je suis excédé par toutes le sottises que j’entends, que je lis (…). Je crois qu’il n’y a plus guère de bonnes têtes en France que dans certains postes de l’armée et dans le clergé… On trouverait plus de culture et d’intellect dans ces corps (…) que dans la ménagerie littéraire, la mêlée politique, l’aquarium mondain, le maquis des affaires et le reste »). Mais, qu’il participe aux travaux de la commission internationale de la SDN à Genève en 1938, qu’il dispense un cours au Collège de France avant-guerre ou qu’il déjeune à la table du maréchal Pétain à l’été 1941, son esprit est ailleurs. Il vogue vers ce voilier insaisissable, cette goélette qui s’éloigne irrémédiablement sous l’effet de courants qu’il ne maîtrise pas. Cet envahissement amoureux, ce tsunami passionnel explique sans doute la faible place réservée par l’auteur des « Regards sur le monde actuel » dans ses commentaires et digressions (exception faite pour la période juin-juillet 1940 dont les lettres traduisent sa préoccupation pour le sort des siens) à la montée des périls dans la Vieille Europe ou, encore plus surprenant, à la guerre civile qui fait rage dans la France occupée, agenouillée devant l’Allemagne nazie et complice des pires atrocités. « Si amère que soit ton absence, l’idée de toi m’est un secours, un refuge, et il me semble que je mets ma tête entre tes seins pour ne rien voir ni savoir de cet ignoble monde » confesse-t-il, d’ailleurs, en janvier 1940 avant le grande désastre.
De temps en temps, Paul Valéry observe ses contemporains avec une lucidité jointe à une certaine sévérité (« Je suis excédé par toutes le sottises que j’entends, que je lis (…). Je crois qu’il n’y a plus guère de bonnes têtes en France que dans certains postes de l’armée et dans le clergé… On trouverait plus de culture et d’intellect dans ces corps (…) que dans la ménagerie littéraire, la mêlée politique, l’aquarium mondain, le maquis des affaires et le reste »). Mais, qu’il participe aux travaux de la commission internationale de la SDN à Genève en 1938, qu’il dispense un cours au Collège de France avant-guerre ou qu’il déjeune à la table du maréchal Pétain à l’été 1941, son esprit est ailleurs. Il vogue vers ce voilier insaisissable, cette goélette qui s’éloigne irrémédiablement sous l’effet de courants qu’il ne maîtrise pas. Cet envahissement amoureux, ce tsunami passionnel explique sans doute la faible place réservée par l’auteur des « Regards sur le monde actuel » dans ses commentaires et digressions (exception faite pour la période juin-juillet 1940 dont les lettres traduisent sa préoccupation pour le sort des siens) à la montée des périls dans la Vieille Europe ou, encore plus surprenant, à la guerre civile qui fait rage dans la France occupée, agenouillée devant l’Allemagne nazie et complice des pires atrocités. « Si amère que soit ton absence, l’idée de toi m’est un secours, un refuge, et il me semble que je mets ma tête entre tes seins pour ne rien voir ni savoir de cet ignoble monde » confesse-t-il, d’ailleurs, en janvier 1940 avant le grande désastre.
Tandis que la France s’enfonce dans la guerre civile et traverse l’une des pires périodes de son histoire, Paul Valéry (dont l’attitude relativement bienveillante à l’endroit des autorités de Vichy surprend quand elle ne déçoit pas) mène une bataille qu’il sait perdue d’avance. Ses lettres, accompagnées parfois de poèmes et de dessins, sont sublimes, douloureuses, sincères, pathétiques. Elles contiennent aussi des fulgurances (« Je n’ai pas la force d’être moi », « Je sens tellement fortement que les dieux sont morts »…). Loin d’un cabot(in)age sentimental le long de rivages amoureux dans la France des années de guerre, elles nous entrainent au grand large d’un cœur abimé d’avoir aveuglément aimé et qui va s’échouer sur les récifs invisibles d’une île baptisée abandon. Le 1er avril 1945, « jour de malheur », Jean Voilier rompt les amarres et annonce à un Paul Valéry naufragé son projet de mariage avec l’éditeur Robert Denoël. Quatre mois tard, le 20 juillet, « brisé », Paul Valéry décède.
Il faut lire ces épistoles en même temps que les poèmes que Paul Valéry a composés – le recueil intitulé « Corona et Coronilla. Poèmes à Jean Voilier » a été récemment publié aux éditions de Fallois – et, après cela, feuilleter le dernier ouvrage de la néo-académicienne Dominique Bona intitulé « Je suis fou de vous. Le dernier grand amour de Paul Valéry » (Grasset).
Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Celui des académiciens n’échappe à la règle.
Philippe LASTERLE
Lettres à Jean Voilier (576 p.) – Gallimard