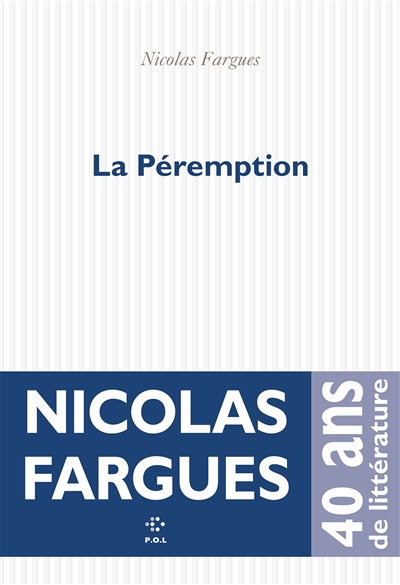Chaque semaine, on vous invite à lire une nouveauté, un classique ou un livre injustement méconnu.
La Péremption de Nicolas Fargues
En treize romans et un recueil de nouvelles, Nicolas Fargues a composé ce qu’il faut bien appeler une œuvre dont l’un des traits consiste à offrir une formidable peinture des modes de vie et des mentalités de l’époque. A la manière d’un entomologiste, l’écrivain épingle les préjugés (sociaux, raciaux, culturels…) auxquels personne n’échappe vraiment. Pour autant, cette matière « sociologique » n’occulte jamais l’exploration de la nature humaine et de ses motifs éternels, au premier rang desquels les élans du cœur que l’écrivain met en scène au gré de marivaudages ou de comédies de mœurs. En témoignent son nouveau roman, La Péremption, et sa narratrice, Zélie, professeur en arts plastiques, qui à cinquante ans décide de prendre sa retraite anticipée. En attendant le prochain héritage d’un appartement familial, elle estime pouvoir tenir une dizaine d’années sans travailler. Et si ce nouveau temps libre lui permettait de renouer avec la peinture, activité qui lui valut un succès d’estime et la vente de quelques toiles ?

Nicolas Fargues © Hannah Assouline / POL
Par ailleurs, du haut de son demi-siècle, Zélie se sent en décalage avec une jeunesse qu’elle a longtemps côtoyée dans son métier : « Une génération venue au monde avec une maîtrise innée du montage vidéo à coupe franche, de l’usage de la touche lecture rapide de la télécommande et des mots-consonnes de trois lettres. Hermétique aux temps morts, au silence, aux conjonctions de subordination et aux textes de plus de six lignes. » Même son fils, Furio, a échappé au supposé héritage culturel de ses parents. Vendeur chez Sonia Rykiel à Paris, narcissique, superficiel, à peu près inculte, militant dans une association LGTBQI avec son compagnon Darel « d’une étroitesse de vue sans remède », il a épousé les codes d’une « toute puissance époque ». Une autre génération, d’autres valeurs, une autre culture aux yeux de laquelle la littérature – entre autres – ne sert à rien : « Trois ou quatre cents pages de blocs de texte imprimés à l’encre et reliés à la colle sous une sommaire couverture en carton, rédigés dans une langue obsolète, sans photos, ni vidéos, ni liens hypertexte, cela pouvait-il revêtir encore un sens, en 2022 ? »
Vivre avec son temps
« La capacité à élever le débat ne servait plus à rien, ni à personne. Avec les réseaux sociaux qui, depuis quinze ans, avaient donné la parole au peuple dans son ensemble, les rapports de force étaient désormais inversés. Le peuple et ses goûts pas toujours sélectifs, on n’entendait plus que lui », constate Zélie. En une vingtaine d’années, sous le rouleau compresseur de la technologie, quelque chose s’est produit et l’on ne reviendrait pas en arrière : « au-delà du traditionnel conflit de générations, c’est l’intelligence elle-même qui se trouvait en danger au sein d’une société perméable comme jamais au matérialisme, à l’infantilisme et à la vulgarité. »
Bien que se sentant « en exil intérieur » et incapable d’épouser les grandes causes contemporaines, la quinquagénaire refuse de céder au « C’était mieux avant ». Elle ne veut pas être dépassée, rangée dans le rayon des has been. Plutôt accepter l’état des choses que s’en émouvoir ou s’en indigner. Cette résignation lui vaut d’être en paix avec son temps et de ne pas en être exclue tout à fait. La preuve : lors d’une soirée chez son ami Mathieu, engagé pour sa part dans le soutien aux sans-papiers et aux étrangers, Zélie n’attire-t-elle pas l’attention d’un trentenaire à l’allure branchée ? Il se fait appeler Shock, affirme travailler dans « le design, la mode, l’événementiel, la restauration ». Certes, il dit « du coup », mais il dégage une présence, un charme certain. Et tant pis pour le cliché de la « Blanche vieillissante » s’offrant une nouvelle jeunesse avec un Noir de vingt ans de moins qu’elle. Commence alors une relation dont on ne dévoilera pas les rebondissements et qui mènera les protagonistes à Bukavu en République Démocratique du Congo.
A son habitude, l’auteur de J’étais derrière toi et du Roman de l’été observe ses personnages (dont son héroïne, manière de double de l’écrivain) avec une cruauté mêlée d’indulgence. Il dissèque « une ivresse sans fondement », une histoire vouée à l’échec et par là même émouvante. « Vivre, il me faudra vivre encore, quelque temps parmi ceux–là », faisait dire Roger Nimier à Sanders à la fin du Hussard bleu. Zélie pourrait partager ce soupir, mais sans acrimonie, plutôt avec un sourire. Oui, la vie continue…