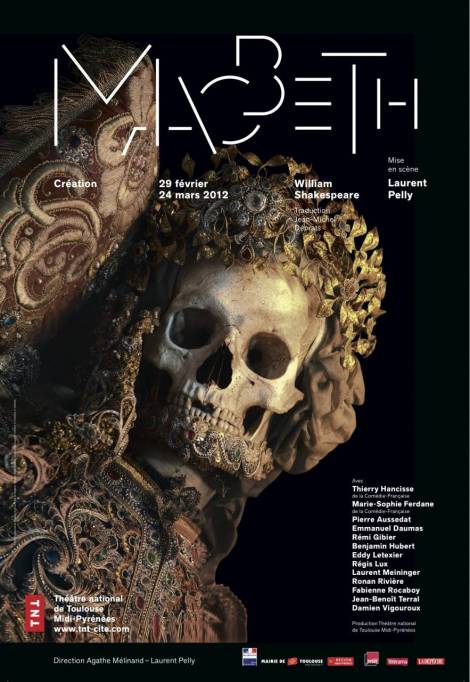Tragique et grotesque, émotion et dérision. Une estrade échiquier avec reine, roi, fous, et pions déplacés, sacrifiés. Quatre morceaux de tôle, des bidons, des cuvettes. Bouts de ficelle et bouts de scotch, têtes de mort clownesques, machettes en toc. Sans artifices complexes, sans vedettes, mais avec une intensité fulgurante, Brett Bailey fait de l’opéra un objet politique qui dénonce, questionne, sidère. Comme le concevait Verdi. C’est la couronne coup de poing du tyran que l’on prend en pleine figure avec ce Macbeth au Congo.
Pas de sorcières préparant quelque infusion de langues de vipères – mais un chœur antique émouvant, pas de fantôme sanguinolent surgissant parmi les convives – mais un cadavre qui reste cadavre, pas de folie somnambulique ni de lavage frénétique – mais une introspection. Massacres, complicités occidentales, omniprésence du fric et des armes, sont puissamment évoqués par l’humour grinçant des pantomimes et des projections. Les sur-titres s’éloignent de la lettre pour donner l’esprit et le goût du jour : familiers et malpolis. Habilement intriqués, Shakespeare et réalité font un propos implacable, Verdi et rythmes africains une partition saisissante.
En jeans et baskets et sous l’impulsion de son chef Premil Petrovic et de son frétillant premier violon Mladen Drenic, l’orchestre serbe No Borders Orchestra sait dire l’urgence verdienne malgré son effectif réduit. Des dix chanteurs sud-africains, impassibles, bien rangés, statues qui fixent, défient le public dès qu’il entre dans la salle, trois s’emparent des rôles principaux avec la fougue et l’impertinence de la jeunesse. Sec, vaguement inquiétant, Madoda Ebenezer Sawuli fait un Banco solide. Owen Metsileng (Macbeth) et Nobulumko Mngxekeza (Lady Macbeth) sont d’abord des corps sans complexes, généreux, puissants, qui montrent et se montrent, se vautrent devant la télé en pyjamas panthère. Les voix sont brillantes, impeccables de justesse (tel ne fut pas le cas de certain Macbeth aguerri entendu récemment au MET), de diction italienne, d’émotion. On pardonnera certains aigus râpeux d’une Lady Macbeth qui fait sa lessive en gants latex – préfiguration d’autres nettoyages, donne un superbe brindisi en dansant lascivement et s’abandonne à une folie figée à côté d’une cuvette désormais vide. Plus rien ne peut laver les crimes.
Point de réjouissances, un tyran est assassiné, un autre prendra sa place. Les dix chanteurs de nouveau rassemblés et statufiés portent l’émotion à son comble avec un Patria oppressa déplacé en épilogue – un hymne à tous les peuples opprimés.
Photos © House on Fire
Théâtre Garonne, 5 novembre 2014
Une chronique de Una Furtiva Lagrima.