« Le navire night » de Marguerite Duras au Théâtre Sorano
Spectacle théâtral conçu par Fanny Ardant et Sonia Wieder-Atherton
Avec Fanny Ardant, voix, et Sonia Wieder-Atherton, violoncelle
« Ce territoire de Paris la nuit, insomniaque, c’est la mer sur laquelle passe le Night. Cette dérive qu’on a appelée ainsi : Le Navire Night. » (Duras)

« Le Navire Night » de Marguerite Duras est un texte brûlant de 1978, un de ses plus étranges aussi, et il a connu une mise en scène de Claude Régy à trois personnages Bulle Ogier, Michael Lonsdale et Marie France en mars 1979, puis une adaptation au cinéma par l’auteur lui-même avec Dominique Sana, Bulle Ogier, Mathieu Carrière en 1978, et où la propre voix de Marguerite Duras est très présente. À chaque fois il s’agissait d’un dialogue, un dialogue impossible dans cette corne de brume des solitudes, de ce gouffre du temps, qu’est la conversation téléphonique, entre deux êtres qui vont s’aimer sans jamais vouloir ou pouvoir se voir. Lui J.M, et F. elle, face au gouffre du téléphone.
Des 90 mn de la pièce ou du film, Fanny Ardant a fait « une histoire » qui se noue et se dénoue en une heure. Histoire d’amants qui ne communiquent et ne fusionnent parfois qu’en distance.
Cette « histoire » comme la nomme Duras est à la lisière de la banalité et de la légende. Des poncifs la parsèment : leucémie de l’héroïne F. à la voix mourante, image du père adoré et du chirurgien, du chauffeur-espion, maison de Neuilly, femme toujours couchée dans sa chambre.
Mais le langage incantatoire de Duras, la métaphysique des non-rencontres, les conversations tissant la nuit, l’amour fou, font de cette nouvelle un conte amoureux, une passion forcément invivable, une perte inéluctable.
« Il lui donne son numéro de téléphone, elle non, elle ne donne pas le sien. Il dit qu’elle a une voix qu’on aime écouter. Il dit une voix assez fascinante. Ils se parlent, se parlent inlassablement, se parlent sans fin.
Parlent, sans fin se décrivent l’un à l’autre, à l’un l’autre, disant la couleur des yeux, le grain de la peau, la douceur du sein qui tient dans la main, la douceur de cette main. En ce moment même où elle en parle, elle la regarde : Je me regarde avec tes yeux. Il dit qu’il voit… »
Fanny Ardant a adapté cette histoire, en coupant quelques passages –la figure de la mère, d’autres – pour en faire non pas une lecture, mais un acte théâtral, une incarnation en croisant paroles de Duras et musique qui doit tisser, prolonger, approfondir, révéler, ce qui est dit.
Dans une interview à La Dépêche Fanny Ardant dit ce qu’elle a voulu construire entre mots et musique : « En les faisant se mêler, se tisser pour raconter une histoire. « Navire night » est un récit à deux voix, humaine et musicale. Humaine avec les personnages que j’incarne, musicale avec, le violoncelle de Sonia Wieder- Atherton qui ne vient pas marquer des pauses, mais raconter. La musique rentre dans le texte, le complète lui donne une âme supplémentaire. »
Et Fanny Ardant fait vivre seule les deux personnages, l‘homme et la femme qui se sont croisés, aimés, puis perdus dans le labyrinthe et l’anonymat du téléphone.
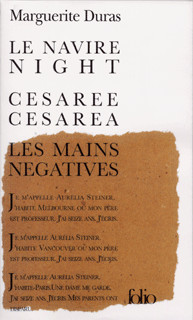 Les deux voix qui se cherchent, s’enlacent, se séparent. On dirait d’ailleurs deux voix off, malgré la passion amoureuse déclarée, mais qui oscillent entre absence et présence, sont toutes encloses dans sa seule voix.
Les deux voix qui se cherchent, s’enlacent, se séparent. On dirait d’ailleurs deux voix off, malgré la passion amoureuse déclarée, mais qui oscillent entre absence et présence, sont toutes encloses dans sa seule voix.
L’alternance de la voix féminine et de la voix masculine, qui donne dans le texte écrit une musique particulière, devient ici uniquement la voix de la narratrice, qui devient en fait la voix de l’auteur. Il y a alors comme une prise de distance qui rend encore plus glaciale et violente la chute finale : Elle se maria en juillet, il n’était plus à Paris.
Et la voix de Fanny Ardent est aussi inimitable et belle que celle de Marguerite Duras, quand celle-ci parle dans ses films. C’est « une voix qui donne à voir ». Mais pour ce dialogue, ses répliques, il fallait une deuxième voix. C’est celle du violoncelle.
Sonia Wieder-Atherton a puisé dans ses récents récitals pour trouver le climat approprié, pour non pas combler des vides ou effectuer des transitions, mais parler comme un personnage, répondre, souffrir aussi avec ce qui est dit.
Ainsi on retrouve des propres arrangements de Monteverdi, Haendel, Montsalvadge, et pour les moments de grande tension Scelsci et une suite de Britten, musiques qui arrachent des sentiments en lambeaux. Ses arrangements très personnels semblent des improvisations.
Le miracle de ce spectacle est le mariage parfait entre le timbre chaud, velouté, de Fanny Ardant, et la voix profonde du violoncelle.
C’est un véritable duo, ou planent bien des ombres.
Sans micro, sans décor, Fanny Ardant assise le plus souvent, se levant dans les apogées de sentiments, se tournant vers sa soliste alors, fait passer ce colloque sentimental désespéré devant nous, entre des êtres solitaires, mais non pas glacés. Ils aiment, ils crient, ils se mentent, ils s épient. Marguerite Duras part d’une réalité où chaque nuit à Paris, des centaines d’hommes et de femmes jettent des bouteilles d’amour dans l’océan anonyme des numéros de téléphone non attribués. Cherchant l’amour, la jouissance, sans doute, mais surtout comme celui qui se fait appeler Le chat, un cri face au gouffre.
Je suis celui qui appelle
Je suis celui qui appelait qui criait il y a trente mille ans
Je t’aime
Je crie que je veux t’aimer, je t’aime
J’aimerai quiconque entendra que je crie…
Je suis celui qui criait qu’il t’aimait, toi. (Les mains invisibles, Duras)
C’est donc « une histoire », non pas de roman-photo qui aurait pu en résulter, mais un entrelacs de paroles. Paroles courtes, qui n’expriment pas tout, qui énigmatiquement font entrevoir un sous-texte plein d’abîmes, où l’on doit deviner au-delà des mots, les déchirures.
Le Navire Night ne peut que s’échouer après ces voyages en étreintes, et Duras va écrire l’effacement.
Le Navire Night dans la nuit profonde des solitudes.
« Le Navire Night est face à la nuit des temps – aveugle, avance sur la mer d’encre noire. Le Navire Night vient d’entrer dans son histoire » (Duras)
Et les mouvements du Navire Night ne vont que vers le naufrage, déjà entrevu dans l’envoi des photos. Car l’image tue le désir de ses personnages qui n’ont pas le droit de se voir.
« L’histoire s’arrête avec la photographie. Le désir est tué par l’image.. À partir des photographies il ne reconnaîtrait plus sa voix. »

Cette « histoire » est une histoire d’évocation, portée par les voix seules, voix invisibles, dans le noir, mais ici charnellement sur scène. Elles sont « la sorcellerie évocatoire » que recherchait tant Marguerite Duras. Fanny Ardant et Sonia Wieder-Atherton sont ces voix, sorte de « mains invisibles » sur les grottes de la mémoire. Elles nous donnent à voir et entendre l’invisible de ces destinées.
« La nuit venant elle appelle, oui avec la nuit, elle appelle. »
Entre appels contre le néant, maladie rampante comme la leucémie, mensonges et fausses rencontres, l’« histoire » est la nuit qui appelle.
« Toujours, partout ces cris.
Ce même manque d’aimer » (Duras).
La prosodie de Duras est difficile à rendre habituellement, car il faut faire exister les redites, les phrases volontairement courtes et pauvres, des silences, des « histoires sans images, des histoires d’images noires », des banalités aussi.
Ici l’enlacement de la voix de Fanny Ardant et de Sonia Wieder-Atherton rend toute cette musique des ombres. La précision de la diction de la voix, sa chaleur, le timbre du violoncelle, font de ce spectacle un magnifique hommage à Duras, au théâtre, et sa langue très scénographique, résonne pleinement magique et incantatoire.
Et l’irreprésentable est là sur la scène.
Gil Pressnitzer
