
*
Chronique Serre moi fort de Mathieu Amalric
*
Clarisse (Vicky Krieps) se prépare un matin très tôt. Elle regarde dormir son mari Marc (Arieh Worthalter), reborde son fils Paul (Sacha Ardilly), sa fille Lucie (Anne-Sophie Bowen-Chatet) la voit quitter leur chambre. Et elle part. Pour de bon. Sans faire de bruit, en prenant soin de ne pas les réveiller, elle les quitte sur la pointe du cœur. Besoin de changer de décor, partir à la mer.
Serre moi fort s’écrit sans tiret, comme Je t’aime je t’aime d’Alain Resnais n’a jamais eu de virgule, pas par coquetterie, mais parce que l’écriture-même du titre fait sens avec le propos. Serre moi fort a pour synopsis « ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va », et c’est formidablement résumé. Car le choix de cette épouse et de cette mère, n’est pas une fuite en avant, mais une fuite en arrière. Une musique d’un cadeau de station-service ou à la radio la ramène aux musiques que sa fille aimerait jouer au piano. Une cigarette ? et son briquet lui rappelle son fils qui lui a offert. Le corps de son mari reste palpable sous ses doigts. Elle les imagine au petit-déjeuner tous les trois, face à son absence qui prend toute la place. L’amour qu’elle a pour eux est indéniable, mais il lui est impossible de les rejoindre. Elle voit leurs vies sans elle à leurs côtés, mais elle réussit à communiquer pourtant avec eux.

Quand le scénario d’un film n’est pas tourné, on parle de film fantôme. Quand le texte d’une pièce de théâtre n’est jamais joué, parle-t-on de pièce fantôme ? En 2003, Claudine Galea publie aux Éditions Espaces 34 le texte d’une pièce de théâtre Je reviens de loin, qui ne sera jamais mise en scène. Voici la quatrième de couverture, où le personnage féminin s’appelle Camille :
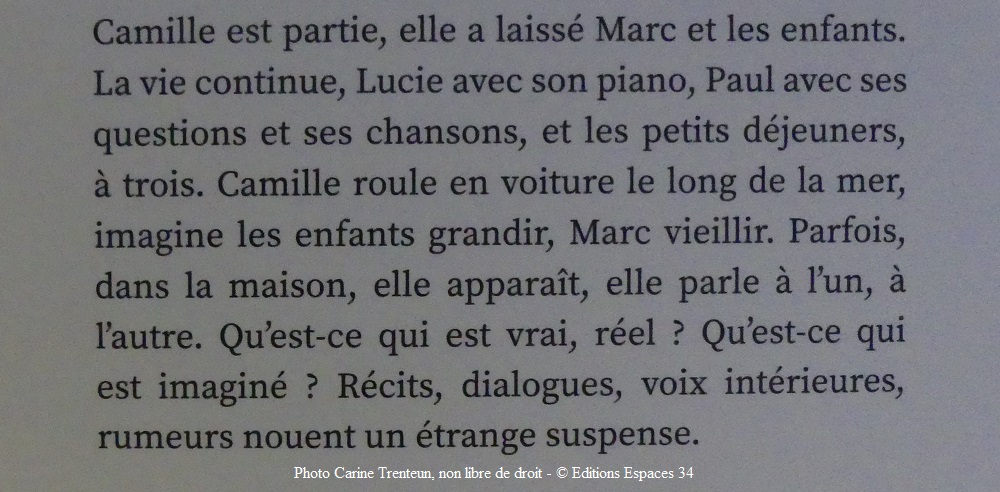
Et le texte ne se présente pas comme un texte habituel de théâtre (cf extrait ici). Voici les indications avant le prélude :
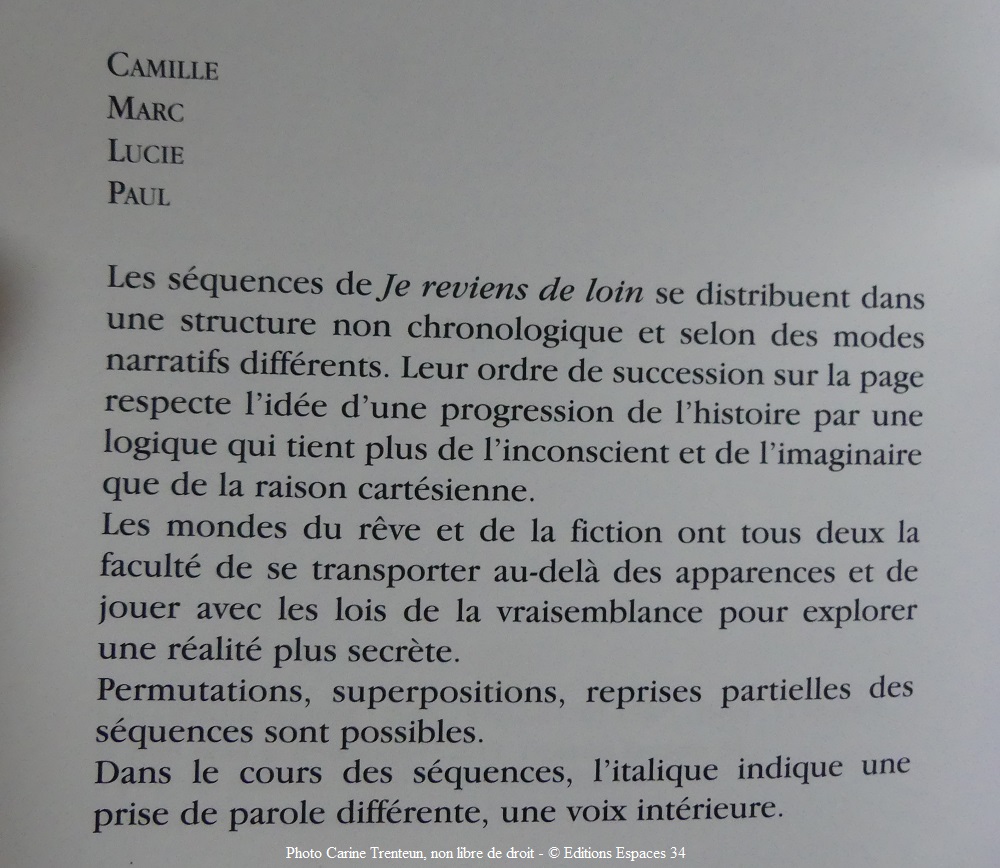
Mathieu Amalric respecte ce mode d’emploi pour sa nouvelle création, et comme les permutations sont possibles au théâtre, la raison du départ de Camille (dans le livre)/ Clarisse (dans le film) passe de révélation finale (dans le livre) pour être placée au premier tiers du film. Si connaître cette cause ne nuit pas à la réception du film (ce qui fut mon cas), il me semble plus courtois de ne pas l’écrire. Et cet ingénieux changement évite le film à twist pour que nous, spectateurs, profitions pleinement de l’inventivité de Clarisse. J’ai toujours aimé les films qui interrogent le cinéma, et parmi eux, ceux qui abordent la relation entre création et folie. J’ai toujours aimé cette sensation de vertige qu’ils peuvent procurer, à chaque visionnement, comme ceux de Satoshi Kon, où rêve et réalité se croisent, se confondent. Serre moi fort est tout aussi vertigineux, tout en étant, en plus, enveloppant comme un plaid sur le canapé un soir d’hiver. « Passer par la folie pour ne pas devenir folle », déclare Vicky Krieps dans le dossier de presse du film. Elle irradie le film, de sa force, de son amour pour sa famille. C’est vraiment son année : magnifique Bergman Island de Mia Hansen-Løve, Old de M. Night Shyamalan, et bientôt De nos frères blessés de Hélier Cisterne (en salles le 13 octobre 2021). Excepté dans Bergman Island, ses personnages sont confrontés à l’insupportable, et l’actrice, toujours juste, propose ici une nuance de jeu encore nouvelle. Quant à Arieh Worthalter, y a-t-il un registre ou une discipline où il ne soit pas crédible ? Aussi à l’aise dans le chant que la danse, père aimant, serial killer, ou amoureux séparé, c’est encore une interprétation sans faute pour ce père face au vide laissé par l’absence de son épouse.

Serre moi fort fait partie de ces œuvres métafilmiques, où Clarisse serait l’auteur et la projectionniste, son cerveau l’écran de cinéma. Le montage de François Gédigier est dément, pour être aussi riche, varié, sans jamais nous perdre dans ce que vit Clarisse, ses souvenirs, ce qu’elle imagine, ce qu’elle projette. C’est un immense plaisir de spectatrice de visionner un tel film, avec à mes côtés la suspension d’incrédibilité qui me sourit régulièrement pour me rappeler mon consentement. Le nom de Mathieu Amalric évoque en priorité l’acteur formidable et incontestable ; il serait honnête de mettre son travail de cinéaste au même rang.
Le titre du film provient de la chanson « La nage indienne » d’Etienne Daho, absente du film
*
Rencontre avec Mathieu Almaric, réalisateur du film Serre moi fort
*
Et voici le moment où par honnêteté, je vous conseille d’arrêter de lire si vous n’avez pas vu le film ou si vous ne connaissez pas le livre.
En ce qui me concerne, avant cette rencontre et avant de voir le film, je n’avais pas lu le livre de Claudine Galea. Comme le film allait sortir, le livre a arrêté d’être publié en vue d’une nouvelle édition « revue et corrigée » disponible après ma rencontre. Mais, j’avais entendu l’adaptation radiophonique sur France Culture en 2003 (merci C. mon ange-gardien), ce qui m’a permis d’aborder avec Mathieu Amalric l’étape d’adaptation du scénario, bien que le dossier de presse fait avec Olivier Joyard soit une formidable mine d’explications.
Une dernière précision, dans le texte de Claudine Galea, il est mentionné en pré-prélude « l’italique indique une prise de parole différente, une voix intérieure ». Il se trouve que durant la rencontre, Mathieu Amalric disait « je », sans changement de ton, pour parler à la place de la voix intérieure de Clarisse. Du coup, j’ai mis ses propos en italiques aussi ; et entre guillemets, ce sont les dialogues du film.
Il fait aussi super bien la voix de Brigitte Fontaine quand il a chanté ses deux extraits de chanson, mais ma retranscription a atteint ses limites.
Bon film en premier, et bonne lecture ensuite de ces propos.
Pendant le travail d’adaptation du texte de Claudine Galea, combien de temps êtes-vous resté avec ses mots en main ? Et à quel moment les avez-vous quittés ?
J’ai fait des allers-retours, constants. C’est dommage, j’aurais dû amener mon livre, vous auriez vu ce que j’avais fait dessus. Laurent Ziserman, mon ami qui devait monter cette pièce, et qui finalement n’a pas pu, me file le livre de Galea. Je le lis, et tout du long, je suis pris, je chiale, surtout à la fin de la lecture, avec la révélation finale que j’ai mise plus tôt dans le film. Mais avant aussi je chiale. Notamment, je me souviens de la scène dans la salle de bain avec le fils crie à son père « tu as jeté maman ! ». Quelque chose avait à la fois percuté un nerf, c’était vraiment terrible ; et en même temps, j’étais envoûté de larmes. À la fois dur comme un coup… et une aiguille.
L’adaptation commence par une dissection du texte : quels sont les personnages, leur âge à chaque époque – repérer les indications comme la rencontre de Camille et Marc qui se déroule deux ans avant la naissance de Lucie -, tous les lieux, tous les objets. Et je commence à écrire une première version dans un respect absolu du livre. C’était déjà un travail préparatoire : se projeter et chercher, dans le texte, où il y a des possibilités de cinéma. Donc à partir de là, je n’étais plus sur la source du texte de Galea, mais uniquement ce que j’avais recueilli de mes bribes d’archéologue. Comme les choses sous sac plastique que vous ramenez de fouilles. Écrire ce premier texte m’a pris neuf jours, et faisait soixante pages.
Puis je revenais au livre, puis je l’oubliais, puis je revenais, puis je l’oubliais. Pareil au tournage et aussi au montage. Je revérifiais s’il n’y avait pas une phrase, un mot, comme « pilule » qui n’est plus du tout dans le film, mais il y avait tout un passage où elle prenait la pilule. D’autres choses me revenaient comme ce cahier orange, Martha Argerich, le briquet, le cheval à bascule qui s’appelle Zippo dans le texte. C’est à la fois extrêmement proche et en même temps très loin.

Dans les différences entre la pièce radiophonique et votre film, il y a Martha Argerich justement. Dans la pièce, Lucie pense que Martha est sa mère, et dans le film, c’est la mère qui dit « ma fille est Martha Argerich »
On l’a tourné avec Vicky qui disait « ma mère est Martha Argerich », comme dans le texte de Galea. Le tournage s’est fait en trois fois, sur trois saisons, et entre les tournages, on montait, et on a vu au montage que cette phrase n’avait plus de sens. Non, c’est Vicky, la mère, qui devait dire « ma fille est Martha Argerich », c’est beaucoup plus simple. J’ai été assez envoûté, tout le temps, par les possibilités de double-fond que m’inspirait le texte de Galea.
Envoûter : au point d’hésiter à prendre une direction ? ou de la prendre et de vous tromper ?
De me tromper. Je suis parfois allé trop loin, même au tournage, comme dans la séquence de la discothèque, où Clarisse rencontre pour la première fois Marc, qui était un souvenir reconstruit par elle. On a tourné une scène : ils sont au bar, plutôt ambiance années 50, musique douce ; il est là, il se retourne, ils se sourient, il a une cigarette éteinte à la main, elle s’approche de lui, elle va pour lui allumer la cigarette, il voit le briquet, il se fige, il la regarde, elle regarde le briquet, et c’est le briquet de l’enfant qu’ils auront plus tard. Donc le souvenir s’écroulait. C’était déjà très compliqué dans la déconstruction de la déconstruction.

Cette scène fait partie des choses qui ont été enlevées au montage, pour aller dans le partage possible avec le spectateur et le geste d’imagination de Clarisse. Il ne fallait plus que ce soit moi qui tire les ficelles, mais il fallait que le spectateur vive la même expérience que Clarisse : je vois sur un écran quelque chose que je sais faux, et pourtant, puisque j’y crois, c’est que c’est vrai. Et tout à coup, PAM ! tu as des blocs de réalité qui te tombent sur la gueule, comme quand au talkie tu entends « malheureusement, on ne va pas retrouver les corps, il va falloir attendre le printemps pour retrouver les corps ». C’est dit à vingt-huit minutes du film. Du coup, on est dans son imagination… et après on oublie. C’est ça que j’ai trouvé bouleversant.
Avant cette phrase à vingt-huit minutes, elle dit à son amie à la station-service « ça fait deux mois vendredi », ou « tu sais, je les vois ». Ou quand la musique que Lucie joue au piano continue alors qu’elle quitte le piano… Des indices parsèment le film. Comment les avez-vous dosés ?
On travaille, on imagine, on bourre le plan de plein d’idées que j’ai écrites avant… Par exemple, l’accessoiriste me demande de quelle couleur je veux les draps pour les lits des enfants, pour la scène au début quand elle s’en va. « N’importe laquelle, ce n’est pas grave…. attends : mets-moi juste des draps blancs ! Avalanche, blanc ! ». Quand tu reverras le film, tu constateras qu’au moment où elle reborde son fils Paul qui dort dans l’autre sens, tout à coup, il n’y a plus de son, sauf un son crissant, déjà un truc qu’elle enlève de la neige. Ce n’est rien en soi, mais ça fait partie des petites choses qui sont partout. Après, j’ai dit à Anne-Sophie, qui joue Lucie « tu dors, c’est tout », et tout à coup « fais la morte… et tu refermes les yeux, pour voir ce que ça donne ». Quand tu reverras le film, tu verras un cadavre, puisque tu sais.

Donc, des indices sont partout. C’est sous-cutané. À quinze minutes du film, la petite lui dit « tu devrais nous sortir une histoire qu’on puisse raconter », elle répond « qu’on puisse raconter ? C’est ce que je fais ma chérie » et « Ah ! vous dirai-je maman » « tais-toi ! » parce qu’elle reprend exactement les dialogues qu’on vient d’entendre où la petite a dit « tais-toi ! », et elle lui dit « mais j’invente ma chérie, j’imagine que je suis partie » puis « fallait bien trouver quelque chose » qui est aussi une phrase que la petite vient de dire à son père. C’est son geste d’imagination qui me bouleverse, c’est ça le geste amoureux. Tout le travail ensuite d’inventer les scènes devait permettre que le spectateur soit dans la même situation qu’elle : je sais que ce ne sont pas ses enfants qui ont grandi, puisque j’ai vu Clarisse trouver une fille, je sais ce qu’elle est en train de penser, je vois bien qu’elle la fait rentrer pour de faux dans la maison, je vois bien que quand la fille prend le journal orange, c’est Clarisse qui lui dicte quoi écrire. Et puis après, je viens de voir Martha Argerich : je vais déguiser ma fille en Martha Argerich ! Putain, ma fille, elle aurait pu faire ça. Et puis il y a cet homme-là, alors qu’elle vient juste de dire « putain, Marc, c’était comme un meuble, puis les enfants…. ». Il fallait que ce soit ultra-quotidien, ultra-réaliste.
Clarisse interagit avec chacun de ses enfants avant de partir. Dans un film comme Sixième sens de M. Night Shyamalan, le personnage de Bruce Willis n’interagit pas avec les autres, et là aussi, on a eu tous les indices sous nos yeux, comme la buée…
Le plaisir de ces films-là, comme Sixième sens ou Usual Suspects de Bryan Singer, qui sont des films que j’aime, mais je n’ai pas revus, n’est pas celui qu’il fallait pour mon film. Il ne fallait donc pas de révélation finale pour le film, alors qu’elle est pourtant écrite à la fin dans la pièce. Je me suis sauvé la peau. Faut voir aussi comment on pleurait sur le tournage à la fin de chaque plan.

Une des premières scènes où Clarisse s’adresse sa fille, la mère conduit et l’engueule avec son piano « tu ne vas pas faire des gammes toute ta vie ! ». Connaissant l’adaptation radiophonique, je ne m’attendais pas forcément à ces critiques négatives ; on a plus l’habitude d’évocation de souvenirs ou de futurs positifs.
C’est peut-être à cause du texte de Galea qui évoque la relation du personnage de Camille avec sa propre mère…
Cette relation est absente dans l’adaptation radiophonique….
Moi aussi je l’ai enlevée. Pour moi, ce passage que tu évoques était aussi très ludique ah oui, ah putain, la réalité c’est ça à savoir Lucie qui apprend ses gammes et qui n’a jamais dépassé « La Lettre à Élise » comme on le voit à la fin quand ils partent de la maison. C’est horrible car on se dit que toute la musique sublime qu’on vient d’entendre n’a jamais existé. Les gammes ah putain, ça prend du temps un enfant qui grandit… faut être patiente, faut être une mère parfaite… attends ! On va dire que les gammes, là, non ! On va dire que tu sais jouer. Bé tu vois, on est bien : tu sais jouer et je suis une maman bien. C’est faire grandir.
Un autre changement que vous proposez par rapport au texte est durant l’audition au conservatoire…
Beaucoup de scènes qui étaient des dialogues ont dû changer. Notamment la scène à la fin avec les polaroïds, qui était prévue dans la cuisine où le père et les deux enfants parlent ensemble. J’ai essayé de l’imaginer ainsi. Mais on n’était plus dans le réalisme, c’était après qu’on ait vu le retour des corps. On ne pouvait pas encore continuer à projeter des fantômes qui discutent : il ne fallait plus qu’on les voit en vrai, mais revenir à des photos sur le frigo où les enfants sont petits. Avec les polaroïds, j’ai proposé à Vicky de les faire parler. Je suis assez heureux d’avoir trouvé cette idée. Christophe Beaucarne, le chef-opérateur image, avait pris des photos au polaroïd pendant les deux jours où toute la famille, les quatre, se prenaient en photo. Deux jours avant le tournage, Beaucarne avait disposé tous les polaroïds sur la table, et j’ai trouvé que ça ressemblait au jeu Memory, tiens, on pourrait les retourner. J’ai pensé mémoire/Memory, ça m’est resté… Clarisse cherche des paires, à mettre des choses ensemble, et du coup, elle les fait parler.

Photo personnelle de Mathieu Amalric
Et puis elle prend cette putain de décision de vendre la maison. Je savais qu’il ne fallait pas qu’elle reste dans la maison, qu’elle ne devienne pas un mausolée. C’est très compliqué la fin.
Et en plus, comme on parle adaptation, il y avait dans le texte « les chansons de Paul ». J’ai essayé d’en faire quelque chose, et c’est plutôt devenu des chansons de Brigitte Fontaine, comme une comptine « Où vas-tu petit garçon » :
Où vas-tu petit garçon ?
Je vais à l’école.
Quand reviendras-tu ?
Jamais
Je testais des trucs. Et puis après, des dialogues me venaient, qui ne sont pas forcément dans le texte. C’est difficile de décortiquer l’adaptation : c’est un grand mélange !
Ayant travaillé longtemps sur les représentations du lien entre création et folie au cinéma, je guettais les « boucles », et les vôtres sont très intelligentes. L’idée de commencer et de finir le film sur le Memory avec les polaroïds est arrivée à quel moment ?
Elle n’était pas au scénario, mais elle est venue au montage. Le début qu’on avait tourné était proche de la pièce. On a tourné avec Erwan Ribard qui interprète l’agent immobilier la même scène où Vicky disait les mots d’Erwan, tout était inversé. Le premier plan était sur une main sur une grille, comme dans le rêve de Claudine, – on ne sait pas si elle ouvre ou si elle ferme – , et l’homme qui dit « bien sûr, il va falloir repeindre le portail », il pleuvait. Et il y a un autre couple, cette femme fait la même marche, traverse la cour, et tu ne sais pas si elle visite une maison en tant que cliente, ou pour la vendre. Elle voit la vieille voiture sous le auvent « je peux faire le tour de la maison ? » elle regarde l’arbre, elle voit le cheval enterré, elle essaie de le remettre droit, elle refait le tour de la maison, elle regarde par la fenêtre de la cuisine et elle entend « Clarisse. Clarisse ». C’était comme ça qu’on avait tourné. Je devais continuer avec la deuxième scène de la pièce où ils étaient au bord de la mer « Clarisse, viens » que je n’ai jamais tournée parce qu’entre-temps, d’autres choses sont venues. À la fin de la première scène, la colère n’était pas prévue, mais j’ai dit à Vicky « y a peut-être une colère qui monte » pendant qu’elle jouait. Elle adore qu’on lui parle pendant qu’elle joue, que je lui demande de dire tel mot, de chanter fort, parce qu’elle est à la fois extrêmement habitée, elle a une telle dextérité, elle est tout le temps dans le jeu, dans l’amusement. Elle va chercher très profond profond profond des choses. Et en même temps, elle est comme un athlète qui sait qu’elle ne va pas être en commande avec l’acteur qui prépare pour bien ouvrir la bouteille. Elle conduit comme une déesse. Elle adore ses trucs techniques du cinéma. Donc, elle était en colère, elle a continué, et après, on a fait un autre plan évidemment juste au dessus de son épaule, sur les cartes/polaroids. On a monté cette scène assez tôt, et elle avait une telle force, surtout le « on recommence, on recommence » , que c’est devenu le premier plan, et il n’a jamais bougé au cours des différents montages.

Après, on la voyait mettre en scène : elle regardait le polaroïd avec eux quatre à la table de la cuisine, elle ouvrait le boîtier du Polaroïd pour y mettre cette photo, elle prenait la photo, et la photo ressortait. Je n’ai gardé que ce moment magique où la photo d’eux quatre ressort alors que la pièce est vide. Ça résume tout le film : on n’a qu’à dire que, mais il fallait enlever les ficelles pour que le spectateur ait un lien direct avec le personnage de Clarisse, et non pas avec un manipulateur.
L’autre boucle concerne la séquence où les corps sont ramenés. L’idée de répétition, avec des angles et des points de vue différents, est apparue tôt ?
Oui, celle-là était écrite au scénario. C’est du travail, même sur le placement des caméras, le choix des plans. Je ne sais pas si c’est répété dans le texte de Galea. C’était aussi l’idée je me donne encore un tout petit peu de temps…. pas tout de suite. Elle voit le regard de la serveuse, elle se tourne, elle voit le chien dehors qui revient, et cette première séquence s’arrête là, non, pas tout de suite le sauveteur, et donc elle invente le jeu vidéo, on continue un peu la vie avec des enfants. Juste voir les choses avant la mort.


C’est sincèrement très bien conçu, sans être manipulateur, ni voyeurisme. On comprend le moment qui va suivre, sans le voir, et on conçoit très bien qu’elle le recule.
Merci. Il fallait que ce soit elle : c’est elle qui fait le film. Juste après cette première fois, il y a la séquence avec le jeu vidéo avec Paul, il va à la fenêtre, il voit son père construire une cabane, il sourit, il sort du champ. Plan sur la porte d’entrée, on entend des pas, donc évidemment, c’est l’enfant qui va sortir !
Et non, c’est elle, avec une petite corbeille en plastique bleue, dans laquelle on verra après qu’il prend la pomme. Il la met sous l’arbre, et Clarisse n’a même pas besoin de se retourner, il sort et c’est comme un western, avec entre autres le cheval. Elle perpétue un truc, et tout de suite après, elle fait une blague, quand Lucie joue du piano « je vais pas attendre le dégel ».
Elle est super osée ! même si elle nous permet de respirer. On est sur des montagnes russes : on sait, ça monte, on respire, on rit, on oublie et bim ! on se rappelle qu’on sait.
C’est aussi pour ça qu’on l’aime Clarisse. Quand elle tire la langue, ou même les rares moments où elle pleure. Je repense à la scène où elle vient d’enlever la place des enfants dans la voiture, et elle imagine son mari encore obsédé par sa femme qui l’a quitté, et qui fait chier ses collègues de boulot, et là, son collègue lui hurle « tu nous gonfles, t’arrêtes ! ». Ça lui fait plaisir à elle, car elle imagine je suis partie, tu seras encore amoureux de moi, et après un rasoir… tiens, je vais le foutre à poil dans la salle de bain… je vois son cul, c’est bon ça…. la petite a grandi, elle ne peut plus rentrer dans la salle de bain et voir son père nu… je vais la faire rentrer pour qu’il panique. Comment elle joue ! Et qu’est-ce qu’on l’aime pour ça.
Après, ça sombre… il demande « et comment tu fais toi ? », et elle répond « je ne sais pas ». Et on voit la pluie sur le pare-brise, il lui dit « à quoi je ressemble ? Dis-moi maintenant ». Ça me fait pleurer… Et on la voit pleurer. Il a fallu être dans cet état-là tout le temps du tournage, tu imagines ? Puis on la voit passer ce magnifique pont Eiffel, que je voulais, à l’entrée de Bordeaux. Les croisillons, la musique, et hop, tu as une blague avec « tomate farcie », et puis après, elle peut revenir dans la maison. J’ai rajouté au montage des phrases très courtes, où en fait, elle dit les choses « c’est pas moi qui suis partie » J’ai inventé, comme ça vous êtes là.

Pour en finir avec la folie : le mot n’est jamais prononcé. On n’a juste les parents de l’adolescente qui parlent d’appeler la police si Clarisse continue d’agir ainsi. Dans le texte, Marc dit « je deviens cinglé, taré, idiot », Paul effeuille marguerite « à la folie »
Le mot n’est en effet jamais venu. Comme je le dis dans le dossier de presse, il y a eu cette scène extraordinaire où Clarisse cherche à faire passer l’hiver le plus vite possible, car c’est insoutenable d’attendre le retour du printemps. Elle essaie d’abord son histoire d’inversion j’ai qu’à dire que c’est moi qui suis partie, comme ça eux ils sont restés, ça marche… ça ne marche pas trop. Elle essaie alors l’alcool, le travail de traductrice mais ça ne tient pas très longtemps. Et après, elle essayait la folie si je suis folle, peut-être que je ne souffrirai pas. On a tourné une scène avec cette idée en tête, et Vicky est tombée malade le lendemain. Je n’ai pas monté la scène parce que c’était tellement puissant que ça réduisait l’imaginaire, et on aurait pu penser qu’elle était vraiment folle. Ça aurait donné moins de plaisir à découvrir toutes ses autres inventions. Et je me suis planté sur les matériaux de textes que je lui ai proposés, où j’étais encore parti de Brigitte Fontaine, ce duo avec Jacques Higelin, « Cet enfant que je t’avais fait », où il demande :
Cet enfant que je t’avais fait
Pas le premier mais le second
Mais cet enfant, où l’as-tu mis ?
Et elle répond complètement à côté
J’aime la forme de vos mains
Offrez-moi une cigarette
La scène était artificielle… un peu… J’ai essayé d’enlever le dialogue, il ne restait plus que des attitudes. J’ai raté cette scène, pas Vicky, moi seul. Voilà, ça peut arriver. L’os à ronger que tu donnes : j’ai donné un truc friable. Ce n’était pas la note qui fallait, mais un accord dissonant qui ne rentrait pas. Et c’est vraiment dommage, parce que Vicky était démente ! Le lendemain, on partait en équipe très réduite de Saint Gaudens à La Rochelle, pour la faire conduire, faire des plans de voiture. Mais Vicky était tellement malade, à cause de moi, de la journée de la veille, qu’elle n’a pas pu. Rémi Duchêne, le régisseur, a des mains extrêmement fines. On lui a mis le pull rose de Clarisse, et c’est lui qui conduit, notamment sur le pont Eiffel dont on parlait tout à l’heure.
Continuons sur les scène coupées : dans le dossier presse, vous parlez de scènes du film Les Gens de la pluie de Francis Ford Coppola, qui auraient dû être dans votre film, et puis non. Dans ce film-là, le personnage de Shirley Knight part de chez elle, et dit « elle » au lieu de dire « je » quand elle parle d’elle-même…
Clarisse allait effectivement voir Les Gens de la pluie au cinéma, on a tourné le plan où elle sortait du cinéma. Dans ce film-là, la scène dans la cabine téléphonique où elle appelle son mari n’est pas un plan-séquence de huit minutes, il y a une coupe. Quelle tragédie ce film ! Ce film est complètement dingue : écrit comme ça, tourné en 16 mm…
D’autres scènes prévues faisaient-elles référence à ce film ?
Non. Attends….Ah oui, ça me revient maintenant ! Je n’ai pas eu le temps de tourner certaines scènes. J’avais fait des captures d’écran de toutes les scènes des Gens de la pluie où elle se maquille. Tu vois le plan avec James Caan ?
Elle est en triptyque, sous trois angles différents, et lui à droite, de face, flou à l’arrière-plan

Capture d’écran « Les Gens de la pluie » de Francis Ford Coppola, édition Warner
Quel plan de malade ! C’est tellement bizarrement cadré, et hop, ils dansent et il la porte. Je voulais des scènes où Clarisse se maquille, comme dans le film de Coppola. Mais ça a été remplacé par ses trucs de séduction, comme la scène où elle dit « tomate farcie ».
Aviez-vous pensé à être acteur dans votre film ?
Non, jamais. Ils ont trente-cinq ans, j’ai cinquante-six ans, c’est réglé. Qu’à cinquante-six ans on ait traversé des drames, en statistique de vie, c’est normal. C’était beau qu’ils soient jeunes, qu’ils soient fauchés à ce moment-là de leur vie, et ce qui est très beau à la fin, c’est qu’elle a toute sa vie devant elle.
Ce qui a été le plus dur sur ce film ?
Il y a toujours des difficultés à surpasser, comme sur chaque film…. mais c’est bien, c’est excitant ! Toujours avoir l’impression que je vais sauver ma peau et que je ne vais pas y arriver. Le plus dur ? je dirais la révélation finale. On a tourné en mai 2019 au printemps, puis après en automne en novembre 2019, et ensuite la neige fin janvier 2020. Après deux saisons, en décembre 2019, je monte et c’est là que j’ai découvert que cette histoire de révélation finale me fait vomir. Il y avait une distance, une manipulation, on n’était pas avec elle : on observait, on se posait trop de questions. Le plus dur était que le fait de se poser des questions ne nous épuise pas, ne nous éloigne pas de ce que vous disiez, d’être tout à coup absolument bouleversé sur les montagnes russes. Le scénario avait été écrit avec la révélation finale, comme dans le texte de Galea. Comment allais-je pouvoir donc transformer des images qui n’avaient pas été tournées pour ça ? C’est lorsqu’on a déplacé la première scène des sauveteurs à vingt-six minutes qu’on a trouvé la solution. Avant ça, j’ai pensé que j’avais foiré le film j’ai tout gâché, c’est mort, quel dommage, j’ai des choses extraordinaires, mais c’est un film de manipulateur, et je ne vois comment je peux le changer. Après, pendant le Covid, le film ne pouvait plus sortir, et je n’avais pas de deadline pour le finir. J’étais persuadé que les gens allaient croire que c’était une histoire de punition. C’est-à-dire qu’elle avait réellement quitté sa famille, et que pendant qu’elle s’est barrée, ils meurent. T’avais qu’à pas quitter ta famille, t’as vu ? Ils sont morts. Salope, c’est bien fait pour toi ! Ça a été une obsession : comment faire pour que le départ du début soit bien intégré ensuite à son imaginaire ? D’où le fait que j’ai rajouté énormément de voix, qui donnent des cairns, des blocs de réalité, le plus souvent possible, pour que les spectateurs, après avoir remis les pieds sur terre de la réalité, repartent dans son délire avec elle. Que ce soit évidemment, au bout d’un moment – ça peut être à n’importe quel moment du film, certains comprennent tout de suite, d’autres plus tard et ce n’est pas grave -, il fallait qu’en sortant du film on ait intégré absolument que cette femme n’a pas quitté, jamais, sa famille. Tu me demandes ce qui a été le plus dur… ça a été une horreur ! Tu peux demander à Laetitia [NDLR : Laetitia Gonzalez, productrice du film avec sa société Les Films du Poisson, était dans la pièce à côté] : les ai rendues dingues ! « non, il n’est pas fini le film, c’est pas possible, c’est de la merde, on croit que c’est une punition, et c’est l’inverse ! Moi ce qui me plaît, c’est l’imagination, et là, c’est une histoire religieuse d’une femme qui est punie. C’est ça qu’on croit, vous me dîtes que non, mais vous connaissez l’histoire, vous vous gourez, c’est pour ça que vous ne le voyez pas » Rendues din-gues ! Je montrais le film à des gens qui ne savaient rien de l’histoire, pour vérifier. Je suis même allé jusqu’à faire des screen tests. Au Luxy à Ivry-sur-Seine, dirigé par Jean-Jacques Ruttner, qui a longtemps été exploitant à Pau. C’est comme le Régent à Saint Gaudens, ou l’American Cosmograph ici : ces gens sont des héros. Le Luxy faisait partie des vingt-deux cinémas qui ont rouvert un dimanche 14 mars 2020, alors que tous les cinémas en France étaient fermés à cause de la pandémie. J’ai demandé si je pouvais faire une projection-test, et il a accepté, puisque c’était pour raison professionnelle : la production a besoin d’une screen test, on a légalement le droit de projeter le film. J’ai demandé à Jean-Jacques de ne pas leur dire le film que les spectateurs aillaient voir, de leur dire de venir un stylo et une feuille de papier. Ils regardent le film, et tout de suite, je leur pose deux questions, je ramasse les feuilles, et après, on commence le débat. Je voulais savoir s’ils pensaient qu’elle était partie pour de vrai, ou pour de faux. Et c’était bon. J’ai gardé les cent-huit feuilles, parce que c’est bouleversant. J’ai eu comme réponse « on a tellement aimé le film qu’on s’en fout, où est le problème ? » Mon obsession qu’on croit qu’elle recevait une punition s’est arrêtée à ce jour-là

De quoi êtes-vous le plus fier ?
Quelle jolie question. De quoi je suis fier… De cette complicité quotidienne dans les yeux des techniciens et des acteurs… De faire tout ça ensemble… Allez, je me refous à chialer, mais c’est tellement beau ce qu’on a vécu, tu ne peux pas l’imaginer. Là, tu vois, Vicky m’écrit… Un truc s’est passé, et ça continue. Et comme ça s’est passé sur trois temps de tournage, avec la vie de chacun. Quelqu’un qui perd son père, quelqu’un qui a une naissance, quelqu’un qui s’est séparé, mais on se retrouve : la vie continuait entre ses tournages. Ça nourrissait le film… Ça donne envie de continuer de faire des films.
 Serre moi fort, de Mathieu Amalric, en salles le 8 septembre
Serre moi fort, de Mathieu Amalric, en salles le 8 septembre
le dossier de presse
CANNES PREMIERE • FESTIVAL DE CANNES 2021
Je reviens de loin, de Claudine Galea aux aux Éditions Espaces 34, de nouveau disponible en librairie, édition 2021 revue et corrigée.
Immense merci à Mathieu Amalric pour sa générostié et l’autorisation d’utiliser ses photos.
Merci à Gina Taupenot, Katia Merhar, et l’American Cosmograph pour votre confiance.
Merci aux Editions Espaces 34 pour m’avoir permis de travailler dans les meilleures conditions.
Merci au Grand’Hôtel de l’Opéra pour la jouissance du bar.
Pour l’utilisation des photos non libres de droit, contactez l’auteur.
