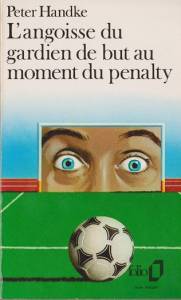 On connaît souvent Peter Handke par le seul titre de l’un de ses livres (et l’adaptation qui en a été faite par le cinéaste Wim Wenders) : L’angoisse du gardien de but au moment du penalty. Dans ce roman, un ancien goal du nom de Bloch qui vient de perdre son boulot de monteur sur un chantier va voir un film au cinéma puis étrangle la caissière dans un hôtel, sans raison précise, après quoi il rencontre des gens bruyants et se bagarre dans une auberge. Enfin, il se retrouve au stade pour assister à un match de football.
On connaît souvent Peter Handke par le seul titre de l’un de ses livres (et l’adaptation qui en a été faite par le cinéaste Wim Wenders) : L’angoisse du gardien de but au moment du penalty. Dans ce roman, un ancien goal du nom de Bloch qui vient de perdre son boulot de monteur sur un chantier va voir un film au cinéma puis étrangle la caissière dans un hôtel, sans raison précise, après quoi il rencontre des gens bruyants et se bagarre dans une auberge. Enfin, il se retrouve au stade pour assister à un match de football.
C’est là que Peter Handke écrit :
« Les joueurs crient beaucoup trop, dit Bloch. Un bon match se joue en silence. »
Autrichien « renégat » installé en France depuis longtemps, Handke a publié des romans un peu glaçants, des essais sur la fatigue ou le jukebox et du théâtre non conventionnel. L’heure où nous ne savions rien l’un de l’autre est une pièce bouche cousue, avec des images. L’auteur mentionne : un spectacle (pour une douzaine d’acteurs et d’amateurs).

La scène est une place ouverte dans une lumière claire.
Pour commencer, il y en a un qui s’enfuit rapidement.
Ensuite, venu de la direction opposée, un second.
Ensuite, deux, se croisant, chacun suivi, à courte, invariable, distance d’un troisième et d’un quatrième, dans la diagonale.
Pause.
Il franchit la place à son pas, en fond de scène.
Tout à sa marche, il ouvre et il écarte continûment les doigts, étire et lève lentement les bras, jusqu’à les refermer en arc au-dessus de sa tête et, avec cette nonchalance qu’il met flâner sur la place, il les laisse retomber.
Peter Handke, L’Heure où nous ne savions rien l’un de l’autre, traduit de l’allemand par Bruno Bayen, L’Arche, 1988.
Aucun dialogue, aucune parole dans la suite qui se développe sous la forme de didascalies plus ou moins brèves et énigmatiques, valant parfois poème comme dans la description de la place où se déroule l’action. Le metteur en scène qui souhaite s’attaquer à la pièce trouve des consignes sur la lumière, le décor sonore, les bruits de la nature et de la ville, les accessoires, la caractérisation des nombreux personnages, leurs postures et mimiques, les métamorphoses, le rythme qui ralentit jusqu’à créer une sorte de rêve partagé puis nous en extirpe.
Mais Peter Handke et la servilité, ça fait deux, et son texte devrait être une « coproduction » entre lui, le metteur en scène, éventuellement les gens sur le plateau, et bien sûr les spectateurs.
L’espace public dans l’espace et le temps devient un ballet, et grouillent les êtres humains, ces phénomènes.
Il y a aussi une dédicace : « pour S. »
« Peter Handke a dit qu’il avait écrit L’Heure où nous ne savions rien l’un de l’autre durant les mois précédant la naissance de sa fille. Un peu comme pour lui parler de ce monde dans lequel elle allait naître. Et si je devais dire à quelqu’un comment est ce monde ou, plus précisément, le monde des humains, que lui dirais-je ? Que diraient les acteurs ? Que diraient les autres collaborateurs ? Et, au théâtre, serait-ce un drame, une comédie, une tragédie ? Ou une grande danse ? Essayer de dire, c’est essayer de comprendre. »
Ce paragraphe est de Mladen Materic, qui présente ainsi son nouveau travail. Le meneur de jeu du Théâtre Tattoo et d’un art souvent sans parole adapte le texte de Handke en le transportant en Bosnie, son pays (il est serbe), toute une histoire par épisodes, plus ou moins tragiques. Le temps d’un spectacle, « alléger le poids de la vie. »
Mladen Materic et Peter Handke se connaissent ; ils ont travaillé ensemble sur La cuisine, dans ce même théâtre Garonne qui a accueilli jadis les artistes de Sarajevo. C’était un « petit théâtre du quotidien » avec des trouvailles visuelles, du burlesque et des acrobaties.
Je lis ailleurs, à propos de L’heure… : « Comme Ivo Andric l’avait fait avec son Pont sur la Drina, Mladen Materic déroule le temps autour de cette place, qu’il ancre en République serbe de Bosnie ; convoque son histoire personnelle, fait défiler les guerres et changer les mœurs. Avec poésie, cet échantillon d’humanité mêle ses trajectoires à la lumière des remous de l’Histoire européenne. Sur le plateau, vingt comédiens du théâtre (National de République serbe) de Banja Luka, se font archétypes et racontent ce monde par le simple mouvement des corps. Le Théâtre Tattoo compose ainsi une pièce sensible et vivante où chacun peut tout à la fois lire son histoire, grande ou petite, et imaginer celle des autres. »
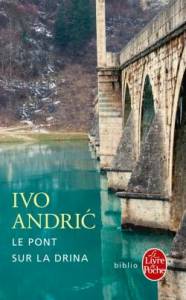 C’est la référence au Pont sur la Drina qui m’intrigue.
C’est la référence au Pont sur la Drina qui m’intrigue.
Le roman foisonnant de Ivo Andric (1892-1975), écrivain de langue serbe et Nobel de littérature, raconte l’histoire d’une petite ville pluri-ethnique de Bosnie du XVIe siècle jusqu’à la Première Guerre mondiale. Les conflits entre musulmans, Serbes et juifs, « les premières rêveries amoureuses, les premières œillades furtives, les railleries et les conciliabules », tournent autour du vénérable pont, dessous, dessus, à côté, à chaque bout.
Dans une édition du Monde de juillet 2012, nous trouvons la confirmation qu’Emir Kusturica, qui, si on en croit ses dossiers, est en affaire avec le chef des Serbes de Bosnie (Dodik) et ne cache pas son amitié pour Poutine, Kusturica donc, lui aussi éprouve depuis bien longtemps de la fascination pour le roman d’Andric : « La date n’était pas choisie au hasard : le 28 juin dernier, date anniversaire de la bataille du Champ des merles, mythe fondateur de l’identité serbe, Emir Kusturica inaugurait le dernier-né de ses projets. Le réalisateur d’Underground, Chat noir chat blanc ou La Vie est un miracle, célèbre pour ne reculer devant aucune folie, dévoilait les premières pierres d’Andricgrad, une ville entière sortie de terre en moins d’un an. (…) Première raison d’être de ce projet pharaonique : offrir un décor plus vrai que nature à l’adaptation cinématographique du Pont sur la Drina. »
Le film n’a pas été tourné et Kusturica dirige à présent Monica Belluci dans The Milky Way, un film qui devrait sortir au prochain festival de Cannes. Mais le décor de la « ville d’Andric », construit de 2011 à 2014 aux abords de Višegrad dans l’entité serbe de Bosnie-Herzégovine, autour du pont sur la rivière Drina où furent jetés des civils égorgés pendant la guerre, reste planté là, comme un musée ou un « Disneyland balkanique. »
 Sur kustu.com, on nous dit que l’endroit est aussi appelé « Kamengrad » (le village de pierre), qu’à terme on y trouvera des lieux de culture et que l’inauguration officielle a eu lieu le 28 juin 2014, « précisément 100 ans après l’attentat de Gavrilo Princip. » Dit comme ça, c’est curieux : Princip est l’étudiant serbe de Bosnie, « nationaliste yougoslave », qui assassina à Sarajevo l’archiduc François-Ferdinand et son épouse, ce qu’on considère dans les cours d’histoire comme le déclenchement de la Grande Guerre et de la boucherie mondiale.
Sur kustu.com, on nous dit que l’endroit est aussi appelé « Kamengrad » (le village de pierre), qu’à terme on y trouvera des lieux de culture et que l’inauguration officielle a eu lieu le 28 juin 2014, « précisément 100 ans après l’attentat de Gavrilo Princip. » Dit comme ça, c’est curieux : Princip est l’étudiant serbe de Bosnie, « nationaliste yougoslave », qui assassina à Sarajevo l’archiduc François-Ferdinand et son épouse, ce qu’on considère dans les cours d’histoire comme le déclenchement de la Grande Guerre et de la boucherie mondiale.
(Un Pont sur la Drina est aussi un documentaire belge de 2005 réalisé par Xavier Lukomski. On y retrouve Višegrad et son pont légendaire et littéraire, construit au XVIe siècle par les Ottomans, et « quatre siècles de l’histoire d’une ville, mais aussi quatre siècles de l’histoire de la Bosnie, donc de l’Europe. »)

Pendant la guerre en Yougoslavie, Peter Handke s’est senti slave et a sauté sur la scène médiatique comme un épouvantail. En 1991, il prend position contre l’indépendance de la Slovénie, le pays de sa mère (qui s’est suicidée en 1971, à 51 ans – Le malheur indifférent). En 1996, il apporte inconditionnellement son soutien au peuple serbe, quitte l’Église catholique dont la position lui hérisse le poil et déclare que « L’OTAN est désormais parvenue à un nouvel Auschwitz »(Interview au quotidien allemand Sueddeutsche Zeitung). A une ou deux reprises, il a enfoncé le clou de manière inquiétante.
Dans un numéro de Vanity Fair paru en 2014 et consultable sur le Web, le reporter Joshua Levine signe un ébouriffant portrait de « l’ogre » Kusturica, « Bosniaque musulman devenu Serbe orthodoxe » (« Au coeur des ténèbres »), de ses réalisations, états d’âme et emportements, et d’un pays tribal aux « administrations corrompues et incompétentes ». Levine raconte : « Aujourd’hui, beaucoup en ont assez. Ils veulent se libérer du corset des religions et retrouver une vie normale. Quand j’étais à Sarajevo, en 2014, des manifestants affichaient leur ras-le-bol dans les rues. Sur leurs pancartes, on pouvait lire : « Je suis un Esquimau. » Ou : « Je suis un pingouin. » »
Quant à Mladen Materic, avec cet air las et ce calme un peu triste que je lui ai toujours vus mais je ne le connais pas si bien, il a dit les choses d’un point de vue délicat, en faisant des pièces pleines de poésie (mais pas niaises). Il est de là-bas.

 Quand j’examine tout ça, j’ai la tête qui tourne et je repense à la nausée que je ressentais dans les années 90 en voyant les photos de la guerre des Balkans et en lisant le récit des journalistes sur place ; j’essayais de comprendre ce déchaînement de violence, cet incendie génocidaire de l’autre côté de l’Italie, dans cette contrée mystérieuse et étrangère qui m’avait évoqué jusque-là le sceptre d’Ottokar et me faisait penser à mes amis communistes joyeux qui allaient y passer leur vacances avant le chaos sans Tito ; je n’arrêtais pas de dire qu’il suffisait d’une étincelle, ici aussi, pour rallumer les bûchers, qu’il y avait des méchants, des fous, des innocents et des victimes de tous les côtés ; j’en ai même fait un modeste recueil dont les premières pages me paraissent maintenant écrites par un autre :
Quand j’examine tout ça, j’ai la tête qui tourne et je repense à la nausée que je ressentais dans les années 90 en voyant les photos de la guerre des Balkans et en lisant le récit des journalistes sur place ; j’essayais de comprendre ce déchaînement de violence, cet incendie génocidaire de l’autre côté de l’Italie, dans cette contrée mystérieuse et étrangère qui m’avait évoqué jusque-là le sceptre d’Ottokar et me faisait penser à mes amis communistes joyeux qui allaient y passer leur vacances avant le chaos sans Tito ; je n’arrêtais pas de dire qu’il suffisait d’une étincelle, ici aussi, pour rallumer les bûchers, qu’il y avait des méchants, des fous, des innocents et des victimes de tous les côtés ; j’en ai même fait un modeste recueil dont les premières pages me paraissent maintenant écrites par un autre :
Mais voici de vraies bonnes lectures :
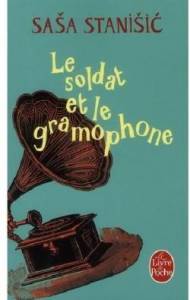 Sara Stanisic Le soldat et le gramophone : « Si je parlais de ce monde et de cette époque, il me faudrait ensuite promettre de ne plus le faire durant les dix prochaines années. Je commencerais ainsi : Les mères venaient tout juste de nous appeler pour le dîner en chuchotant, et des soldats prenaient l’immeuble d’assaut, ils ont demandé ce qu’on mangeait, et ils se sont attablés à côté de nous autour des tables en agglo installées dans la cave. »
Sara Stanisic Le soldat et le gramophone : « Si je parlais de ce monde et de cette époque, il me faudrait ensuite promettre de ne plus le faire durant les dix prochaines années. Je commencerais ainsi : Les mères venaient tout juste de nous appeler pour le dîner en chuchotant, et des soldats prenaient l’immeuble d’assaut, ils ont demandé ce qu’on mangeait, et ils se sont attablés à côté de nous autour des tables en agglo installées dans la cave. »
 Miljenko Jergovic Le jardinier de Sarajevo : « Peut-être ne sommes-nous encore qu’un sac de chair vive qui se nourrit de tristesse, de la nostalgie des petites choses oubliées, et qui, devant les événements importants de l’existence, tressaute comme un moteur sur le point de s’éteindre. »
Miljenko Jergovic Le jardinier de Sarajevo : « Peut-être ne sommes-nous encore qu’un sac de chair vive qui se nourrit de tristesse, de la nostalgie des petites choses oubliées, et qui, devant les événements importants de l’existence, tressaute comme un moteur sur le point de s’éteindre. »
Nous nous sommes éloignés du sujet, on dirait, mais peut-être pas tant que ça.
A voir la bande-annonce du spectacle que Materic a tiré de Handke, qui tourne en France depuis quelques temps et qui est programmé au théâtre Garonne en novembre, il y a moyen de s’en sortir : en souriant devant le ballet des gens costumés dans un décor de marionnettes, en déclarant à notre tour qu’il y en a marre d’avoir à choisir son camp parmi des factions qui nous pourrissent la vie, d’être des ceci ou des cela, ce qui nous jette les uns contre les autres, en brandissant une pancarte où nous déclarons être des pingouins.
 L’heure où nous ne savions rien l’un de l’autre
L’heure où nous ne savions rien l’un de l’autre
d’après Peter Handke
Un spectacle de Mladen Materic
Théâtre Tattoo, Théâtre national de Banja Luka
Au théâtre Garonne du 03 au 05 novembre
http://www.theatregaronne.com/
