40ème Chorégies d’Orange – Représentations des 9 et 12 juillet
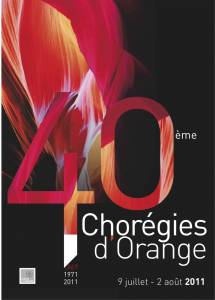 Avant tout propos, citons Giuseppe Verdi dans une lettre datée du 17 avril 1872 : « …Moi, je voudrais que le public juge sur un plan plus élevé, qu’il ne se laisse pas influencer par les misérables avis des journalistes, des professeurs et des joueurs de piano : seule l’impression compte ! Comprenez-vous, les impressions, les impressions, rien que les impressions ! »
Avant tout propos, citons Giuseppe Verdi dans une lettre datée du 17 avril 1872 : « …Moi, je voudrais que le public juge sur un plan plus élevé, qu’il ne se laisse pas influencer par les misérables avis des journalistes, des professeurs et des joueurs de piano : seule l’impression compte ! Comprenez-vous, les impressions, les impressions, rien que les impressions ! »
Pour plus de 99% des spectateurs festivaliers surtout, l’œuvre donnée au Caire en 1871, deux ans après l’ouverture du canal de Suez, est un grand spectacle, un formidable déploiement de figurants, une succession de tableaux historiques, éléphants, chameaux et esclaves enchaînés compris. Sans oublier les fameuses trompettes d’Aïda, les trompettes les plus fameuses au monde, en la et en si, spécialement fabriquées alors pour la scène de la marche triomphale, glorieuses sonneries de cuivres rutilants parfaitement alignés. Bercy, le Stade de France, les Arènes de Vérone, oui, Orange, à la rigueur, le Théâtre du Capitole ? impossible, trop petit !
Mais le malentendu est somme toute total, car hormis quelques scènes, Aïda est plutôt un opéra tirant vers l’intimisme que vers le grandiloquent permanent. Pour les protagonistes principaux, les scènes les plus remarquables sont des airs ou des duos chantés dans l’intimité, même les affrontements brûlants de jalousie, sans oublier la scène finale qui se résume à l’univers clos d’un tombeau.
D’où la difficulté de concilier ces fameuses grandes scènes avec chœurs, figurants, et danseurs, et celles plus intimistes, quand l’espace offert correspond à celui du plateau qui s’offre sur toute la longueur de l’immense mur du Théâtre antique d’Orange.
Le metteur en scène marseillais Charles Roubaud connaît son Mur, et cet Aïda est une reprise de sa production de 2006. S’il est un pari de gagné, c’est bien celui du grandiloquent mais sans faute de goût. Pas de nombreux éléments imposants de décor pour occuper à tout prix l’espace disponible, et une transposition au XIXè qui n’a rien de redoutable. Cependant, on remarque des vidéos n’apportant rien de plus, et des ballets remplacés par une sorte de “saga africa“ à la Yannick Noah qui a plus masqué, par les bruyantes prises d’appui au sol, les délicatesses de la musique, qu’amené la révolution dans l’esthétique de ce passage dansé obligé de l’opéra.
Avec beaucoup de grâce dans sa direction, un quelque chose de voluptueux dans la gestuelle, Tugan Sokhiev sait nous révéler toutes les subtilités de la musique de Giuseppe Verdi, et nous prouve qu’Aïda, ce n’est pas uniquement les trompettes mais aussi une grande recherche dans la composition, jusque dans l’impression d’exotisme de certains passages qu’il s’est plus à signaler au maximum.
Voix bien claire, semblant fatiguée, de la soprano, en tout cas, se révélant insuffisante pour la dimension du théâtre, mais qui aura permis dans le fameux air du Nil, d’apprécier à sa juste valeur la moindre intervention du hautbois de Christian Fougeroux, tout comme ailleurs, celles des flûtes enivrées par les parfums d’Orient de Florence Fourcassié, Francis Laurent et Claude Roubichou.
Rude tâche pour Radamès qui s’est retrouvé la voix un peu dépassée par le lieu, lieu qui a véritablement semblé ne convenir qu’à l’Amonasro d’Andrezj Dobber et au Ramfis de Giacomo Prestia, justement les deux personnages qui suivent sans faillir leur ligne de conduite. Dans Amneris, la mezzo Ekaterina Gubanova a évité le piège de l’amoureuse éconduite hystérique, trop souvent transformée en une véritable furie n’admettant pas sa défaite. Dépitée, la jalousie et la haine la dominent, tout cela exprimé par du beau chant.
Au bilan, et comme le souhaitait Verdi, des impressions, sur bien des points, satisfaisantes pour ce spectacle donné dans ce lieu toujours aussi enchanteur.
Michel Grialou
