Parmi les cadeaux immanquables en cette fin d’année figurent les livres consacrés au cinéma. Trois d’entre eux sont hautement recommandables : « My name is Orson Welles », catalogue de l’exposition organisée en ce moment à la Cinémathèque française ; « Dans le Cercle rouge », journal de tournage du film de Jean-Pierre Melville par Bernard Stora et « Les 101 films qu’il faut avoir vus avant la fin du monde » du critique (et collaborateur de Culture 31) Christian Authier.
Toutes les vies d’Orson Welles
Programmée jusqu’au 11 janvier à la Cinémathèque française, à Paris, l’exposition « My name is Orson Welles » impressionne par sa densité. Elle couvre en effet tout ce que le prodigieux artiste américain, né en 1915, mort en 1985, a pu réaliser – et tout ce qui n’a jamais abouti – comme réalisateur, bien sûr, mais aussi comme comédien, directeur de troupe théâtrale ou homme de radio (avec, notamment, en 1938, l’adaptation hyperréaliste et terrifiante de « La guerre des mondes », d’H. G. Wells, faisant croire à l’invasion de martiens). Impossible sur place de rentrer dans le détail des cartels, le catalogue devenant un outil indispensable pour approfondir le sujet. Et découvrir un extraordinaire créateur, largement torpillé par le système hollywoodien, et qui dût se tourner vers l’Europe pour tenter de faire aboutir de nombreux projets.

Orson Welles et Rita Hayworth dans « La dame de Shanghai » (1947). Photo Cinémathèque Française
« Citizen Kane » (1941) occupe logiquement une place centrale dans l’ouvrage, associant textes d’époque et d’aujourd’hui et iconographie imposante. Coécrit, mis en scène et interprété par un néophyte qui obtint tous les pouvoirs, ce portrait éclaté d’un homme puissant obsédé par son « Rosebud » (la luge de son enfance) fut un échec commercial. Et un objet étrange largement incompris en son temps, par le public mais aussi par Jorge Luis Borges, Jean-Paul Sartre et tant d’autres fins esprits – ou supposés tels – mais fort heureusement défendu avec flamme par quelqu’un comme Louis Aragon.
Un accent est mis sur les maquillages imaginés par Maurice Seiderman, dans un film qui est un permanent aller-retour entre passé et présent, et la photographie novatrice de Gregg Toland, qui parvient à rendre nets très gros plans et vues d’ensemble dans une même image (une prouesse avec le matériel d’alors). Les autres films d’Orson Welles sont évidemment traités, de « La splendeur des Amberson » (1942), remonté et abimé par le studio RKO, aux expérimentations comme « Vérités et mensonges » (1975), sans oublier « La dame de Shanghaï » (1947) et les adaptations de Shakespeare (« Macbeth », « Othello », « Falstaff »), auquel Welles vouait une admiration sans bornes. Plus un regard sur l’acteur multiforme qui courait le cachet pour financer ses propres films, enchaînant chefs-d’œuvre (dont le magistral « Troisième homme » de Carol Reed, en 1950) et d’improbables navets.

Orson Welles au Festival de Cannes en 1988. Photo Xavier Lambours
Un entretien de 1960 diffusé par la BBC et retranscrit dans le catalogue permet de mieux cerner ce diable d’homme que fut Orson Welles. Il dit « détester les journalistes et les interviews », trouvant « que ce qu’affirment (ses) collègues à propos de leur meilleur création est assez prétentieux et ennuyeux » ; estime que « le premier devoir du conteur consiste à privilégier toujours l’histoire », au-delà du « document sociologique » que peut être un film ; s’amuse de la confiance qu’il avait à ses débuts de cinéaste, liée à son « ignorance absolue » ; se moque du « baratin minable, tellement simpliste et dénué d’intérêt, du jargon des gens des ciné-clubs » car « ce qui compte, c’est ce qu’on transmet en utilisant cette forme (le film) ; la réalité des personnages et du monde que l’on crée ».
Cinéaste si souvent empêché, Orson Welles est poursuivi par la scoumoune même post-mortem. À la suite de l’invasion… de punaises de lit, les salles de la Cinémathèque française sont fermées jusqu’au 2 janvier, tronquant considérablement la rétrospective consacrée au metteur en scène. Fort heureusement, l’exposition reste quant à elle ouverte sans restriction jusqu’au 11 janvier. A moins que d’ici-là débarquent des extra-terrestres…
Bernard Stora raconte au jour le jour le tournage rugueux du « Cercle rouge »
On connaissait le réalisateur Bernard Stora, 83 ans, pour des films comme « Le jeune marié », « Le grand Charles » ou « Un dérangement considérable ». On ignorait qu’il fut, à ces débuts – comme c’était la règle alors – un assistant s’étant formé auprès de nombreux metteurs en scène. En 1970, il va ainsi vivre le tournage du « Cercle rouge » au plus près de Jean-Pierre Melville, durant 66 jours aussi exaltants qu’éprouvants. Bernard Stora le raconte dans un journal de bord qui est à la fois un hommage au travail d’équipe qu’est la fabrication d’un film et le portrait sans concessions d’un artiste attachant malgré son côté irascible. Melville appelle son jeune assistant « mon coco ». Il félicite rarement ses collaborateurs, animé le plus souvent par « la nostalgie, le regret, la déception ». « Nulle joie sur le plateau du Cercle rouge, écrit encore Bernard Stora. La réputation de Melville le précède, on se tient à carreau. » Le metteur en scène est « pire » que ses aînés Clouzot, Autant-Lara ou Duvivier, ces « gueulards qui semaient la terreur ». Il « distille l’angoisse et cogne sur les faibles impitoyablement ».

Jean-Pierre Melville et François Périer sur le plateau du « Cercle rouge ». Photo André Perlstein
Melville a fort heureusement de grandes qualités : il a « inventé sa propre grammaire qui, bien avant la Nouvelle vague, a bousculé les canons officiels » ; il adore tourner en cachette, au milieu des passants ou dans l’escalier d’un immeuble chic de la place Vendôme – c’est son côté joueur –, comme il le faisait à ses débuts dans des productions légères ; il donne de beaux rôles à des comédiens peu connus et sait les mêler aux vedettes avec une « intuition fantastique ». Ose des paris comme recruter un André Bourvil malade – ce sera le dernier rôle – en flic solitaire et obsessionnel, loin de ses emplois habituels. Un choix qui comptera dans le succès du film tant l’acteur apporte à son personnage une intensité rare. Quant à Bernard Stora, il découvre combien Yves Montand – qui l’appelle « fils » – est « anxieux, pétri de doutes, aussi confus que sincère (…) et travaille minutieusement ses rôles ». Et à quel point Melville « peut se montrer drôle, familier, accessible » quand le soir il invite son assistant, après la projection des rushes, dans la loge-bureau du studio de Boulogne. La nuit, le metteur en scène l’embarque parfois dans sa voiture américaine sur le périphérique au son de « Fly me to the moon », de Frank Sinatra. Ce qui ne l’empêche pas, quelques jours plus tard, d’être à nouveau « querelleur, tyrannique, odieux » à l’égard de ceux qui lui obéissent pourtant au doigt et à l’œil.

Delon, fidèle complice de Melville. Photo Jean-Pierre Fizet
Le livre de Bernard Stora, passionnant de bout en bout, est rythmé par la reproduction des feuilles de service qu’il a conservées depuis plus d’un demi-siècle. Tout y est : les scènes du jour, les lieux de tournage, les comédiens indispensables et leurs doublures, les décors et les objets qui participeront à l’action ou à l’atmosphère… Tout est calé, cadré à l’avance, pour un réalisateur qui est un maniaque du contrôle. Et pourtant, le résultat final doit beaucoup aux circonstances du jour, Melville étant « comme tous les grands cinéastes, un rusé voleur d’imprévus ». Clin d’œil affectueux d’un Bernard Stora qui nous fait partager les coulisses d’un tournage hors du commun, élaboration minutieuse d’un chef-d’œuvre qui fut aussi le plus gros succès de Jean-Pierre Melville avec plus de 4 millions d’entrées en France.
Dans la cinémathèque de Christian Authier
Des dictionnaires du cinéma, il y en a beaucoup ; des listes de chefs-d’œuvre immanquables aussi. Le Toulousain Christian Authier ajoute sa pierre à l’édifice avec « Les 101 films qu’il faut avoir vus avant la fin du monde ». Le dessin de couverture, rétro en diable, et le titre du livre sont accrocheurs. La lecture tout aussi plaisante, associant contexte historique et artistique et notations critiques. L’auteur l’écrit en postface, ce goût des listes, il l’a depuis l’adolescence quand il fréquentait la Cinémathèque de la rue Roquelaine et feu le Rex aux sièges si inconfortables ou qu’il passait de longues soirées devant la télé à fureter du côté du « Ciné-club », du « Cinéma de minuit » ou de « La dernière séance ». « Le cinéma nous a tout donné, insiste Christian Authier. Nous lui devons tant. Grâce à lui, nous avons batifolé dans la fontaine de Trevi, crapahuté sur le mont Rushmore, chanté sous la pluie, conduit un taxi à New York, respiré l’odeur du napalm au petit matin… »
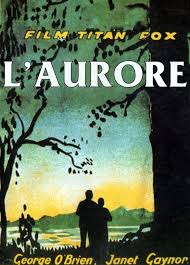
Avec son ouvrage, qui reprend en partie ses chroniques, remodelées, parues sur notre site Culture 31 (205 au compteur !), le cinéphile compulsif cherche à « dresser un état des lieux, recenser et éclairer une centaine d’œuvres indispensables, déterminantes, essentielles », comme une « invitation à la découverte autant qu’un retour aux sources ». C’est ainsi que le film muet « L’aurore », de Murnau (1927), « d’une puissance formelle exceptionnelle » côtoie « Les affranchis » de Scorsese (1990), « peinture truculente, violente, burlesque et cruelle d’une communauté de truands » ; que le largement oublié « Gare centrale », de Chahine (1958), « mêlant dimension quasi documentaire, chronique sociale, romance, comédie et drame criminel » bénéficie de la même place que le multidiffusé « Le guépard », de Visconti (1963), « œuvre à la fois solaire et crépusculaire dont la dimension funèbre est tempérée par l’éclatante beauté de la jeunesse ».
C’est tout le prix du livre de Christian Authier : assurer une égalité de traitement (soit une double page avec texte et reproduction de l’affiche – malheureusement dans un noir et blanc parfois médiocre) à des films dont le succès et la postérité sont parfois très inégaux. Et inciter le lecteur à combler ses lacunes ou à raviver ses souvenir afin de voir ou revoir des longs-métrages aussi dissemblables que « Laura », de Preminger (1944), « Les contes de la lune vague après la pluie », de Mizoguchi (1953), « Le dieu noir et le diable blond », de Rocha (1964), « Psaume rouge », de Jancso (1972), « La porte du paradis », de Cimino (1980), « Tu ne tueras point », de Kieslowski (1988) ou « Heat », de Michael Mann (1995).
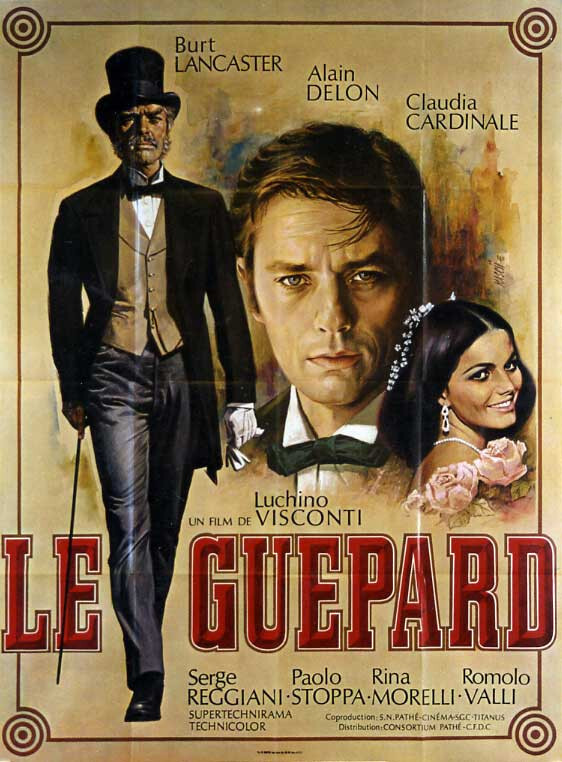
Sans oublier un Welles et un Melville, bien sûr. Pour le premier, Christian Authier a logiquement choisi « Citizen Kane » (1941), film dont « l’invention, l’audace, le génie éclaboussent chaque plan ». Quant à Melville, il a préféré « Le samouraï » (1967) au « Cercle rouge » évoqué plus haut. « Le style melvillien est ici à sa quintessence : épure, minimalisme, tentation de l’abstraction ».
Et maintenant au boulot : branchez vos lecteurs de DVD et abonnez-vous à la plateforme LaCinetek, la « cinémathèque des cinéastes », pour vérifier si vous êtes d’accord, ou pas, avec Christian Authier.
« My name is Orson Welles », sous la direction de Frédéric Bonnaud (La Table Ronde, 464 pages, 320 illustrations, 44,50 euros).
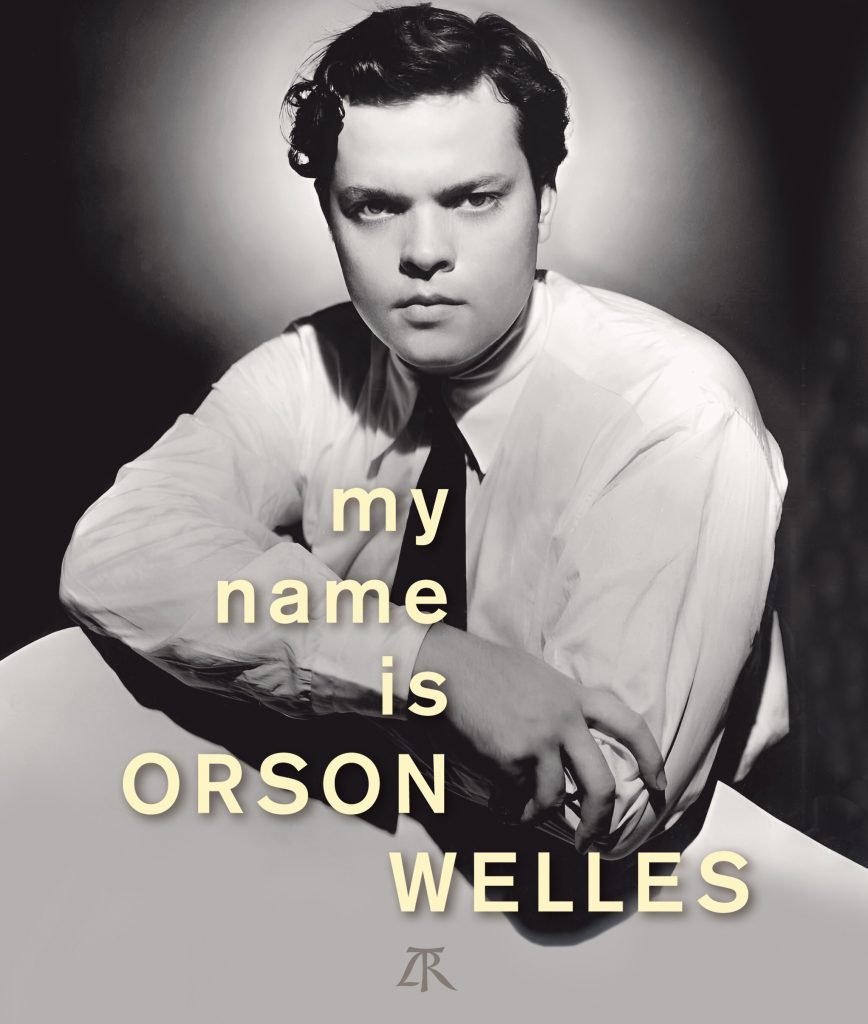
« Dans le Cercle rouge », de Bernard Stora (Denoël, 430 pages, 26 euros).

« Les 101 films qu’il faut avoir vus avant la fin du monde », de Christian Authier (Editions Télémaque, 226 pages, 14,80 euros).


