Abondance de biens ne peut nuire. L’ouvrage de Benjamin Britten bat, pour ma “pomme“, d’une courte tête Rusalka d’Antonin Dvorak, et d’un cheveu supplémentaire Tristan et Isolde. Mefistofele va-t-il modifier le classement ?

Le viol de Lucrèce © Mirco Magliocca
On peut relire mon article d’annonce et le second, mon compte-rendu des deux premières.
Le spectacle de cet opéra du compositeur britannique, si délicat à rendre sur scène, a littéralement “scotché“ les publics présents lors de la Générale et lors des quatre représentations données.
On est comme étourdi devant le résultat scénique à savoir, chaque instant tout au long des cent minutes. Étourdi devant la gestuelle de chaque intervenant, le moindre déplacement : pas une seconde ne semble laissée au hasard. Et la complicité musicale est omniprésente.

Le viol de Lucrèce © Mirco Magliocca
Rarement, et le mot est faible, on a pu ressentir une telle symbiose entre les termes du livret, la musique et tout le théâtre sur scène, décors, costumes compris.
On est admiratif des partis-pris et des résultats dans la réalisation des costumes.
On dit oui à ces quelques décors qui, peu encombrants, sont TOUT.
On loue le travail, l’étude d’Anne Delblée et son équipe : c’est un triomphe.

Le viol de Lucrèce © Mirco Magliocca
On adhère tout de suite à l’emploi des deux choreutes, véritables acteurs de l’action, aussi bien dans l’utilisation de leur physique dans une théâtralité assumée que dans celle de leur voix. Vifs applaudissements pour Marie-Laure Garnier et son compère Cyrille Dubois, à l’intonation impeccable, d’une incontestable présence scénique pouvant se permettre les pires harangues.

Le viol de Lucrèce © Mirco Magliocca
Pas facile de jeter des bouquets de fleurs en l’air dans une scène qui se veut légère, après la scène précédente qui traite de l’objet du titre de l’ouvrage. Sans sauvagerie et gesticulations dans l’approche, celle-ci se révèle bien plus glaçante encore. Dans le rôle de la vieille nourrice et de la servante, de jeu et de voix, Juliette Mars et Céline Laborie sont parfaites.

Le viol de Lucrèce © Mirco Magliocca
Encore les mêmes compliments pour les deux généraux. Britten a fait de Collatinus, Dominique Barberi, l’époux de la fidèle Lucrèce, une voix de baryton tirant vers la basse, magnifique dans sa tristesse et son incapacité de consoler son épouse. Et de Junius, disons le cocu, une voix de ténor, Philipp-Nicolas Martin, avide de pouvoir. Christophe Ghristi a trouvé les deux qui s’accordent à merveille de par leur différence. Il faut avoir l’œil…et l’oreille ! Notre Directeur musical a les deux, c’est sûr.

Le viol de Lucrèce © Mirco Magliocca
C’est un peu pareil avec Duncan Rock, le violeur que Lucia aurait bien détourné de ses sombres envies. Quelle prestance, quel jeu intelligent de sobriété pour ce rôle peu amène, quelle voix, aussi, quel costume ! et au bout, réduit à une solitude accablée, quelle déchéance.

Le viol de Lucrèce © Mirco Magliocca
Le rôle-titre, c’est Agnieska Rehlis.. C’est un rôle, là encore tout empreint de pudeur qui doit conduire le public jusqu’à son propre suicide. Avant comme après l’acte, la justesse dans le jeu est totale et la voix, sans faille, en accord. On est admiratif.

Le viol de Lucrèce © Mirco Magliocca
Vient ici en dernier, mais qui aurait pu être en premier : la musique. Bien des spectateurs garderont longtemps dans les oreilles la chevauchée de Tarquinus vers Rome, la course effrénée vers la déchéance et ce, avec treize instrumentistes dont le chef au piano ! Après, il faut plusieurs écoutes attentives pour repérer les concordances entre tel ou tel instrument et tel instant, geste, déplacement sur la scène. C’est captivant. Marius Stieghorst au piano dirigeait les douze instrumentistes de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse.
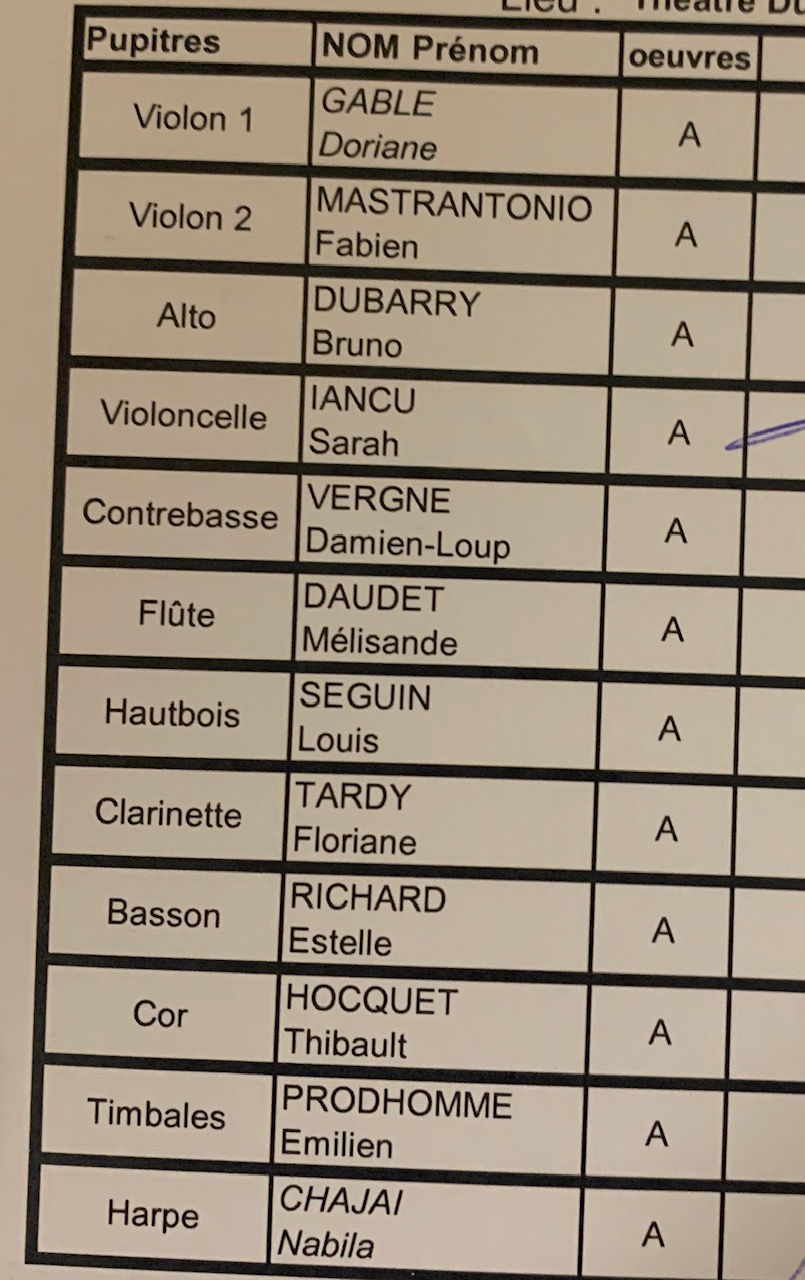
Ce fut donc, vous l’avez compris, un grand moment d’opéra.


