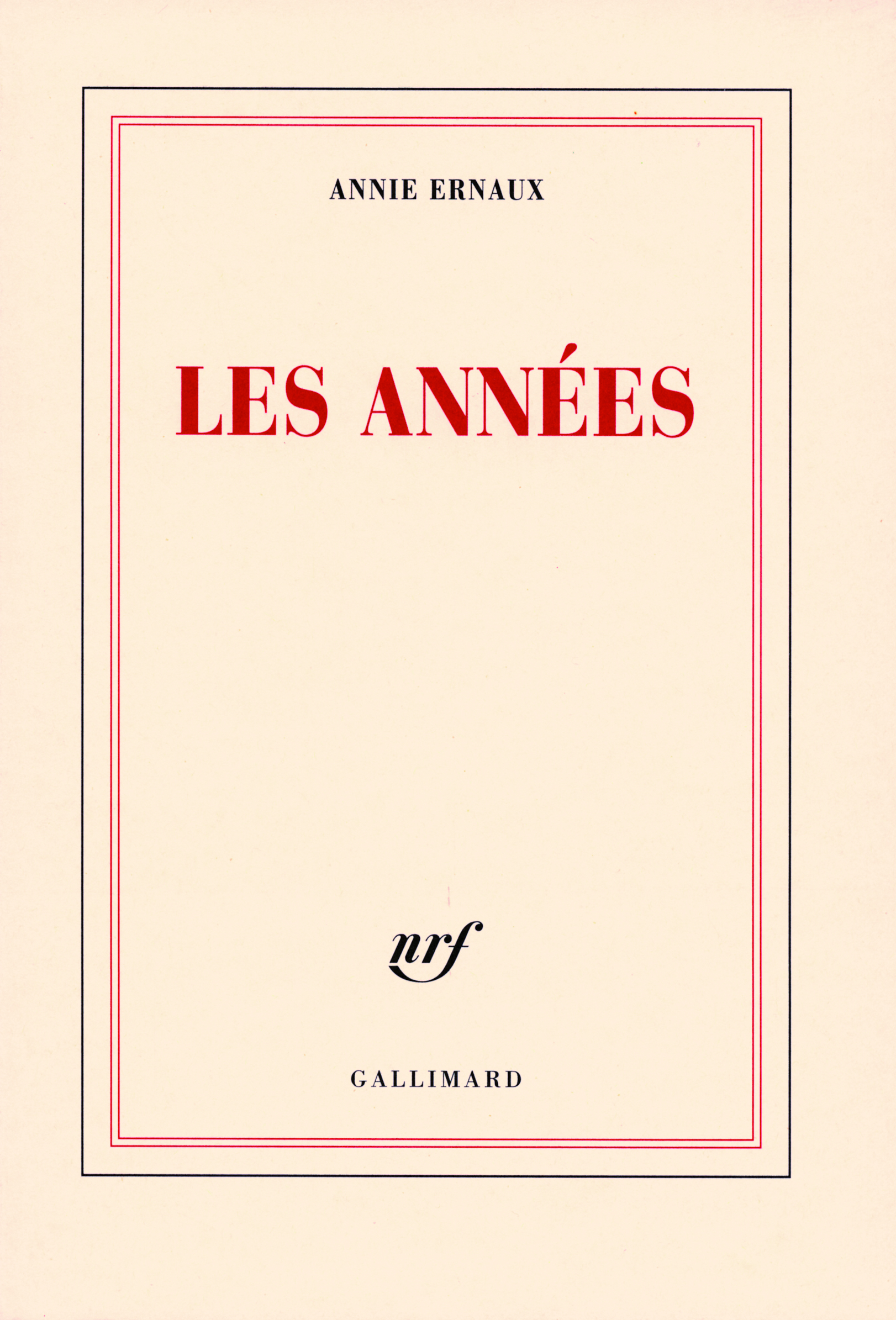Chaque semaine, on vous invite à lire une nouveauté, une réédition, un classique ou un livre injustement méconnu.
S’il ne fallait retenir qu’un titre de la récente lauréate du prix Nobel de littérature, nous choisirions Les Années, publié en 2008, un récit en forme de voyage dans le temps et la mémoire à travers notamment des photos servant de prétexte à ouvrir la malle aux souvenirs. Souvent considérée comme l’une des voix de l’autofiction, l’auteur de La Place, prix Renaudot 1984, n’emploie plus ici le « je » mais le « elle » ou le « nous ». Il s’agit ici d’écrire une « existence singulière », mais fondue dans le mouvement d’une génération, « une sorte d’autobiographie impersonnelle ».

Annie Ernaux © Francesca Mantovani / Gallimard
On suit ainsi l’existence d’une femme née en 1940 en Normandie et les échos – plus ou moins prégnants – du désordre du monde et des mutations à l’œuvre. Dans ses meilleurs moments, Les Années possède une épaisseur sociologique et historique qui n’appartient qu’aux écrivains sensibles aux petits faits vrais, aux intuitions, aux détails qui composent le vaste tableau d’une société. Par exemple, quand Ernaux évoque l’optimisme naïf de l’après-guerre et du début des Trente Glorieuses, époques où la foi dans le progrès et le monde moderne ne se discutent pas. La France des années 1950 aux années 2000 défile entre les pages, avec des arrêts sur images, des ellipses, des gros plans, des flash-backs. Mots, expressions à la mode, films, chansons, attitudes, mentalités ou slogans de publicités surgissent pour peindre de manière impressionniste et précise les motifs.
Saisir la lumière
Si le livre n’échappe pas toujours au piège des idées générales, des humeurs et des opinions qui tendent du côté de la prose journaliste, sa vérité et sa profondeur ne sont pas là, pas plus réellement que dans le tableau sociologique ou historique. C’est la quête proustienne du temps perdu qui perce chez Ernaux voulant retrouver « la mémoire de la mémoire collective dans une mémoire individuelle, rendre la dimension vécue de l’Histoire ». « Avec le numérique on épuisait la réalité », note Ernaux. Une nouvelle mémoire et des archives semblent ressurgir des écrans, mais « la profondeur du temps – dont l’odeur et le jaunissement du papier, le cornement des pages, le soulignement d’un paragraphe par une main inconnue donnaient la sensation – avait disparu. On était dans un présent infini. » Or, l’ambition de l’écrivain est de renouer avec « la patience pour les récits », de sauver « toutes les images crépusculaires des premières années, avec les flaques lumineuses d’un dimanche d’été, celles des rêves où les parents morts ressuscitent, où l’on marche sur des routes indéfinissables »,
Il convient de transformer la mémoire en littérature, de « saisir cette durée qui constitue son passage sur la terre à une époque donnée », de relier les vivants et les morts, de « saisir la lumière qui baigne des visages désormais invisibles, des nappes chargées de nourritures évanouies, cette lumière qui était déjà là dans les récits des dimanches d’enfance et n’a cessé de se déposer sur des choses aussitôt vécues, une lumière antérieure ». Rentrer dans la lumière, vivre et sauver « quelque chose du temps où l’on ne sera plus jamais ».