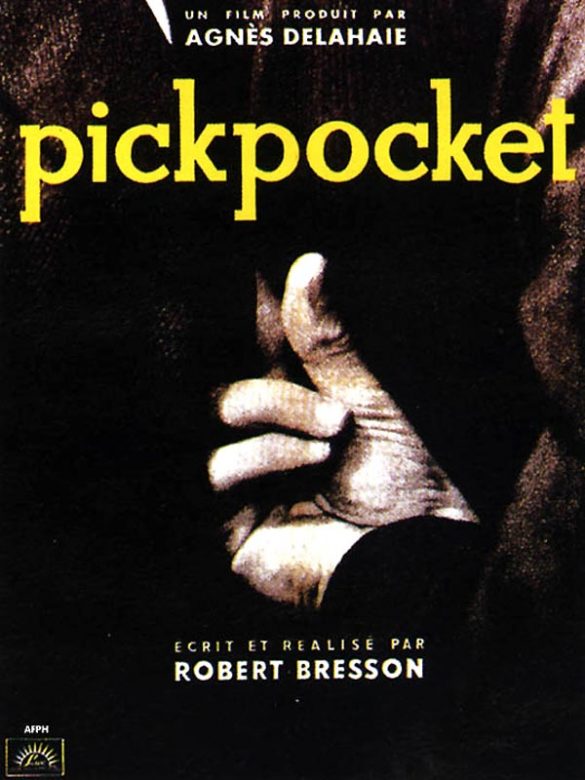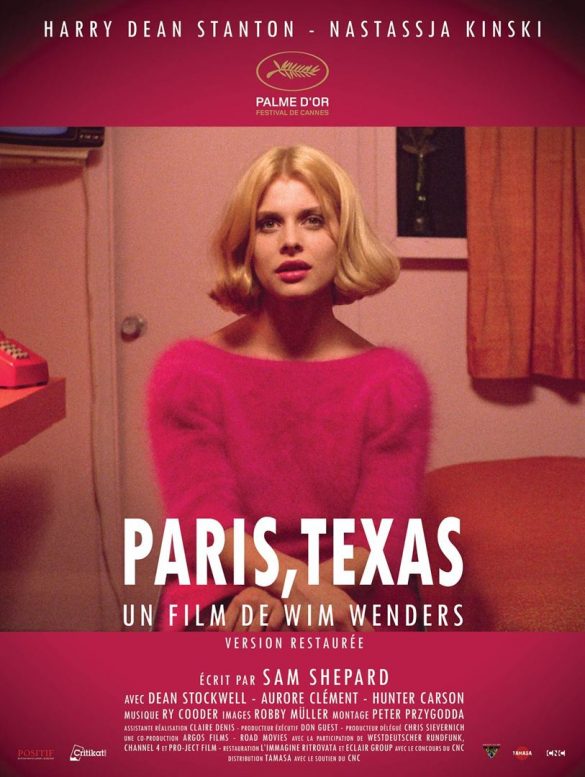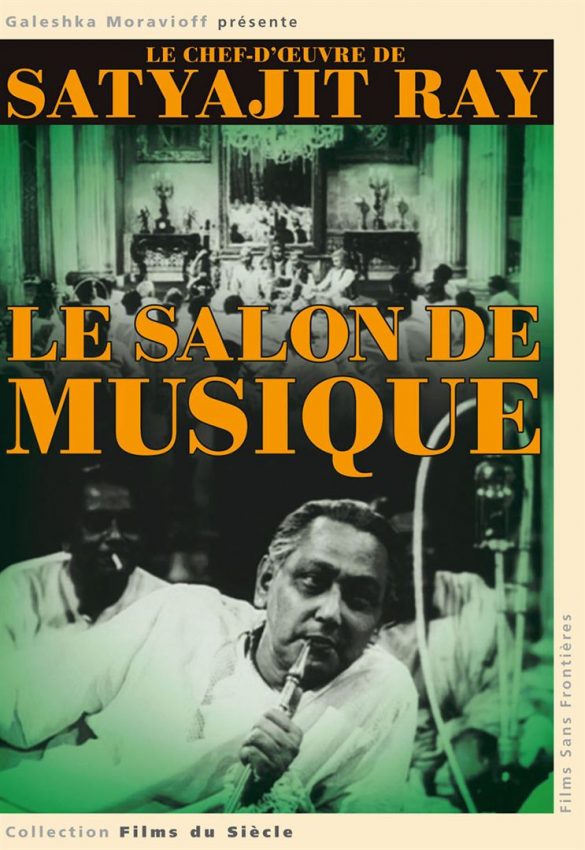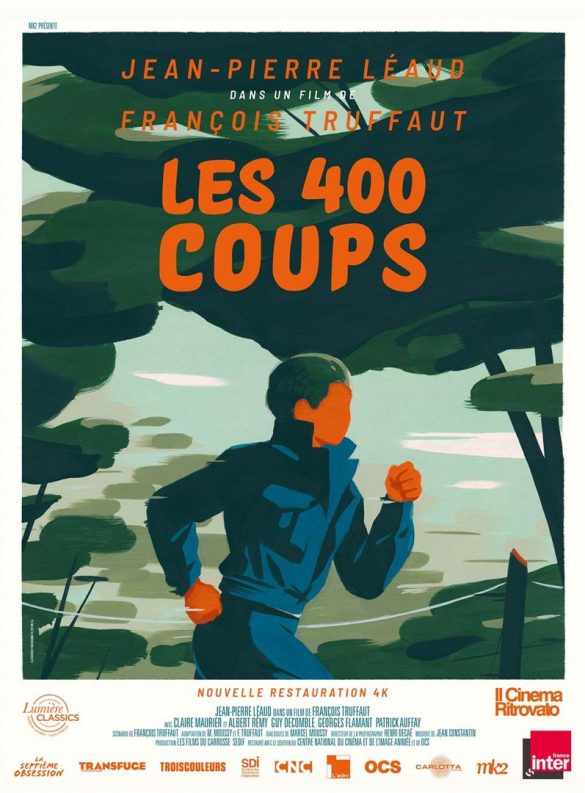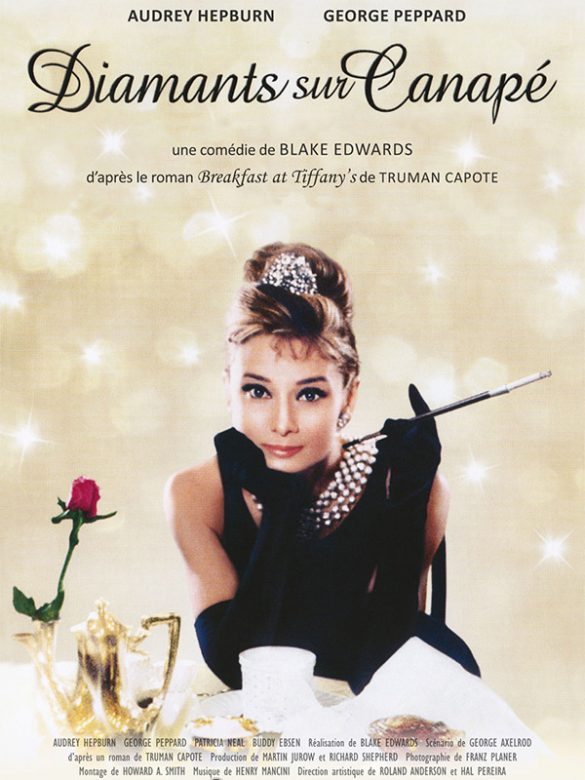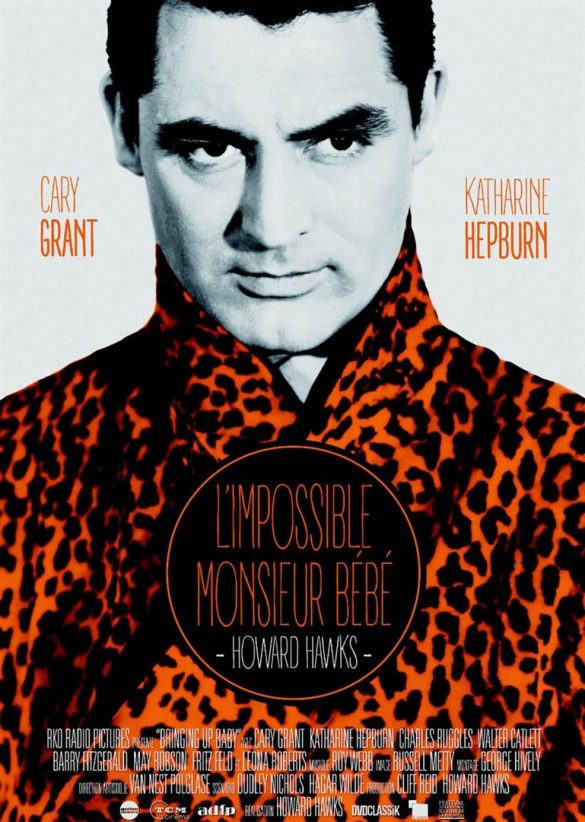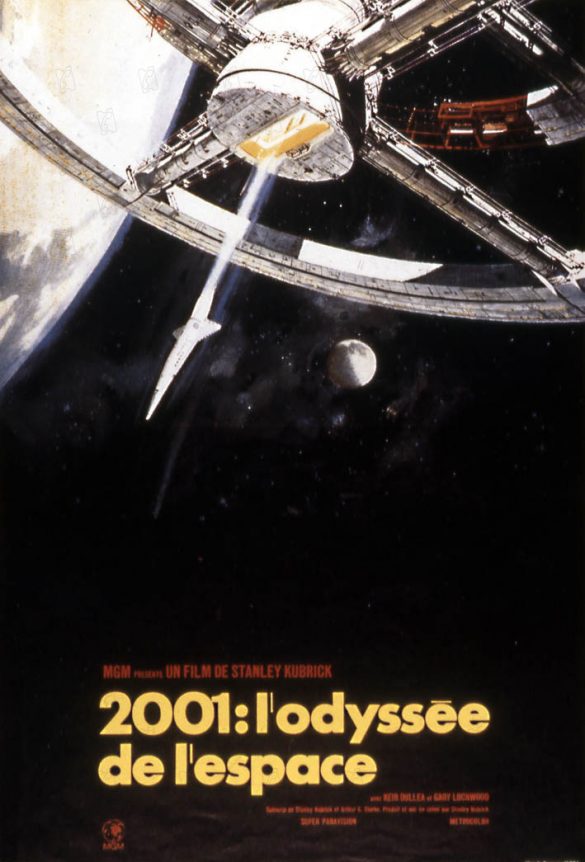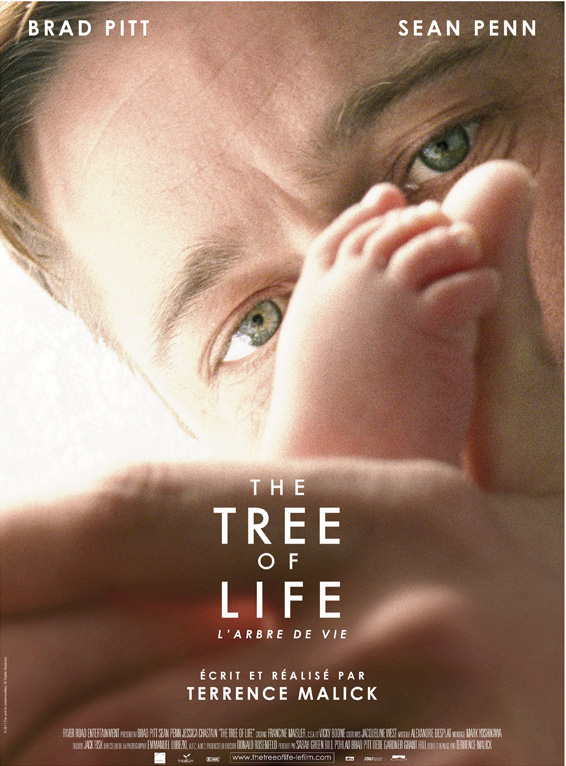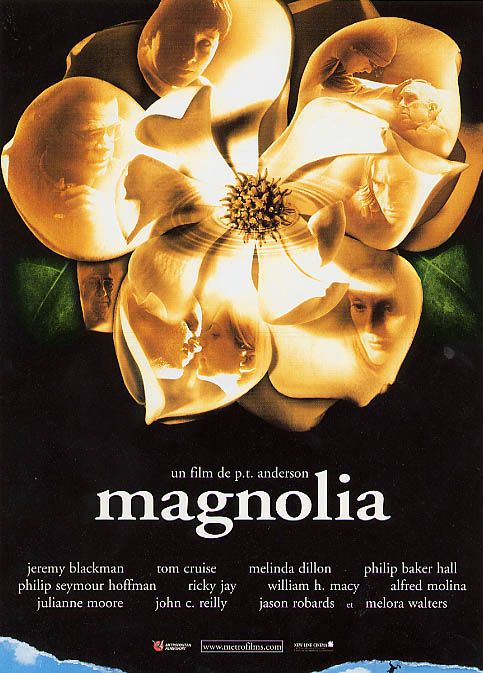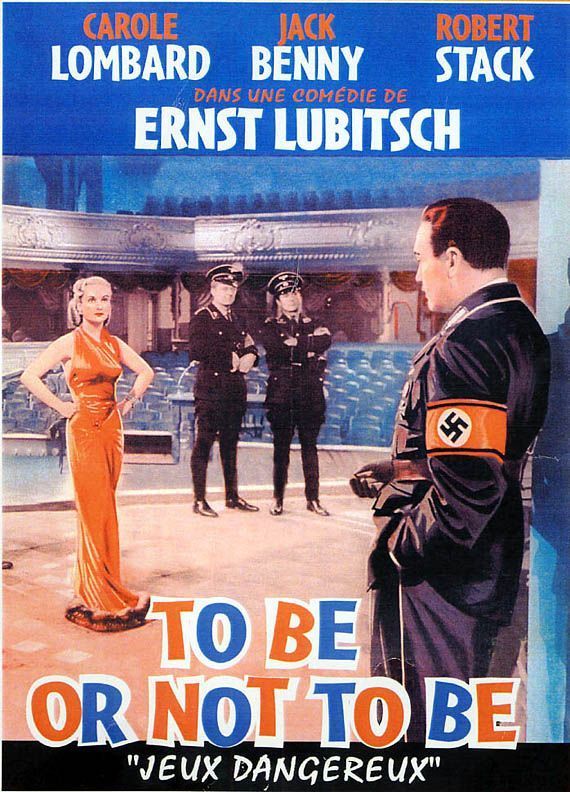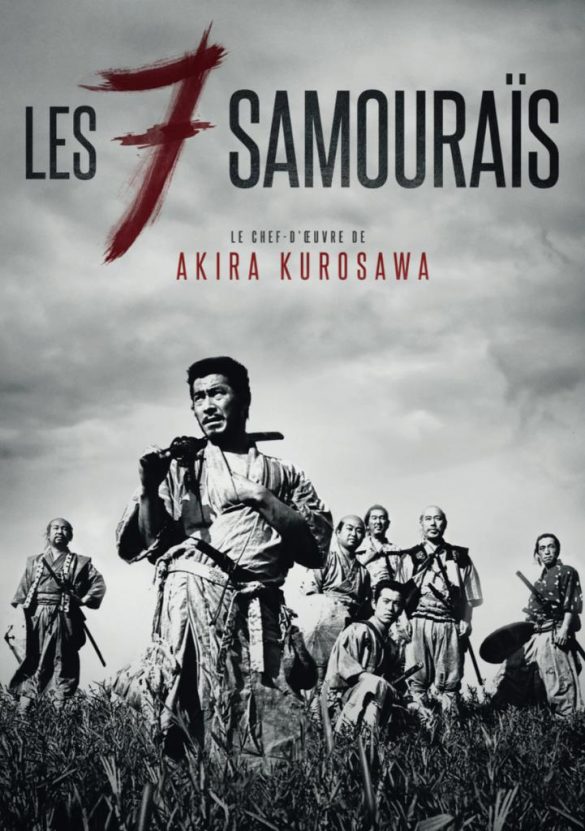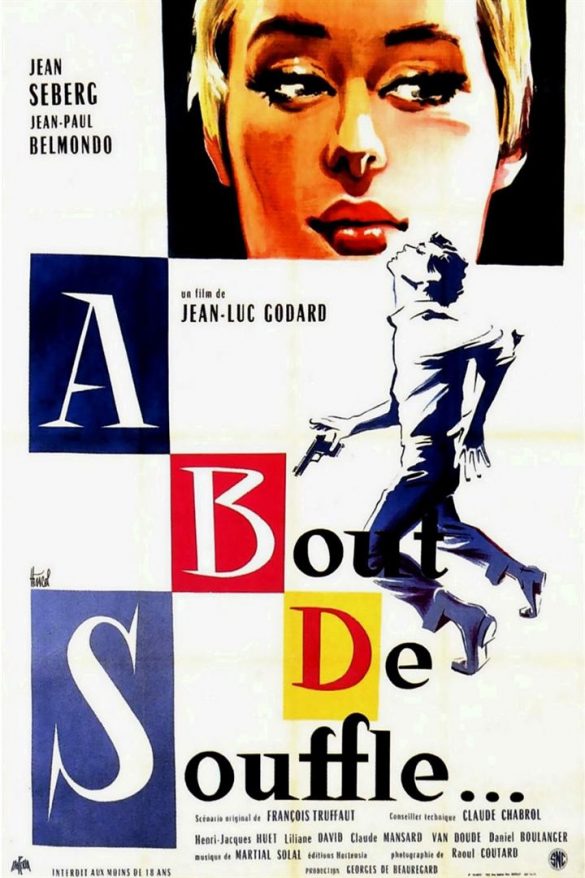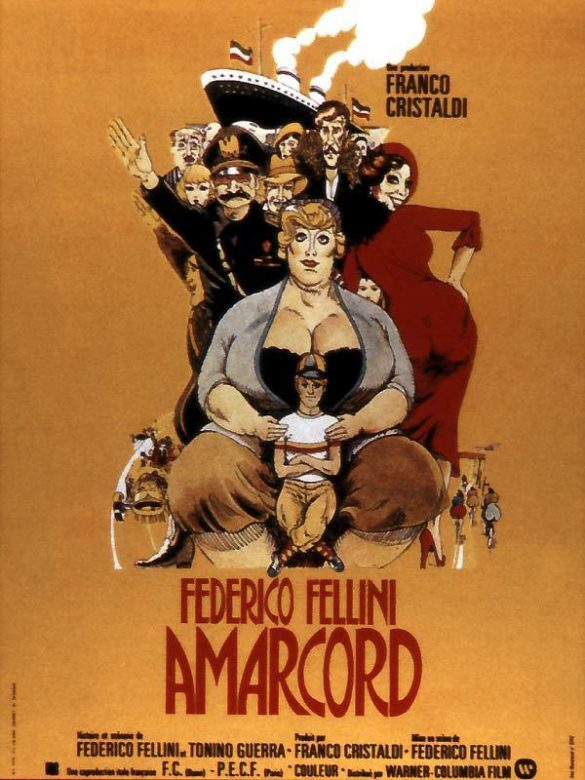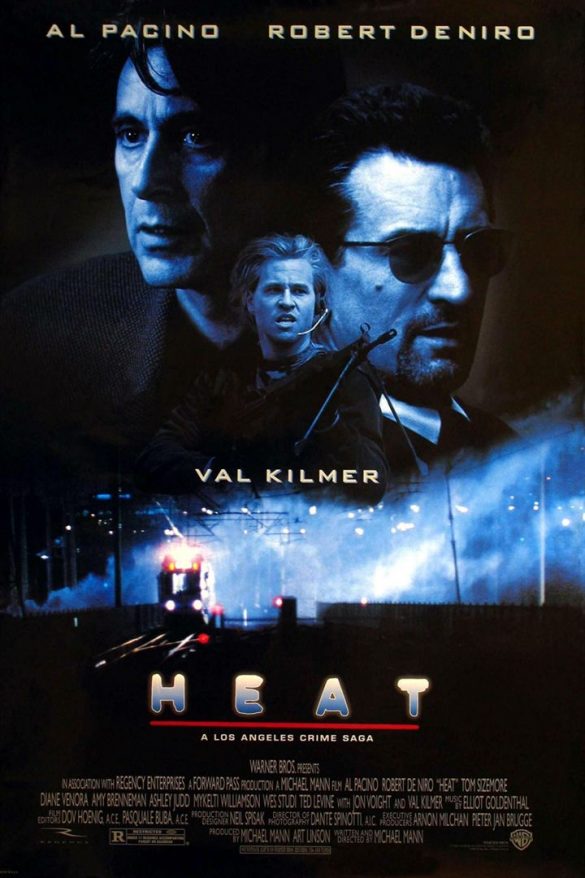Chaque mercredi, on rend hommage à un grand classique du cinéma. A voir ou à revoir.
Voyage à Tokyo de Yasujirō Ozu
Le japonais Ozu est considéré comme l’un des cinéastes les plus importants de l’histoire et dans sa longue filmographie – débutée à l’époque du muet et qui se termine avec Le Goût du saké en 1962 un an avant sa mort –, Voyage à Tokyo, réalisé en 1953, passe pour son chef-d’œuvre. Comme souvent chez lui, il s’agit d’une chronique familiale. Un couple de retraités, Shukichi et sa femme Tomi, habitant dans une petite ville côtière avec leur plus jeune fille encore célibataire, vont rendre visite à leurs enfants installés dans la capitale et à Osaka.

Chieko Higashiyama, Setsuko Hara, Chishû Ryû
A Tokyo, ils voient donc leur fils aîné, père de deux jeunes garçons, et leur fille aînée. Rapidement, la présence des parents devient encombrante. Les enfants les négligent. Seule Noriko, leur belle-fille veuve de leur fils Shoji mort à la guerre, consacre du temps au couple. A Osaka, Shukichi et Tomi rejoignent leur fils cadet, mais la mort va frapper.
Ce sont ses admirateurs qui en parlent le mieux.
Film sur les liens distendus entre les générations à travers le tableau d’une famille illustrant à sa façon le choc entre modernité et tradition dans le Japon de la reconstruction, Voyage à Tokyo ne vaut pas tant pour son propos – plutôt simple et banal – que pour sa forme. On y retrouve évidemment ce que l’on nomma le « plan tatami » obtenu par une caméra placée à moins d’un mètre du sol et plus généralement un minimalisme qui est la signature du cinéaste.

On peut aussi trouver cela long, lent, par là même ennuyeux, démonstratif. Longtemps méconnu en France (il faut attendre 1978 pour que Voyage à Tokyo sorte dans les salles de l’Hexagone), le cinéma d’Ozu a suscité nombre d’exégèses extatiques – souvent absconses – analysant le génie du cinéaste. En 1972, Paul Schrader, pas encore scénariste (Yakuza, Taxi Driver…) ni réalisateur (American Gigolo, Mishima…), publie un essai consacrant le Japonais (ainsi que Dreyer et Bresson) en maître du « style transcendantal ». Le critique Noël Burch voit de son côté chez Ozu une suspension du « flux diégétique » tandis que Gilles Deleuze a consacré de longues réflexions à son cinéma dont celle-ci : « un espace vide vaut avant tout par l’absence d’un contenu possible ». Et vice-versa ? Quant au cinéaste Kiju Yoshida, qui fut l’assistant d’Ozu, son essai laudateur s’intitule Ozu ou l’anti-cinéma. Pas mieux
LES FILMS QU’IL FAUT AVOIR VUS