Après plusieurs reports, la rétrospective consacrée à Jean-Denis Bonan va enfin avoir lieu à la Cinémathèque de Toulouse, du mercredi 9 au samedi 12 février. Collaborateur de Jean Rollin que la Cinémathèque a toujours mis en avant, c’est par cet autre cinéaste que son nom nous a été connu. Puis deux de ses réalisations ont déjà été projetées au cours de différentes éditions de Extrême Cinéma : Tristesse des anthropophages, et La Femme bourreau en 2018, lors de la carte blanche de Julien Bodivit, fondateur du LUFF (Lausanne Underground Film & Music Festival). Ce cycle sera à l’image de l’artiste Jean-Denis Bonan, riche et généreux, puisque ses amis viendront durant les intermèdes pour des poèmes, des chansons. Je vous invite à relire l’édito de Franck Lubet, programmateur de la Cinémathèque de Toulouse, avant l’entretien avec Jean-Denis Bonan, qui sera présent à Toulouse pour présenter chaque séance.

Poétique du politique
C’était en mai 2018. Pour le cinquantenaire de Mai 68, nous avions monté une programmation réunissant cinéma militant et films du groupe Zanzibar, avec l’idée que le cinéma militant inventait une esthétique par ses questions éthiques pendant que Zanzibar imposait une éthique par sa volonté esthétique. Nous avions alors invité Jean-Denis Bonan pour nous raconter l’aventure du groupe Cinélutte, groupe de cinéastes militants qu’il avait créé avec Mireille Abramovici en 1973, dans la suite logique d’un autre collectif qu’ils avaient déjà tous les deux monté en 1967 : l’ARC, pour Atelier de Recherche Cinématographique.
Jean-Denis n’avait pas pu venir, empêché au dernier moment. Mais rendez-vous avait été pris pour aller plus loin dans sa propre production. Car si nous connaissions déjà Jean-Denis Bonan à travers l’histoire de Cinélutte, dont les films ont une place importante dans les collections de la Cinémathèque, on le connaissait aussi par le prisme d’Extrême Cinéma avec Tristesse des anthropophages (son premier court métrage professionnel censuré pendant près de cinquante ans) et La Femme bourreau (resté dans les tiroirs pendant autant de temps avant que Luna Park ne lui permette de le finir et de le sortir en 2015) que nous avions présentés pendant le festival.
La Femme bourreau, tourné pendant les événements de 68, coproduit par Anatole Dauman, le producteur de la Nouvelle Vague, est un film étonnamment singulier, une sorte de giallo tourné en mode cinema-vérité, qui aurait toute sa place sur les étagères du cinéma de la transgression cher à Nick Zedd et Richard Kern. Un film pendant le tournage duquel il réalisait avec le groupe ARC un documentaire, à chaud, sur Mai 68 : Le Bel Émoi de mai.
Ajoutez à cela un autre film, tourné en 1967, dans le cadre d’un projet écrit et réalisé avec les patients et le personnel de la clinique de la Borde (L’École des fous – une parabole imaginée et jouée par des « aliénés » sur la peur sociétale et le rejet de l’étranger, interrogeant la bonne santé mentale de nos sociétés et de leurs mécaniques politiques…), et vous commencerez à avoir une petite idée de qui peut bien être Jean-Denis Bonan. Parce que ce n’est pas dans les histoires du cinéma que vous le trouverez. Et pour cause. Censuré artistiquement, engagé politiquement, ou/et l’inverse, cet autodidacte, qui a appris le métier en travaillant dans les laboratoires Éclair et comme monteur aux Actualités Françaises, a passé les années 1980 et 1990 à travailler pour la télévision, réalisant des films alliant toujours sujets de société (la psychiatrie est un thème récurrent) et recherches formelles, avant de reprendre dans le courant des années 2000 son activité de cinéaste maquisard. Maquisard, parce que si le cinéma officiel le tient à l’écart, à 80 ans Jean-Denis Bonan continue de produire des films, reprenant et terminant d’anciens projets, en développant de nouveaux. Une œuvre entre luttes, politiques et poétiques, d’où se dégage un besoin de mémoire, de garder traces. Et rien de tel qu’une rétrospective pour faire acte de mémoire.
Cette rétrospective, elle a été construite par Jean-Denis Bonan lui-même. Il en a choisi les films parmi tous ceux qu’il a faits, ainsi que leur agencement, comme un artiste (il est aussi plasticien) supervise une exposition de ses œuvres, comme un poète (il écrit également) fait une sélection dans ses textes pour éditer un recueil. Et il l’accompagnera, avec sa famille : Francis Lecomte, producteur et distributeur de ses films avec Luna Park, le chanteur Daniel Laloux, compagnon de route du groupe Gong, qui poussera la chansonnette pour l’occasion et Domi Bergougnoux, poétesse, qui lira quelques-uns de ses poèmes entre deux films. Rendez-vous avait été pris. Rendez-vous vous est donné.
Franck Lubet

Jean-Denis Bonan, pourriez-vous vous présenter ?
Je suis un vieil enfant dans sa quatre-vingtième année, né sous le soleil de Tunisie. Très tôt, j’ai douté de l’existence de Dieu et je m’étonnais qu’on ait pu imaginer tant de mythes sur l’au-delà de la vie. Je fus un assez bon nageur, mais un cancre invétéré. Très tôt encore, l’injustice du monde a fait naître en moi un esprit de révolte. Je n’ai jamais compris pourquoi un individu se sentait supérieur à un autre. La politique est venue vers moi parce que je ne supportais pas le sort réservé à mes petits copains tunisiens, qui, sous prétexte qu’ils étaient arabes, allaient pieds nus et ne mangeaient pas à leur faim.
Mon père est d’origine juive, petit-fils de grands rabbins, famille de lettrés, famille exigeante devenue parfaitement laïque. Ma mère est d’origine catholique, de parents italiens extrêmement pauvres, ma grand-mère italienne était analphabète. C’est entre ces deux chaises que j’ai posé mon cul dans l’existence. Ce genre de famille a connu des exils successifs et moi-même, débarqué en France à l’âge de quinze ans, j’ai souffert de ce bouleversement.
Comme la société m’apparaissait hostile, j’ai plutôt concentré mes activités en un petit combat contre : contre ceux qui étaient bien en place, contre ceux qui ne doutaient pas de leur excellence. En tout cas, toute forme d’autorité m’était intolérable. Ainsi, je me suis construit contre les ordres établis. Embrasser une « carrière » d’artiste était donc une évidence pour moi.
Ce qui compte le plus aujourd’hui, c’est d’être vivant. Ce n’est pas si simple. « Être vivant » exige de lutter d’une manière permanente. Cette vivance exige que perdure le désir, l’amour, le rêve.
Comment avez-vous accueilli la proposition de la Cinémathèque de Toulouse de vous consacrer une rétrospective ?
La Cinémathèque de Toulouse par l’intermédiaire de Franck Lubet a été la première institution à imaginer une rétrospective avec certains de mes films. J’ai eu la chance avec mes émissions de télévision d’avoir été regardé et apprécié ; en revanche, ce que j’avais destiné au cinéma est resté longtemps dans l’ombre la plus épaisse. C’est grâce à Jean-Pierre Bastid qui a déterré deux de mes films en les programmant à la Cinémathèque Française, et grâce aussi au travail des équipes des Archives du film avec Éric Le Roy, qu’une sorte de renaissance s’est produite. Je dois tout aux personnes qui ont manifesté leur intérêt pour mon pauvre cinéma : Christophe Bier, Grégory Alexandre, Francis Lecomte…
Plusieurs de mes films avaient été montrés en 2014 dans la salle de la Cinémathèque de Lausanne grâce au LUFF, festival étonnant et détonnant. Jean-Denis Bonan
La première véritable rétrospective a été organisée par Hichem Ben Ammar à la Cinémathèque Tunisienne en 2020, c’était pour moi tout à fait bouleversant, puisque la Tunisie est mon pays natal.
Bien entendu, aujourd’hui, c’est un honneur et une émotion pour moi que d’être un temps le héros de l’excellente Cinémathèque de Toulouse. Avec Toulouse, je me relie à une partie de mon travail de téléaste que j’ai eu la joie d’exercer à France 3 dans la région, en particulier avec Maryse Bergonzat et Isy Morgensztern.
Comment avez-vous choisi les films pour cette rétrospective, proposés par thématique : être fou, être relié au monde, être à la marge, être en liberté et fuir ?
La programmation de onze de mes films, – plus ou moins longs, souvent courts -, est destinée à ouvrir un éventail assez large de ce que j’ai pu composer. Il y aura là mon tout premier film professionnel Tristesse des anthropophages (1966) et le tout dernier, à peine achevé Les Tueurs d’ordinaire (2022).

Tristesse des anthropophages
Il m’a semblé que ce qui passait d’un film à l’autre, malgré leurs énormes différences, était un questionnement sur la normalité, – d’où la thématique être fou -, sur le fait d’être à la marge de la société, sur la liberté et sur la nécessité d’être perpétuellement en fuite. Ce sont ces questions qui traversent, je crois, mon travail dans un positionnement poétique-politique. Dans ce programme, on pourra voir les traces de cinquante-cinq années d’errance hors des chemins officiels du cinéma. Si j’ai longtemps cru que j’étais à la marge malgré moi, à cause des institutions qui ne voulaient pas de mon travail, je sais maintenant que je me suis placé volontairement dans ce maquis, parce qu’à vrai dire je ne me sens pas chez moi dans les demeures de notre industrie. Récemment, on m’a demandé « mais pourquoi la fuite ? », la première image qui m’est venue est celle de ces esclaves noirs qui fuyaient la domination des maîtres et qu’on a appelé les nègres marrons. Ainsi, il m’a aussi paru important de programmer Carthage Édouard Glissant (2006) où, Glissant, poète martiniquais, expose à Carthage, ma presque ville natale, ce qu’il nomme la poétique de la relation.
J’ai écarté certains films pour leur réserver une place plus cohérente bientôt. Il y aura en effet assez vite, trois œuvres qui sont une entreprise commune effectuée avec l’écrivain Andréas Becker : La Soif et le parfum, Bleu Pâlebourg et Gueules, ce dernier film est en cours de finition.
Comment avez-vous préparé les intermèdes ?
Parmi ce que j’appelle de manière immodeste mes combats, il y a cette nécessité pour moi d’abolir les frontières, les séparations entre normal et anormal, entre féminin et masculin, entre réalité et fiction, entre peinture et littérature, entre cinéma et musique etc. Il m’a paru donc essentiel de glisser autant que possible entre mes films des éléments non cinématographiques. J’ai ainsi demandé à la poétesse Domi Bergougnoux de dire deux des très beaux poèmes qu’elle a pu écrire à propos de son fils atteint d’une maladie psychiatrique. De la même manière, j’ai demandé à Daniel Laloux de chanter l’une de ses chansons avant la projection du film Les Tueurs d’ordinaire, dans lequel il tient un rôle important. Mais surtout, j’attends de la salle qu’elle puisse participer avec sa propre créativité. J’espère aussi que la présence de certains de mes livres ou de livres amis susciteront l’intérêt des spectateurs.
Le choix d’un projet que vous souhaitez aborder impose-t-il le médium, ou est-ce l’inverse ?
Mon premier biberon culturel, c’est la poésie. Mon père était un fou de Baudelaire, d’Éluard, d’Apollinaire et je buvais des vers plus que mon lait. J’ai écrit très jeune, mais les vexations d’une enseignante m’ont amené à cacher mon écriture. Il a fallu l’intuition d’un jeune éditeur, Quentin Westrich (éditions Abstractions), et sa ténacité, pour que j’accepte enfin de livrer mes textes. Ce n’est donc qu’en 2021 que sort Meutes, poèmes et images.
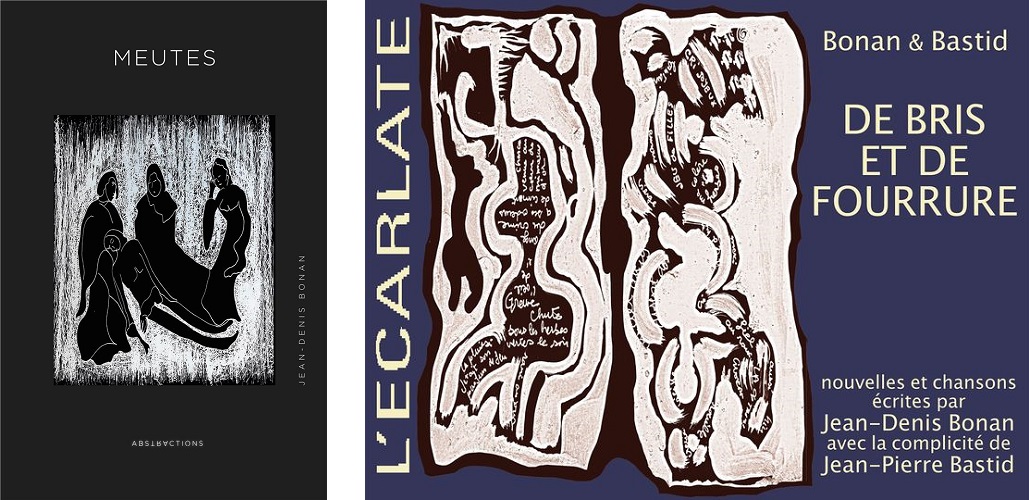
Il se trouve que cet ouvrage a bénéficié de l’enthousiasme de certains lecteurs si bien que j’annonce, peut-être un peu tôt, la parution d’un prochain titre Et que chaque lame me soit cri qui devrait être édité par l’Institut du Tout-monde. En brûlante actualité, sera présent à Toulouse un livre qui sortira tout frais de l’imprimerie De bris et de fourrure, que je signe avec mon ami et complice Jean-Pierre Bastid ; l’éditeur Jérôme Martin (éditions l’écarlate) accompagné d’Emmanuelle Grivelet-Sonier sera d’ailleurs près de nous à Toulouse.
Hors du programme, Emmanuelle Grivelet-Sonier présentera son livre Comas, Jean-Pierre Bastid dédicacera son Vol bleu, Domi Bergougnoux signera son recueil La Craquelure.

J’aurai aussi le plaisir de montrer mon grand album dessiné Vie et mort de Ballao.
Hélas, je ne suis pas musicien, je me venge alors en élaborant des bandes sons particulières pour mes films. Pour le reste, je bricole, – ce mot n’est pas péjoratif pour moi -, des images, des films, des textes. Pour les images et les textes, mes élans sont spontanés et se façonnent au gré de mon humeur. Pour les films, même s’ils sont en partie improvisés, ils demandent une certaine préméditation, ne serait-ce que pour les comédiens, au moins, soient à mes côtés.
Plus j’avance dans mes bricolages, plus je laisse vivre l’ouvrage malgré moi. Par exemple, lorsque je dessine, je peux partir d’une tache ou d’un trait, et ce n’est qu’ensuite que j’interprète la tache ou le trait pour en faire une forme, une arabesque, des couleurs etc. Il en est de même pour mon écriture où les mots se jettent sans projet sur ma page et ce n’est que par la suite que je réordonne ces mots et tente d’en donner un sens. Pour les films, je fais de même. Ainsi Les Tueurs d’ordinaire est un film si éclaté par les sentiments qui m’ont traversé ici et là, que je n’ai pas su le monter. Il a fallu la grande complicité de Julie, ma fille, pour ordonner les séquences dans une continuité.
Pouvez-vous nous parler de la création de L’École des fous ?
Au tout départ, ce film devait être coréalisé avec un ami. Durant le tournage, nous n’étions pas d’accord, si bien que je parlais seul au directeur de la photographie Gérard de Battista, et que je travaillais dans mon coin avec les acteurs. C’était un tournage assez particulier puisque le film est joué et en partie élaboré par des fous , et qu’il exigeait donc une empathie entre les acteurs et la mise en scène. Lorsque le tournage a été terminé, j’ai eu l’opportunité de tourner mon court-métrage Mathieu fou. Hélas, l’ami qui devait coréaliser le film a profité de mon absence pour s’emparer des rushes et en faire un montage que je jugeais catastrophique. Malheureusement, même le négatif avait été monté si bien que je n’ai plus jamais eu accès aux scènes intégrales du tournage. C’était une expérience éprouvante, et ce film monté sous le titre de Ixe était si inintéressant que personne n’a jamais voulu le projeter. Des années plus tard, racontant l’expérience à Francis Lecomte, celui-ci a insisté pour que j’en fasse ma version. Je suis donc parti d’un négatif monté, très abîmé pour refaire un montage cinquante-deux ans plus tard en me rappelant mes intentions. C’est ainsi que je suis parti de moi-même, sans m’exclure de la communauté des fous, en inscrivant mes dessins au début de cette École des fous.

En avant-première, Les Tueurs d’ordinaire sera projeté, que vous décrivez ainsi « je savais qu’il y avait un couple marginal, en errance, immobile »…
Les Tueurs d’ordinaire est un film en grande partie improvisé à partir de quelques scènes et de quelques textes que j’avais pu écrire. Au départ, j’avais imaginé un couple qui ne faisait qu’attendre tout en se préparant perpétuellement à un départ. Au fur et à mesure que les magnifiques comédiens, Camille Thomas, Fabien Grelot, Geneviève de Kermabon, Daniel Laloux, Charlotte Valensi, Jean-Pierre Bastid… interprétaient spontanément une scène ou une autre, se dessinaient d’autres perspectives. Ainsi des titres se sont un temps imposés :
– Agonies, car tout semblait se jouer dans une lente fin attendue.
– Fragments de l’histoire du monde, puisque poursuivant le tournage, les éléments devenaient de plus en plus disparates et semblaient des morceaux d’une mosaïque dont on ne découvrirait jamais l’ensemble.
– Sur la falaise, car j’avais eu l’idée d’inclure une chanson qui parlait d’un couple sur une falaise.
Enfin, le film s’intitule désormais Les Tueurs d’ordinaire à cause d’une phrase que j’ai prêtée à Daniel Laloux qui interprète une sorte d’enquêteur dans ce film « Nous sommes les garants de la banalité du monde ».

Les paroles de la chanson qui a disparu dans Les Tueurs d’ordinaire
Un homme, une femme sur la falaise
regardent au loin vers l’orage
Ils partiront sur la fournaise
des vagues qui grondent et qui ragent
Petite vie comme un mouchoir
agité aux mains de l’aimée
Rien n’est plus beau que le départ
qui fait le tout recommencer
La longue vie comme un ruisseau
s’en va lentement sur la mer
Et notre amour tel un vaisseau
s’éloigne du port et de la terre.
Sur combien de projets travaillez-vous actuellement ?
Combien ? Je ne sais pas, lorsqu’on aime, on ne compte pas.
Je suis attelé au montage avec ma fille d’un film dérivé d’un ouvrage d’Andréas Becker, Gueules, qui évoque les gueules cassées de la guerre 14-18. Je préfère pour l’instant ne pas trop en dire.
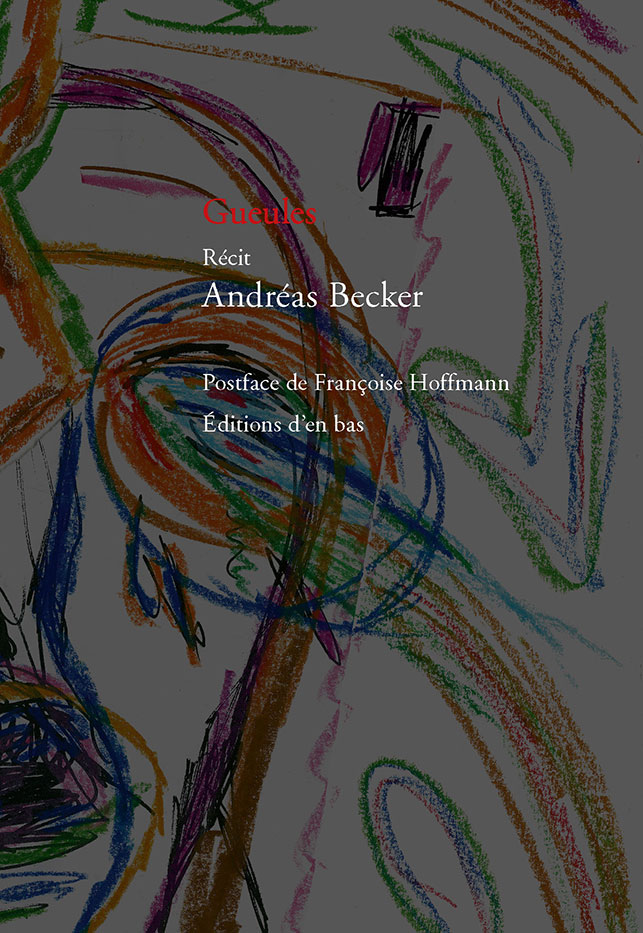 Par ailleurs, j’espère terminer un film qui sera tissé de scènes réalisées en 1980 et de scènes tournées aujourd’hui avec les mêmes comédiens : un saut de quarante ans. Le film a pour titre Tous les jours avec Michel Puterflam hélas disparu, Laurence Mercier, Daniel Laloux, Michel Melki, Dominique Maurin, Alberto Moravia hélas disparu, Sophie Bourel et moi-même.
Par ailleurs, j’espère terminer un film qui sera tissé de scènes réalisées en 1980 et de scènes tournées aujourd’hui avec les mêmes comédiens : un saut de quarante ans. Le film a pour titre Tous les jours avec Michel Puterflam hélas disparu, Laurence Mercier, Daniel Laloux, Michel Melki, Dominique Maurin, Alberto Moravia hélas disparu, Sophie Bourel et moi-même.
Je continue à fabriquer quelques images, dessins ou peintures. Certaines de mes images illustrent des couvertures de livres.
Je poursuis mon travail littéraire dans des voies assez différentes : Saynètes de théâtre, Poésies, Romans. J’espère qu’un de mes romans Marille, qui a retenu l’attention de Quentin Westrich, pourra faire l’objet d’une publication aux éditions Abstractions en 2022.
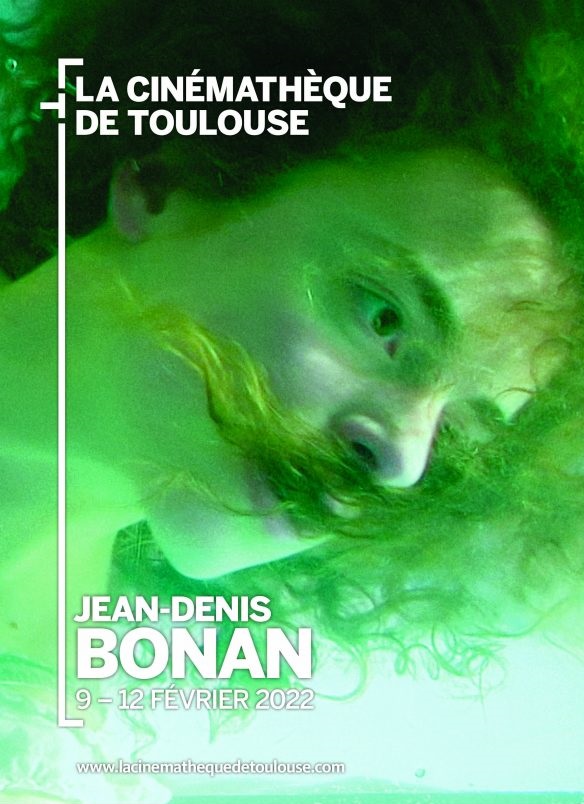
Cycle Jean-Denis Bonan, du 9 au 12 février, à la Cinémathèque de Toulouse
* Voir les projections
* Rencontre avec le public vendredi 11 février à 19h, précédée de la projection de Madame la France (1977-2020. Fr. 26 min). Entrée libre dans la limite des places disponibles
Infos pratiques
