Avec plus de 10 000 concerts au compteur, et autant de souvenirs incroyables, Alain Lahana a traversé une bonne partie de l’histoire du rock et de la musique moderne. Rencontre avec un bourlingueur du décibel et un passionné jamais rassasié.

Alain Lahana, vous êtes quoi au juste ? Tourneur, producteur, manager ?
Un peu tout ça et rien à la fois. (rires) Il faut voir que quand j’ai commencé, on était pas sectaire ni spécialisé comme maintenant. On faisait tout soi-même car c’était plus simple ainsi. C’était de la petite économie aussi. Y’avait pas de fric à l’époque. Les premières années, même à Paris, je n’en vivais pas ou mal. Je gagnais ma croute en remplaçant Marc Legendre qui répertoriait les dates de concerts dans Rock&Folk. C’est l’époque où j’ai connu Antoine de Caunes, à qui j’ai présenté Christian Vander dont il était fan (il a d’ailleurs écrit un livre sur Magma). Et aussi Philippe Paringaux, Philippe Koechlin, Philippe Manœuvre qui était tout jeune avec les cheveux dans le dos ! Aujourd’hui, je fais toujours le grand écart dans mon métier. Par exemple, je suis lié à tout ce que fait ma frangine Patti Smith en France. Je bosse aussi avec Iggy Pop depuis 1977. Je suis manager-producteur de Carla Bruni pour le monde (je travaille sur une trentaine de pays). J’ai repris en main la carrière de Tryo que j’ai accompagné pour la première fois de leur carrière dans un statut d’indépendant. Je suis couteau-suisse, il y a plein d’aspects différents dans mon boulot.
Vous êtes Toulousain d’origine je crois…
Non, je suis né en Tunisie mais je suis arrivé à Toulouse à l’âge de quatre ans. Mon père était médecin et était né à Toulouse. Et j’y suis resté jusqu’en 1976. Je suis arrivé au collège-lycée Raymond Naves en 1967. Quatre ans plus tard, j’ai été élu président du foyer socio-éducatif. Entre midi et deux, on faisait des auditions où on passait du Creedence, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix… Mon frère était aussi batteur dans le groupe Nuances, et on a autoproduit un disque à l’époque. Après, j’ai produit le disque de mon meilleur ami d’enfance qui jouait dans Potemkine. On l’avait enregistré au studio Tangara de François Artige, aux Minimes. François jouait alors dans le groupe Tangara avec Daniel Antoine aux claviers. Ce dernier jouait aussi avec Backstage, le groupe de Paul Personne après Bracos Band, que je manageais. Pour revenir à Potemkine, on avait sorti le disque chez Pôle Records. On n’avait pas un rond mais on était surmotivé. J’avais aménagé un petit studio photo chez mes parents, et c’est avec ça que je gagnais un peu de fric pour financer le premier disque de Potemkine. C’était aussi l’époque où je collaborais à Tartempion. C’était un petit fanzine local mais il nous a permis de communiquer entre tous les indés du pays, tous les mordus, les alternos. C’est Georges Leton qui liait un peu tout ce petit monde parce qu’il les rencontrait lors de ces déplacements avec Magma. C’est comme ça que j’ai rencontré Jules Frutos (qui a été après le producteur de Cure, Peter Gabriel, Coldplay) dans ce qu’on appelait le Réseau Zéro. Il y avait aussi Patou Kader qui a ensuite monté Nancy Jazz Pulsations.
Quand avez-vous démarré les concerts ?
En 1974. On organisait des concerts au Théâtre du Taur ou à la Halle aux Grains qui était un lieu très difficile à travailler à l’époque. L’acoustique était mauvaise, ça n’avait pas encore été restauré et repris par Michel Plasson et l’Orchestre du Capitole.
Il y avait même du catch et des combats de boxe. Et vous faisiez des concerts déjà sur une jauge aussi grande ?
On faisait plutôt nos concerts au Théâtre du Taur. Mais quand on avait un groupe un peu plus confirmé, on le faisait à la Halle aux Grains. De mémoire, je dirais que mon premier concert à la Halle aux Grains était Blondie, quand j’étais promoteur local pour Albert Koski vers 1976-1977. J’ai fait aussi Iggy Pop, Status Quo, Téléphone, Soft Machine, Van Der Graaf, Caravan et Little Bob pour le fameux concert de « Riot In Toulouse ».
Le mythique concert où les autonomes sont entrés en force…
Oui, c’était très violent à l’époque. C’était quasiment la routine. Il n’y avait pas de réel service de sécurité à part quelques baraqués qu’on mettait là. Et quand on avait 1500 personnes dedans, on en avait aussi 1500 dehors prêtes à tout casser pour rentrer gratos. Toulouse n’était pas aussi rose que maintenant. C’était une ville plus sombre, moins clean. La place du Capitole était même un lieu de deal, tout comme la place Esquirol
Vous avez organisé un autre concert mythique avec AC/DC au Lycée de Muret en 1979…
Oui. On devait le faire au Parc des Expositions de Toulouse, mais ils nous ont annulé la salle trois semaines avant pour mettre à la place une exposition canine. On avait déjà vendu 3000 billets, et il a fallu trouver un autre lieu, à une époque où il y en avait peu. On a fini par trouver le gymnase du Lycée de Muret. On a monté la scène en tirant le rideau pendant que l’autre partie du gymnase était utilisée par les élèves du lycée. Il y a eu 3500 spectateurs le soir. C’est un des derniers concerts avec Bon Scott, mort quelques semaines plus tard.
Vous avez connu Le Pied et les débuts du Bikini…
On faisait plein de concerts là-bas. Bijou, Bracos, Hot Rods, Lili Drop… Le Pied est mort à cause de l’alcootest. Quand il y a commencé à avoir des barrages de gendarmes sur la route d’Auch pour les contrôles d’alcool, le Pied a eu des problèmes et le Bikini a pris le relais.
Vous montez à Paris en 1976. Et cette année-là, c’est aussi la première édition du festival punk de Mont-de-Marsan…
Oui je suis à Paris et, au printemps 1976, je fais ma deuxième ou troisième tournée avec Skydog, notamment Pierre Thiollay qui était mon pote, pour six dates d’Eddie and the Hot Rods. Et on joue à Mont-de-Marsan où mon ami Marc-André Dubos me dit que son père peut nous filer les Arènes gratos si on monte un festival pas loin des fêtes de la Madeleine. Et voilà comment on se lance sur le premier festival punk qui aura lieu seulement quatre mois plus tard, le 21 août 1976, avec un budget d’à peine 18 000 francs (l’équivalent de 9700 euros d’aujourd’hui). On fait 600 personnes, c’est pas mythique, ça l’est devenu après.
C’est surtout la deuxième édition l’année d’après, qui va cartonner car le mouvement punk a pris de l’ampleur. On a toute la crème du mouvement : Damned, Clash, Jam (qui ne joueront finalement pas), mais aussi Dr Feelgood ou Police (qu’on paie à l’époque 100 livres sterling !). Tous ces groupes n’avaient pas la possibilité de jouer chez eux en Angleterre. Pour le deuxième Mont-de-Marsan, ils étaient tous venus dans le même bus, avec un chauffeur qui avait un gros pochon de speed pour ne pas s’endormir. C’était assez épique, même à l’Hôtel des Sablons qui n’avait pas assez de chambres pour tout le monde. Et les mecs des groupes se viraient à tour de rôle pour dormir.
Pourquoi les Jam n’ont pas joué ?
Le père de Paul Weller – qui était le manager de ce groupe de gamins, Paul Weller avait 19 ans – avait fait un caprice pour que les Jam jouent tôt, vers 19h. Mais on avait déjà prévu à cette heure Little Bob ou Bijou. Et, du coup, il nous a fait un chantage : « Soit on joue maintenant, soit l’on ne joue pas. » Résultat, ils n’ont pas joué et sont repartis. Ils n’ont pas été payés, on n’a pas cédé à leurs caprices. On a eu 4000 personnes, aidés beaucoup parce que, deux jours plus tard, Lou Reed jouait dans la ville. Il faut préciser que le public de l’époque était un public qui venait de loin. Comme pour le festival d’Orange par exemple, ils venaient en stop, dormaient à la belle étoile. Et c’était parfois très dur pour les organisateurs. À Orange, la même année que Mont-de-Marsan en 1976, le préfet avait annulé le festival. J’étais aussi avec Magma au festival de Arles qui a eu lieu le premier jour mais pas le second parce que le public a mis le feu aux Arènes. Et quand nous étions à l’hôtel avec Magma et Van Der Graaf Generator, les mecs de Sun Râ jetaient les télés dans la piscine depuis la fenêtre de leur chambre, et tout le monde écrasait ses pétards sur la moquette de cet hôtel, censé être inauguré la semaine suivante, c’était la cata totale !
Quand on vous voit en photo à l’époque, vous n’aviez pas trop un look punk, plutôt baba…
Marc Zermati m’appelait le baba speed ! (rires) Et puis je viens du prog, comme Potemkine, en écoutant John McLaughlin, Chick Corea, Weather Report, Miles Davis. Les trois accords, c’était de la merde pour moi jusqu’à ce que je rencontre Bracos Band.
Je pense qu’on oublie jamais la musique qui nous a construit et qui laisse une empreinte indélébile en nous, comme une Madeleine de Proust…
Absolument. Et, pour moi aujourd’hui, il n’y a qu’un seul critère : la bonne musique ou la mauvaise musique.

Alain Lahana avec Ron Asheton des Stooges
Vous avez évoqué Paul Personne et son Bracos Band ? Pourquoi le groupe s’est-il arrêté ?
Partout où ils passaient, ils retournaient la salle ! Michael, le bassiste des Frenchies (avec le futur réalisateur Jean-Marie Poiré), était mon cousin et il a produit le premier 45 tours. Il y avait des rapports un peu conflictuels entre Paul Personne et Philippe Saboulard qui était un guitariste d’exception. Après chaque concert, Paul était miné par les prestations de Fifi (Saboulard). C’est ce qui a fini par entraîner des conflits et une scission qui donnera deux groupes : Bracos Band en trio avec Saboulard, et Doudou & Co puis Backstage pour Paul Personne. Paul avait à l’époque souvent tendance à voir toujours le mauvais côté des choses, les 1% qui n’allaient pas au lieu des 99% qui étaient super. On s’est retrouvés dix ans plus tard au premier concert européen de Chris Isaak que j’avais produit au Rex Club. Il était là avec sa copine Gloria. Et on a papoté et recommencé à travailler ensemble.
Je suppose qu’avec tous les groupes que vous avez côtoyés, produits, fait tourner, il y a eu quelques souvenirs douloureux et de magnifiques emmerdeurs…
Oui, bien sûr. J’ai connu des ruptures violentes. Et des gens adorables comme David Bowie. J’ai eu un gros conflit avec James Brown qui me faisait un nouveau chantage chaque jour, à propos de tout, sous peine de ne pas jouer : « Je veux une Buick comme ceci. » « Je ne veux pas cet hôtel, mais celui-là avec la suite présidentielle. » C’était lors de sa tournée française en 1989, où j’avais pris les Fleshtones en première partie. Toujours très généreux, James Brown leur avait royalement accordé deux pistes en tout et pour tout sur la console. Après le show, j’ai annoncé à Jack Bart, le manager de James Brown, que j’annulais la fin de la tournée et que j’en avais ras-le-bol de leurs chantages permanents. J’avais aussi annulé transports et hébergement. Il a dû se démerder du jour au lendemain pour 48 personnes ! De toute façon, cette année 1989 avait été une catastrophe pour moi avec le dépôt de bilan de ma société Scorpio. Outre James Brown, j’avais eu la tournée solo de Jean-Louis Aubert, la première juste après le split de Téléphone, où il y avait à peine 150 personnes par concert, dont la majorité était venue pour cracher à la gueule de Jean-Louis, considéré comme responsable du split. Et, pour parachever le tout, Alpha Blondy m’a annulé deux Zénith et 36 dates parce qu’il estimait « ne pas avoir le feeling », et j’ai perdu 80 briques. Sinon comme artistes casse-couilles, j’ai eu aussi Kid Creole & The Coconuts. Le groupe ne se parlait plus, donc j’avais six voitures individuelles différentes à ma charge, plus autant d’hôtels séparés. Le tour manager est même mort après leur concert au Palace, parce que quelqu’un avait mis de la mort aux rats dans sa coke…
On pourrait croire que c’est facile d’organiser, comme vous, des concerts d’artistes très connus comme les Stones ou Phil Collins… Alors qu’on peut prendre un four avec des groupes aussi gros… Vous l’avez connu avec des groupes comme Duran Duran par exemple…
Oui, c’est le producteur qui paie pour les billets de tous les gens qui ne sont pas là. En 1998, j’ai été le premier à programmer un concert au Stade de France avec les Rolling Stones. Trois autres stades en province étaient prévus, mais les Stones me les ont annulés à cause de Keith Richards qui venait de tomber d’un cocotier. Ils n’ont ensuite reprogrammé que les dates les plus juteuses financièrement. Les Stones ne sont pas des enfants de chœur. Avant d’entrer sur la scène du Stade de France, j’ai vu Mick chanter « One for the money ! », suivi de Keith chantant « Two for the money ! », puis Ronnie « Three for the money ! », et enfin Charlie Watts qui finissait aussi par « Four for the money ! ».

Avec Curt Smith de Tears For Fears
Vous avez bien connu Daniel Darc…
Je m’occupais des tournées de Taxi Girl (avec le fameux concert du Palace en première partie des Talking Heads, où Daniel s’est taillé les veines), et je les ai présentés à Jean-Jacques Burnel (des Stranglers) qui était mon meilleur ami de l’époque, et qui a produit leur premier et unique album, Seppuku. J’ai d’ailleurs accompagné les Stranglers pendant très longtemps, et j’ai aussi produit son album solo Un jour parfait [NDA : superbe album !], dont l’attaché de presse radio était un débutant nommé Pascal Nègre. J’ai revu ensuite Mirwais lors d’une résidence à l’Institut français de Barcelone avec une sorte de Madonna orientale (accompagnée par les musiciens de Rachid Taha). Et Laurent Sinclair pendant le tour du monde de Stéphan Eicher. Laurent était censé avoir décroché de l’héroïne et devait faire la première partie de Stéphan à Ho-Chi-Minh Ville où il vivait. Mais il était tellement défoncé à l’opium et il disait tellement de conneries backstage (aigri et râlant d’ouvrir pour « un chanteur de variété ») que j’ai dû lui annuler cette première partie in extremis. Quant à Daniel Darc, c’était celui pour lequel j’avais le plus d’affection, un type extrêmement cultivé, ce qui est rare et d’une profonde sensibilité.
Le concert de Nice des Stranglers c’était vous ?
Oui. On avait déjà des problèmes avec Jacques Médecin, le maire de l’époque. Je m’occupais aussi de Bernard Lavilliers qui l’avait écorné dans l’une de ses chansons. On rusait souvent à l’époque quand on avait des difficultés. Pour les Stranglers, j’avais déclaré au recteur de l’Université de Nice que je voulais faire un concert du groupe de musique folklorique Les Stranglers. (rires) Le problème est qu’ils n’ont donné qu’une seule prise électrique pour brancher tout le groupe. À la sixième fois où le jus a sauté, Jean-Jacques Burnel en a eu marre et a dit au public : « Bon, les gens de l’Université nous traitent comme des cochons. Traitons-les comme des cochons, mais ne détruisez pas notre matériel. » Tout a été saccagé, et à deux heures du matin les flics ont débarqué à l’hôtel pour foutre les Stranglers à l’ombre en garde à vue. Et je leur ai pris Me Tréal, l’avocat des Stones (qui résidaient sur la Côte d’Azur à l’époque) qui gérait leurs problèmes de dope, et ils ont pris deux ans d’interdiction de concert sur le sol français. Et quand les Stranglers ont pu reprendre leurs tournées, on a débuté par… Nice ! (rires) Mais on a bien rigolé avec les Stranglers. À Balard, j’avais mis en première partie un match de catch à quatre féminin topless. Une fois, on avait mis un coiffeur sur scène qui coupait les cheveux des gens avant le show. Une autre fois, pour la tournée Aural Sculpture, on avait enregistré le concert, pour une vidéo transmission. Et lors du rappel de fin, Jean-Jacques, ce grand con, a passé un extrait du concert au public en disant : « Ah ah, on vous a bien eu, on a joué tout le concert en playback ! » Jean-Jacques pouvait aussi parfois descendre dans la fosse pour savater un mec qui l’insultait.

Jean-Jacques Burnel des Stranglers.
Les concerts rock étaient plus violents à l’époque, plus vivants aussi. Aujourd’hui, c’est un peu ambiance concert de musique classique… Pourquoi selon vous ?
La société s’est aseptisée, l’époque est différente. Les groupes non plus n’étaient pas des enfants de chœur. J’ai dû gérer la mort par overdose de l’ingénieur du son des Pogues, abandonné par le groupe avec des cuillères cramées autour de son cadavre. J’avais la famille pour le rapatriement et les interrogatoires policiers Quai des Orfèvres. On vivait des choses très extrêmes à l’époque. Et il y a les concerts qui foirent pour des choses heureusement moins dramatiques. J’ai fait, par exemple, les deux derniers concerts de XTC à l’époque d’English Settlement, produit par mon pote Steve Lillywhite. Cela se passait au Palace. On avait fait un deal avec Bernard Lenoir qui retransmettait le concert sur France Inter, et Brenda Jackson qui filmait pour Les Enfants du Rock. Sauf que le concert a duré une minute trente. Le lendemain, je prends le petit déjeuner avec Andy Partridge et Frankie Enfield (tour manager également des Damned, Duran Duran, David Bowie et Madonna). Et Andy Partridge nous dit, en trempant sa tartine de camembert dans son café, qu’il n’arrive plus à monter sur scène. Il a réessayé aux USA et la première date a donné le même résultat.
Comment faites-vous pour exporter la musique d’artistes français à l’international, avec le handicap de la langue pour ce marché-là ?
À l’époque de Bracos Band, j’avais sorti leurs disques en Angleterre grâce à Patrick Mathé. On avait été chroniqué dans le New Musical Express. Ça nous avait permis de faire une petite tournée hollandaise. Quand je m’occupais de Rachid Taha, il tournait surtout à l’étranger, peu en France. Il était une star au Québec, par exemple. Et il avait des cachets quatre à cinq fois plus gros à l’étranger qu’en France. Et, aujourd’hui, Carla Bruni (avec qui je viens d’enregistrer un nouvel album avec Albin de la Simone) vend plus en Corée du Sud et au Brésil qu’en France qui n’est qu’en cinquième position pour ses ventes. Et on travaille à un duo avec une grosse artiste chinoise pour mieux la faire connaître en Chine.
Vous prenez parfois en main des groupes ou artistes en développement ou peu connus ?
Pas au début de ma carrière, mais depuis dix ans oui. Et cela fait quelques années que je m’occupe de Giédré pour qui j’ai créé un label (sur lequel j’ai aussi publié l’album d’Iggy, Après). Car, à chaque fois que je lui présentais une maison de disques, elle flippait. Je travaille avec Mesparrow, Zaza Fournier. Je me suis occupé de Féfé pendant dix ans. J’ai démarré la carrière d’Ayo pendant onze ans.

Avec Rachid Taha
Vous avez travaillé avec des artistes très différents, du plus underground au mainstream… Vous avez fait tourner tant le Gun Club que les Spice Girls…
Je n’ai pas fait d’intégrisme. Car mes goûts musicaux sont extrêmement éclectiques. Les Spice Girls, c’était ultra-intéressant. Une leçon quotidienne sur le plan marketing. C’était inimaginable l’hystérie autour d’elles. Avec un public de moins de dix ans, que des gamins qui sautaient partout avec leurs parents qui dormaient à moitié à côté, avec un stand de merchandising plus grand que la salle elle-même ! J’étais allé les voir à l’étranger avant leur arrivée en France et, du coup, je me suis adapté en prenant des nanas pour l’entrée (pas besoin de costauds vu le public). Pour faire du bon boulot, il faut comprendre l’artiste avec lequel on travaille. Ce n’est pas la même chose de bosser pour Patti Smith ou les Spice Girls. Je me suis toujours enrichi de la diversité des artistes avec lesquels j’ai travaillés.
Vous avez créé le prix Constantin. Quel souvenir gardez-vous de Philippe Constantin ?
On s’est connu à un concert de Téléphone. À l’époque, Philippe bossait chez Barclay et voulait signer Bernard Lavilliers que je manageais. Il a aussi signé Stéphan Eicher dont je m’occupais. J’ai fait plein de trucs avec lui. Deux semaines avant sa mort, il était venu nous rejoindre sur la tournée africaine de Stéphan Eicher. C’est l’un des derniers grands directeurs artistiques avec Richard Marsan.
Vous avez beaucoup travaillé avec Stéphan Eicher, un artiste assez unique et atypique…
J’ai commencé avec lui après Les Chansons Bleues. Je l’ai connu par Violon, la batteuse de Lili Drop, qui est la marraine de mon fils aîné. Il y a eu deux pics dans la carrière de Stéphan avec le tube « Combien De Temps » en 1987, puis « Déjeuner En Paix » en 1991. À tel point que Stéphan ne pouvait plus sortir dans la rue sans être accosté sans cesse. J’ai des tas de souvenirs géniaux avec Stéphan. Un des plus touchants est le jour où je reçois une grande enveloppe. Avec dedans un t-shirt et une lettre qui me dit : « Shnugiputz – c’est ainsi qu’il m’a surnommé –, voici la tournée dont je rêve… Je t’envoie le t-shirt de la tournée, tu as les pays dans le dos. Est-ce que tu peux me monter cette tournée ? » Il y avait Madagascar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Burkina, l’Indonésie, la Chine… On lui a monté cette tournée, associé avec l’Alliance Française, le Goethe Institut et Pro Helvetia. Il y a un autre souvenir sympa avec Stéphan qui me revient à l’instant. On avait prévu une tournée avec une date à Carcassonne. Et c’était l’année de la grève des routiers, et la date à Carcassonne était devenue impossible à cause des barrages. On reporte la tournée, et on revient un peu plus tard à Carcassonne pour jouer. Le soir du concert, il pleut et on reporte au lendemain. La nuit, Stéphan n’arrive pas à dormir et se dit : « C’est vraiment superbe ici, il faudrait que j’y enregistre un disque. » On se débrouille pour réserver l’Hôtel de la Cité au mois de février, pendant le mois de fermeture annuelle, et ce sera l’album Carcassonne.
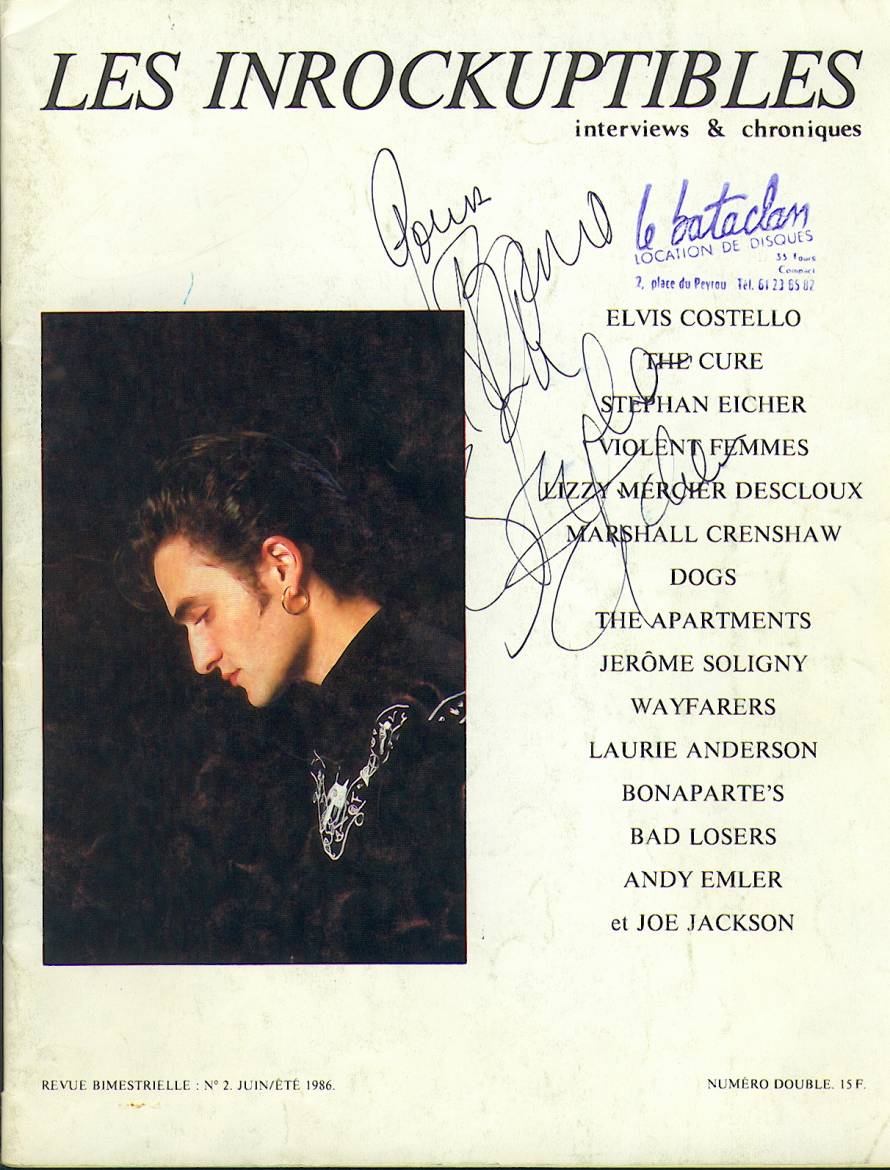
Ce métier vous passionne toujours autant ?
Bien sûr ! Si un jour, je n’ai plus cette passion, j’arrêterai. Je trouve toujours des trucs excitants à faire avec les artistes. C’est parfois loin de la musique. Avec Patti (Smith), nous sommes allés à Tanger. Elle avait ramassé avec son mari des cailloux à Cayenne qu’elle avait promis de déposer un jour sur la tombe de Jean Genet à Tanger. J’ai organisé deux concerts à Tanger pour qu’elle puisse réaliser cette promesse. Je lui ai aussi annoncé que la maison construite sur les cendres de la ferme des Rimbaud était en vente, et nous l’avons achetée. Ce sont des trucs hors-cadre qui créent une relation privilégiée.
Le succès de son livre Just kids lui a donné une nouvelle vie et une reconnaissance énorme…
Le tournant c’est l’hommage à la Fondation Cartier, et surtout le succès de Just Kids qui s’est vendu à plus de 400 000 exemplaires en France, et 4 millions dans le monde (1,5 million aux USA). J’ai vu des gamines françaises de 18-20 ans en dédicace de Just kids pour lesquelles Patti représente l’icône la plus ultime.
Vous avez longtemps travaillé avec Depeche Mode et connu ainsi le réalisateur Anton Corbijn…
J’ai commencé à bosser avec Depeche au moment de Music for the masses et pendant une quinzaine d’années. On a même monté leur prod à Lille avec Anton Corbjin. C’était une autre époque. Ce fut génial de les côtoyer en créa. Par contre, les quantités de dope en tournée étaient impressionnantes et auraient fait passer les Pogues pour des enfants de chœur. On avait à gérer des milliers d’ados hystéros qui fuguaient pour aller les voir, et l’atmosphère était toujours très électrique. Je ne les ai recroisés qu’une fois après leur décro et l’image de Dave engloutissant son litron de jus de carotte goulûment contrastait avec notre période, qui était, à mon humble avis, leur période la plus créative.

Vous avez fait tourner Echo & The Bunnymen aussi…
Oui, une bonne quinzaine d’années… Ian McCulloch était un pote proche et toute l’équipe aussi. Ils étaient toujours fourrés à la maison quand ils étaient à Paris (où ils ont, entre autres, enregistré Ocean Rain). Je leur ai fait parrainer le bateau Esprit d’Équipe de Lionel Péan au moment de la course autour du monde par équipe à Saint-Malo (Les, le bassiste d’Echo, est un ancien skipper). On s’est revu ensuite plusieurs fois avec David Bowie avec qui j’avais branché Will et Ian.
Vous avez bossé pour R.E.M. également…
Oui aussi… J’ai fait tous leurs concerts depuis leur création avec des périodes très spéciales au cours de leur évolution. J’entretiens toujours des relations régulières avec Michael Stipe qui est un très proche ami de Patti (et qui l’a beaucoup aidé après la mort de Fred Sonic Smith). Il est maintenant plutôt orienté sur la photo mais il participe à tous les happenings que Jesse, la fille de Patti, a monté avec Pathway to Paris pour sauver la Planète.
On va finir avec deux icônes qui sont d’ailleurs liées… David Bowie et Iggy Pop… Bowie à Saint-Malo, c’est une histoire incroyable…
Après la tournée Sound+Vision que j’avais organisée pour la France, David était venu répéter chez moi à Saint-Malo avec son groupe pendant trois semaines. C’était drôle car il allait lire le journal en buvant son café chaque jour à l’Hôtel de l’Univers, et personne ne l’a reconnu. Il était très content du résultat et m’a demandé si on pourrait organiser un concert le lendemain à Saint-Malo. Je lui ai dit : « Arrête tes conneries, y’a 350 places, et on n’a pas le temps de le monter. » Il faut voir qu’à l’époque, internet et les réseaux sociaux n’existaient pas. Et on a fait le concert au théâtre de Saint-Malo. J’ai même dû rabattre des promeneurs dans la rue pour finir de remplir la salle. Les gens n’y croyaient pas ! Moi-même, je ne l’avais dit à personne, et j’ai invité in extremis Hervé Bordier avec Jean-Louis Brossard, Philippe Pascal de Marquis de Sade et Dominique Sonic. Et Jérôme Soligny qui s’est fait arrêté pour excès de vitesse par les flics sur la route tellement il voulait être là. Il a dit aux flics qu’il allait voir Bowie à Saint-Malo, et ils ne l’ont pas cru ! (rires)

Et vous êtes celui qui a fait chanter Iggy Pop en français…
C’est parti d’une nuit où on était en bagnole tous les deux entre Mulhouse et Lyon (sur la tournée Instinct). Iggy avait mis de la musique et je me suis aperçu qu’il y avait beaucoup de Sinatra et d’Ennio Morricone. Je lui ai dit : « Pourquoi tu te bousilles la voix en hurlant – il faut préciser que parfois Iggy chante sur des systèmes pas toujours au top, avec des retours moyens qui l’obligent à pousser sa voix – Pour moi, tu es le dernier crooner. » Quelques années plus tard, il m’appelle et me raconte qu’il vient de bosser sur la BO d’un documentaire pour la télé belge sur le film La Possibilité d’une île de Michel Houellebecq. Il voulait mettre dessus « Autumn Leaves » qui est une version anglaise des « Feuilles Mortes » chantées par Yves Montand. Iggy m’envoie par mail sa version chantée en français. J’écoute et le rappelle dix minutes après : « Putain, ça déchire, toutes les gonzesses vont se liquéfier en entendant ça ! Ton accent est super sexy. » Iggy me dit alors que sa maison de disque ne veut pas le sortir car elle ne croit pas à ce projet. Je lui propose de casser son contrat avec sa maison de disques et de le sortir avec moi. Avec un album chanté en français. J’y ai passé huit mois mais j’ai cassé son contrat, et j’ai négocié Préliminaires avec Emi France & Canal +, avant de sortir moi-même Après, suite à un refus d’Emi France de le publier. On a vendu 43 000 disques d’Après. Il y a trois semaines, on a reparlé de le ressortir pour les dix ans avec deux titres inédits (enregistrés durant la même session). J’adore Iggy, c’est un mec très cultivé.
Entretien réalisé par Bertrand Lamargelle
