« Nothing sounds as good as : I remember that » Paddy McAloon (Prefab Sprout)
Quand on passe deux heures à tondre sa pelouse, en short flottant et torse nu avec ces brins d’herbe collés par la sueur qui font comme une verte pelisse sur les épaules et les jambes, il arrive qu’on se demande à quoi bon ce jardin autour de la maison, si ce n’est pour éloigner les voisins. Un matin que j’avais accompli cette tâche en maugréant, un vieil album du groupe californien Steely Dan n’en finissant pas de tourner dans le walkman, je me postai sous le auvent pour m’abriter du feu dans le ciel et songeai aux personnages de la classe moyenne américaine décrits avec tant d’acuité par le grand John Cheever dans ses centaines de nouvelles ou le roman qui serre le cœur Les Lumières de Bullet Park. En lâchant la bride, la tondeuse s’arrêta net et je m’apprêtais à farfouiller sous le carter pour attraper une boule d’herbe, au risque de voir ma main charcutée, quand m’apparut la vérité sur un autre écrivain que je connais bien, Christian Authier : il n’a pas ces problèmes domestiques d’entretien des espaces verts, ces préoccupations de banlieusard, du moins à ce que je sais.

C’était l’été ; j’avais empilé sur une table les romans de la rentrée signés par des auteurs locaux (on écrit énormément dans cette ville, et nous pouvons nous enorgueillir d’avoir des Dubois, des Martin et des Dessaint dans nos parages) mais je préférais passer mon temps enfoncé dans un transat, sous le figuier, avec une pleine brassée de Brautigan et de Mutis, plutôt qu’à devoir comprendre toutes ces intrigues inutiles et ces histoires de femmes dans un institut de beauté, de jeunes « meurtris en quête de liberté et d’avenir, confrontés au défi d’aimer », annoncées en quatrième de couverture. Qu’ils prennent une scie, une pelle, un harmonica ou le volant d’un camion et se mettent au travail, ça ira mieux, hein?
Il y avait, sous la pile de ce que je considérai sur le moment, par pure méchanceté, comme des jérémiades, le nouveau livre aigu, tendre et vrai de Christian Authier, ce romancier d’une génération « désenchantée » à qui on ne la fait plus mais qui garde dans son cœur les héros sans peur et sans reproche que la France mérite, les Résistants de 1940, les champions de foot ou les Hussards de la littérature. Christian Authier raconte souvent la province et le joli temps des PTT dans un style fluide et élégant. « Il y a des madeleines partout dans Toulouse, cette ville aux architectures et aux enseignes changeantes, de plus en plus souvent « marchandisées » ». Pour lui les livres sont « des petits cercueils de mots », ainsi qu’il me le disait aussi lors d’une interviou dans les années 2000. Comme dans une chanson du groupe anglais Prefab Sprout que notre auteur aime beaucoup, c’est la nostalgie des jeunes camarades mais, si le regret de certaines époques travaille la petite foule de ses personnages, d’autres temps et leurs mœurs grotesques (Yves Montand nous expliquant à la télévision la crise économique et la nécessité des missiles américains en Allemagne, les figures parfaitement cyniques de Bernard Tapie et peut-être de Thierry Ardisson) agissent comme des épouvantails et il s’agit surtout de jouer en célébrant le présent, de voyager léger, libre et digne, et de trinquer à la vie, sans toutefois oublier qu’elle contient le tragique et que nous sommes voués à disparaître.
« Un dîner à Villeneuve-de-Marsan est supérieur à n’importe quelle philosophie » Kléber Haedens (Salut au Kentucky)
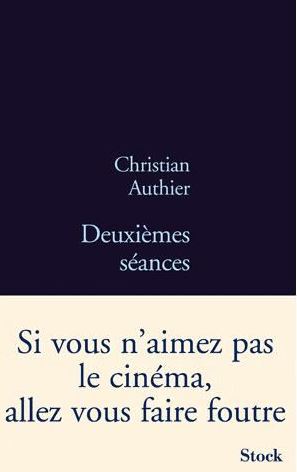 Pour la génération des quadras, le cinéma (aujourd’hui de plus en plus remplacé par les séries télé) est au centre du monde et des discussions. Lors d’un entretien que j’avais enregistré en plein air, non loin de son bureau à l’Opinion indépendante, une pièce lumineuse mais encombrée de volumes et où j’avais par ailleurs remarqué un disque calypso de Robert Mitchum, Christian Authier avait laissé échapper l’un des mots de passe qui doivent servir à sa bande : « Ti recordi, ti recordi ». Il m’avait appris qu’un personnage de Nani Moretti martèle cette phrase dans Palombella Rossa. Christian cite volontiers la comédie italienne comme influence sur son travail et aussi sur sa propre existence, notamment le film Le Fanfaron : « Quelque chose de grave, parfois tragique, peut-être désemparé mais en même temps où l’on puisse rire avec une forme de légèreté et d’insouciance ». Il y a une tradition des films de potes à la fois rigolos et tristes : Les copains d’abord de Lawrence Kasdan, Peter’s friends de Kenneth Branagh et même le cinéma d’Yves Robert, sans aller toutefois jusqu’à Marc Esposito. Et avec le roman qui s’apparente à de la non-fiction et paru chez Grasset il y a quelques mois, Les soldats d’Allah, on reconnaît chez Christian Authier, dans les scènes d’action et d’assaut, l’amateur éclairé de Sam Peckinpah et John Carpenter.
Pour la génération des quadras, le cinéma (aujourd’hui de plus en plus remplacé par les séries télé) est au centre du monde et des discussions. Lors d’un entretien que j’avais enregistré en plein air, non loin de son bureau à l’Opinion indépendante, une pièce lumineuse mais encombrée de volumes et où j’avais par ailleurs remarqué un disque calypso de Robert Mitchum, Christian Authier avait laissé échapper l’un des mots de passe qui doivent servir à sa bande : « Ti recordi, ti recordi ». Il m’avait appris qu’un personnage de Nani Moretti martèle cette phrase dans Palombella Rossa. Christian cite volontiers la comédie italienne comme influence sur son travail et aussi sur sa propre existence, notamment le film Le Fanfaron : « Quelque chose de grave, parfois tragique, peut-être désemparé mais en même temps où l’on puisse rire avec une forme de légèreté et d’insouciance ». Il y a une tradition des films de potes à la fois rigolos et tristes : Les copains d’abord de Lawrence Kasdan, Peter’s friends de Kenneth Branagh et même le cinéma d’Yves Robert, sans aller toutefois jusqu’à Marc Esposito. Et avec le roman qui s’apparente à de la non-fiction et paru chez Grasset il y a quelques mois, Les soldats d’Allah, on reconnaît chez Christian Authier, dans les scènes d’action et d’assaut, l’amateur éclairé de Sam Peckinpah et John Carpenter.
Mais l’essentiel, pour notre « calcuttisé » (un vigneron du nom de Calcutt a changé sa vie et son palais), pour ses copains et ses modèles, c’est de lever le coude à bon escient, au besoin jusqu’à plus soif, ou au-delà de la soif, et de goûter en connaisseur les aliments de la terre transformés par des artistes et non des ingénieurs, des hommes et non des machines.
Ou comment ces fonctions de nutrition tout bonnement naturelles et vitales, qu’on essaye d’expédier dans les emplois du temps resserrés d’aujourd’hui et qui, parfois, deviennent sources de maladies, nous pouvons les élever au rang d’art de vivre, en ralentissant.
Il me semble que Christian Authier n’a pas lu Jim Harrison ; ils auraient des choses à se dire.
« Le divin plaisir d’être français » Jacques Perret
Je réussis à m’extraire du transat et me levai, laissant à regret les fleuves colombiens boueux et dangereux du personnage légèrement anar Maqroll le gabier et le Big Sur alcoolisé de la bande de hippies des Diggers. J’allai mettre un disque de Prefab Sprout, le seul album qui vaille vraiment : Steve McQueen, dans la chaîne stéréo et commençai à lire debout De chez nous.
 Je suis d’accord, les canons devraient uniquement se boire et la fraternité et le goût du bon vivre l’emporter sur le culte des ordinateurs. Cependant, le monde est à feu et à sang, les écrans sont allumés et je n’achète que du vin sulfaté à moins de six euros la bouteille dans des hypermarchés que je trouve passionnants à arpenter. Je n’en souffre pas. Être français, c’est quelque chose, indubitablement. Notre pays, lorgné et sobrement raconté par Christian Authier, contient une foule bigarrée qui va des premiers Résistants à qui on voue un culte, cette armée des ombres légendaire, communistes et monarchistes au coude à coude contre les nazis, à l’éternel « ballet des hypocrites » et aux affairistes cupides qui couvrent le territoire de galeries marchandes et les villes de projets grandiloquents et inutiles. Il y a des « Mérovingiens allergiques au Progrès et à la Technique » comme Jacques Perret, Caporal épinglé, et de nobles rêveurs (parfois casqués comme Christian de la Mazière) qui ont pris les armes à tout moment et jusqu’en Algérie, pour des raisons parfois douteuses mais « aucun manichéisme ne résiste à l’examen des faits » ; des agriculteurs philosophes à la parole d’or, tel Pierre Rabhi (sa « sobriété heureuse ») ou encore une fraternité d’amateurs de ballon rond (comprenant sans doute Pierre-Louis Basse) qui « doit faire abstraction de bien des choses pour continuer d’aimer son sport », sous-entendu gangrené par l’argent-roi et « les tics » de la société du spectacle. Pour notre auteur, qui possède à la fois et au plus haut point le sens de l’histoire, le goût du style et une âme jeune, le football est « le pays de l’enfance et de l’insouciance ».
Je suis d’accord, les canons devraient uniquement se boire et la fraternité et le goût du bon vivre l’emporter sur le culte des ordinateurs. Cependant, le monde est à feu et à sang, les écrans sont allumés et je n’achète que du vin sulfaté à moins de six euros la bouteille dans des hypermarchés que je trouve passionnants à arpenter. Je n’en souffre pas. Être français, c’est quelque chose, indubitablement. Notre pays, lorgné et sobrement raconté par Christian Authier, contient une foule bigarrée qui va des premiers Résistants à qui on voue un culte, cette armée des ombres légendaire, communistes et monarchistes au coude à coude contre les nazis, à l’éternel « ballet des hypocrites » et aux affairistes cupides qui couvrent le territoire de galeries marchandes et les villes de projets grandiloquents et inutiles. Il y a des « Mérovingiens allergiques au Progrès et à la Technique » comme Jacques Perret, Caporal épinglé, et de nobles rêveurs (parfois casqués comme Christian de la Mazière) qui ont pris les armes à tout moment et jusqu’en Algérie, pour des raisons parfois douteuses mais « aucun manichéisme ne résiste à l’examen des faits » ; des agriculteurs philosophes à la parole d’or, tel Pierre Rabhi (sa « sobriété heureuse ») ou encore une fraternité d’amateurs de ballon rond (comprenant sans doute Pierre-Louis Basse) qui « doit faire abstraction de bien des choses pour continuer d’aimer son sport », sous-entendu gangrené par l’argent-roi et « les tics » de la société du spectacle. Pour notre auteur, qui possède à la fois et au plus haut point le sens de l’histoire, le goût du style et une âme jeune, le football est « le pays de l’enfance et de l’insouciance ».
Bernanos, Bigeard, Saint Marc, Tillion, Langer, Môcquet, Zidane…
Une litanie de noms, comme dans la Bible : convoquer la mémoire des disparus ; travailler, aimer, jouer, chanter et danser sur ce socle en espérant ne pas verser dans l’abîme. Et en reconnaissant une dette : « Ceux qui sont morts nous saluent. »
« Trop de balles perdues et pas assez de bals costumés » Patrick Besson
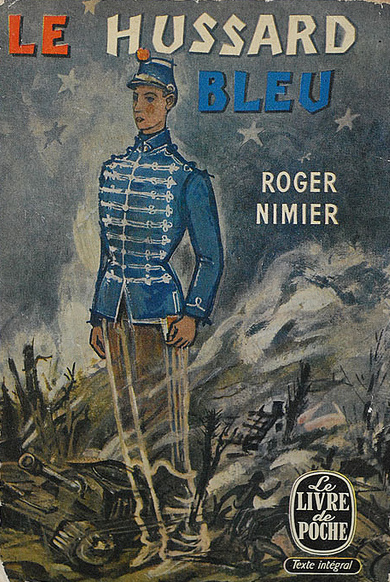 À certains moments, je me demande qui est réellement Christian Authier. Une fois, j’ai remarqué des fleurs de lys brodées aux poignets et au col de sa chemise et il cite Péguy en exergue de son dernier « roman » De chez nous ; j’ai jadis moi-même noté dans un cahier ces vers extraits de La Tapisserie de Notre-Dame : « Quand nous aurons joué nos derniers personnages, Quand nous aurons posé la cape et le manteau, Quand nous aurons jeté le masque et le couteau, Veuillez vous rappeler nos longs pèlerinages ». Je me souviens par ailleurs de l’un de ses dossiers consacrés à des « chrétiens très peu calotins » qui honorent dignement la vraie folie de cette religion, Mel Gibson en tête (décembre 2005) ; souvent, il clame son marxisme d’une voix de stentor gorgée d’une émotion proprement springsteenienne et il travaille dans un journal aux racines bien à droite, dit-on. Enfin, il ressemble de plus en plus à l’un des Vitelloni de Fellini sans l’être du tout, ce « hussard noir de la ville rose », selon l’expression de Jérôme Garcin. Dans le film Bronco Billy, une jeune femme insolente qui porte le joli nom de Antoinette Lilly veut savoir si le personnage flegmatique de Clint Eastwood, patron d’un cirque bringuebalant, est « pour de vrai ». McCoy répond tout de go : « I’m who I want to be (Je suis celui que je veux être) ».
À certains moments, je me demande qui est réellement Christian Authier. Une fois, j’ai remarqué des fleurs de lys brodées aux poignets et au col de sa chemise et il cite Péguy en exergue de son dernier « roman » De chez nous ; j’ai jadis moi-même noté dans un cahier ces vers extraits de La Tapisserie de Notre-Dame : « Quand nous aurons joué nos derniers personnages, Quand nous aurons posé la cape et le manteau, Quand nous aurons jeté le masque et le couteau, Veuillez vous rappeler nos longs pèlerinages ». Je me souviens par ailleurs de l’un de ses dossiers consacrés à des « chrétiens très peu calotins » qui honorent dignement la vraie folie de cette religion, Mel Gibson en tête (décembre 2005) ; souvent, il clame son marxisme d’une voix de stentor gorgée d’une émotion proprement springsteenienne et il travaille dans un journal aux racines bien à droite, dit-on. Enfin, il ressemble de plus en plus à l’un des Vitelloni de Fellini sans l’être du tout, ce « hussard noir de la ville rose », selon l’expression de Jérôme Garcin. Dans le film Bronco Billy, une jeune femme insolente qui porte le joli nom de Antoinette Lilly veut savoir si le personnage flegmatique de Clint Eastwood, patron d’un cirque bringuebalant, est « pour de vrai ». McCoy répond tout de go : « I’m who I want to be (Je suis celui que je veux être) ».
Il me fait penser parfois à un Jules Romains (Les Copains qui font des paris sur les litres de vin blanc et vont détruire Issoire, les tables qui « poussent des cris femelles ») ou à un René Fallet avec ses mousquetaires du zinc et ses vieux de la vieille, mais sans la truculence moustachue et joyeuse (gouailleuse) de ces illustres Français.
Quant à la coupe de cheveux de notre quadragénaire, je suis comme beaucoup, je m’interroge et je ne sais pas d’où elle vient mais je songe à ce m’avait rétorqué James Brown un jour que je lui demandais le nom de son coiffeur : « La prochaine fois, je fourrerai mes cheveux dans ma poche avant de me présenter à vous ! » (et son garde du corps me fusilla du regard )
« Il se pourrait que la France que nous portons dans notre cœur disparaisse… Ce n’est pas grave… Nous irons la reconstruire… Nous ne nous rendrons pas. Nous vivrons dans les marges, là où on ne nous dérangera pas pendant que nous sifflerons des mélodies légères. » Christian Authier
L’héroïsme est absent de nos vies depuis bien longtemps mais nous voulons vivre avec panache sans nous faire manipuler, profiter des fruits de la terre même et des fruits de l’esprit des artistes. De toute façon, les marionnettes n’ont pas conscience des fils qui les tiennent, les idées naissent douces et finissent féroces, ainsi que l’a dit Borges, et à la fin de l’histoire, il n’y a que « des vaincus et des fables ». Sans doute, nous n’avons pas besoin d’une explication totale du monde pour profiter d’un salmis de palombes cuisiné dans la région d’Eauze ou d’un disque des Black Crowes poussé à fort volume. Respirer l’air du pays, pour certains s’occuper des enfants, ou voyager dans la littérature nous suffit.
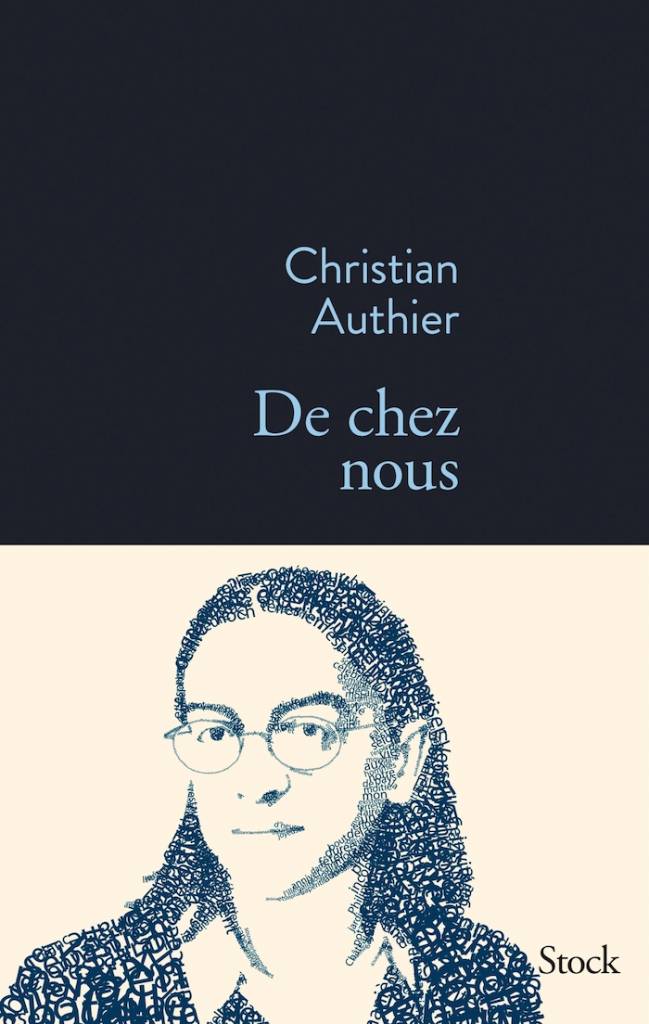 De chez nous regorge de figures littéraires qui composent le paysage mental des happy few français auxquels s’adresse finalement Christian Authier, ce romancier qui est aussi journaliste et critique, dans le bon sens du métier. Parmi ceux de sa génération, il cite quelques noms assez peu connus en nous donnant envie de les découvrir : Tellenne ou Guillaume Clémentine, « le petit malheureux ». Déjà, à une autre époque, Christian Authier m’avait habilement recommandé quelques auteurs qui ont fini par infléchir sensiblement le cours de mon existence (du moins ma façon de voir, sentir et pénétrer le monde, plutôt flotter au creux des vagues, dans la mer démontée) : Roger Vailland ou Kléber Haedens. Je ne sais plus s’il m’a conseillé (en douce) François Nourrissier. Je regrette de ne pouvoir lui rendre la pareille en lui suggérant des lectures qui vous explosent à la figure ou vous rendent plus humains : Heinrich Böll, Hermann Hesse, Thomas Bernhard ou les Mutis et Harrison déjà cités.
De chez nous regorge de figures littéraires qui composent le paysage mental des happy few français auxquels s’adresse finalement Christian Authier, ce romancier qui est aussi journaliste et critique, dans le bon sens du métier. Parmi ceux de sa génération, il cite quelques noms assez peu connus en nous donnant envie de les découvrir : Tellenne ou Guillaume Clémentine, « le petit malheureux ». Déjà, à une autre époque, Christian Authier m’avait habilement recommandé quelques auteurs qui ont fini par infléchir sensiblement le cours de mon existence (du moins ma façon de voir, sentir et pénétrer le monde, plutôt flotter au creux des vagues, dans la mer démontée) : Roger Vailland ou Kléber Haedens. Je ne sais plus s’il m’a conseillé (en douce) François Nourrissier. Je regrette de ne pouvoir lui rendre la pareille en lui suggérant des lectures qui vous explosent à la figure ou vous rendent plus humains : Heinrich Böll, Hermann Hesse, Thomas Bernhard ou les Mutis et Harrison déjà cités.
Vers six heures du soir, frappé par les rayons obliques d’un soleil brûlant, toujours couvert de sueur et d’herbe, j’avais terminé lecture et rumination mais il m’apparut que j’avais aussi dormi un moment, incident de parcours signalé par une langue pâteuse et la sensation d’avoir du caramel tiède sous le front. Je bus un coup d’eau plate et repris mes esprits en secouant la tête, comme dans ces cartoons où Sylvestre le chat se réveille d’une chute de cent mètres sur le crâne. Je me sentais de chez moi sinon de chez nous, toujours individualiste et cynique comme nous le sommes souvent dans la génération des bientôt quinquas, français parce que c’est comme ça et que c’est plus amusant, confortable et parfois fou que d’être américain ou chinois, et vouant un culte à la Résistance tout en sachant comment les véritables héros sont dépossédés de leur actes et de leurs victoires ou défaites, surtout s’ils disparaissent trop tôt. Oui, je sais, les marchands du temple et la vérité anglo-saxonne règnent en maître mais pas « ce n’est pas grave » et personnellement ça ne me gêne pas plus que ça, je préfère Nick Hornby à Michel Houellebecq, et même le lire sur un appareil électronique.
Mais enfin, il ne s’agit pas de moi. Après avoir jeté dans la pelouse rase l’eau du robinet acheminée par Veolia jusque dans ma cuisine, marmonnant ce « Nous ne nous rendrons pas » de Christian Authier qui sonne comme un Deguello hexagonal, je me suis précipité sur le frigo pour y prendre une Budweiser bien fraîche. Elle aussi m’a désaltéré et ouvert l’appétit.
De chez nous, Christian Authier, Stock, 2014
