Mahler Neuvième symphonie en ré majeur par Ivan Fischer et le Budapest Festival Orchestra, Concert Les Grands Interprètes.
La Neuvième Symphonie de Gustav Mahler comporte quatre mouvements :
1- Andante Comodo
2- Im Tempo eines gemächlichen Ländlers Etwas täppisch und sehr derb
(Dans le tempo d’un ländler confortable. Un peu lourd et très rude)
3- Rondo-Burleske-Allegro assai-Sehr trotzig (très décidé)
4- Adagio
« Je l’ai écrite aveuglément pour me libérer et on y trouve quelque chose que j’avais depuis longtemps en moi » (Mahler août 1909).
 Ivan Fischer à la tête de son ensemble Budapest Festival Orchestra, magnifique ensemble créé il y a déjà trente ans, s’attaque à la plus emblématique symphonie de Gustav Mahler, sa Neuvième. Le chef d’orchestre Ivan Fischer est un mahlérien confirmé et il a presque terminé son intégrale Mahler, auquel il ne manque encore que la 3, 7, 8, et la 9.
Ivan Fischer à la tête de son ensemble Budapest Festival Orchestra, magnifique ensemble créé il y a déjà trente ans, s’attaque à la plus emblématique symphonie de Gustav Mahler, sa Neuvième. Le chef d’orchestre Ivan Fischer est un mahlérien confirmé et il a presque terminé son intégrale Mahler, auquel il ne manque encore que la 3, 7, 8, et la 9.
Afin de préparer l’enregistrement de cette Neuvième symphonie de Mahler, Ivan Fischer la rode lors d’une tournée avec son fabuleux orchestre. En effet malgré plus de 160 versions disponibles en disque de cette symphonie, elle est peut-être la plus difficile à interpréter et les élus sont rares : Klemperer qui la fit connaître en France en 1967, Bruno Walter son créateur en 1912, Bernstein, Karajan, Abbado, Guilini, Haitink, Horenstein et c’est presque tout.
D’ailleurs à Toulouse seul Lorin Maazel et l’orchestre de la Bayerisches Rundfunk furent à la hauteur, jusqu’à maintenant, de cet abîme symphonique qui a englouti bien des orchestres.
Connaissant les remarquables réussites d’Ivan Fischer dans d’autres symphonies de Mahler, surtout la 4 et la 6, on pouvait donc espérer beaucoup de ce concert des Grands Interprètes. On fut comblé, et de quelle façon !
Pour l’expliquer, il faut donner quelques indications sur cette symphonie étrange et belle.
Interpréter Mahler est une chose, comprendre la Neuvième en est une autre. Il faut éviter les clichés mortifères, connaître intimement le Chant de la Terre, son œuvre sœur. Car il ne s’agit point de ne gloser que sur le néant et la disparition, il y a aussi un grand cri d’amour sur la vie que l’on laisse, une rumination sur la mort et le destin, une angoisse prégnante qui se dissout dans l’acceptation du silence.
Sur la dernière page de la partition est écrit « O Monde, adieu! ».
Méditation sur la mort certainement, comme le Chant de Terre, mais surtout adieu au monde de la tonalité, au monde lui-même, à l’amour, à la nature.
Après ce « tombeau » dédié à toute sa vie, il va pouvoir enfin tourner la page et se lancer dans la torturante épreuve de la Dixième Symphonie qui sera l’œuvre de la crise et de la perte des dernières certitudes. Mahler n’est pas au moment de la composition de cette symphonie, 1909-1910, cette épave affaiblie par les coups du destin, exhalant dans un dernier soupir son message ultime au monde, comme une certaine imagerie veut le laisser croire. II n’a pas la sagesse de la résignation, il s’efface simplement avec un pâle sourire : il ne veut pas mourir, il veut se dissoudre. Aucune compassion, aucune plainte ni sur la terre, ni sur lui-même, cette œuvre est celle d’un homme qui sait et qui laisse sourdre la poignante émotion.
Il a enfoui en lui ses blessures et laisse couler son indomptable énergie au service du Philharmonique de New York en pleine réforme de structures. Certes bien des choses saignent en lui, mais après « l’amalgame intime de la tristesse et de l’extase » du Chant de la Terre, Mahler porte un regard apaisé au-delà de l’infini qu’il vient de tutoyer.
À quarante-neuf ans, il s’enferme dans sa solitude et rédige à une vitesse folle cette œuvre complexe qui ne ressemble à aucune de ses œuvres précédentes. Il ne voudra jamais l’entendre et va l’enfermer dans un tiroir.
Il s’agit de son dernier manuscrit achevé et qu’il ne connut qu’au piano et par son oreille intérieure. Pourtant la science orchestrale est confondante. Lui qui retouchait si souvent ses partitions, a laissé ce document brut, mais parfaitement poli et on imagine mal les retouches qu’il aurait pu ultérieurement effectuer.
Symphonie entre chien et loup, symphonie à yeux fermés où le sentiment de l’inéluctable et de l’Immense Nostalgie vous étreint jusqu’à nouer les larmes.
Chaos et organisation, silence et cri, mort et vie sont mis en relation sans précaution comme pour constater un précipité alchimique.
Ainsi le sublime premier mouvement a déjà commencé avant que nous puissions vraiment percevoir les premiers sons émis par les violoncelles. Mahler utilise les retards, les non-résolutions et laisse sa musique flotter comme une nappe d’infini.
Deux mouvements lents tendus de révolte et de silence sont encadrés par deux mouvements rapides et sarcastiques qui demandent des comptes au monde, à sa vanité, à ses tumultes vains. La gaieté forcée et panique des sections rapides joue sur la distorsion des sons, du basculement dans le grotesque des lambeaux de danses. Devant le mensonge et l’hypocrisie, face « à l’ignoble comédie des bruits du monde » Mahler compose sa musique la plus noire. Les mouvements extrêmes sont, eux, une lente dissolution des sons traversés parfois par l’onde de choc des hurlements du silence. En fait cette symphonie évolue du silence au silence.
Pourtant c’est de suite dans le premier mouvement que l’on peut juger de la grandeur ou pas d’une interprétation. C’est effectivement le sommet de l’œuvre et Alban Berg ne s’y était point trompé lorsqu’il écrit dans une de ses lettres: « Je viens de rejouer la Neuvième Symphonie de Mahler. Le premier mouvement est le plus admirable qu’il ait jamais écrit. Il exprime un amour inouï de la terre et son désir d’y vivre en paix, d’y goûter encore la nature jusqu’à son tréfonds, avant que ne survienne la mort. Car elle viendra inéluctablement. Ce mouvement tout entier en est le pressentiment. Sans cesse elle s’annonce à nouveau. Tous les rêves terrestres trouvent ici leur apogée (et c’est là la raison d’être de ces montées gigantesques qui toujours se remettent à bouillonner après chaque passage tendre et délicat), surtout à ces moments terrifiants où l’intense désir de vivre atteint à son paroxysme, où la mort s’impose avec le plus de violence. »
Les contrastes entre les mouvements et les tonalités sont abrupts, provoquant des frottements de sons et d’émotions, mélangeant l’intime et le convulsif. Mais très subtilement on peut entrevoir une véritable somme de toute l’œuvre de Mahler et sa Neuvième est son miroir promené le long de son dernier chemin.

Ce premier mouvement, le plus long, le plus complexe, est la plus grande avancée de Mahler en musique, depuis le chaos jusqu’aux marches de la mort, avec de grands pans entiers de blocs immobiles de sons, de suspensions où la mort creuse son espace. Tendresse et terreur tissent la trame de l’histoire d’une vie, à partir semble-t-il d’une seule et unique mélodie. Des passages dramatiques hurlent au milieu de rêves effondrés.
C’est là qu’Ivan Fischer nous a subjugués. Se concentrant longuement avant l’attaque de chaque mouvement, il infuse après un très lent début, une tension extrême, un élan passionné à la musique.
Ces gestes amples ne sont pas là pour battre la mesure, mais pour sculpter le son. Les vertigineux écarts entre les pianissimi et les fortes dressent un combat douloureux avec bien des bouffées de tendresse.
Tout devient poignant et angoissant, avec les coups de boutoir du destin.
Flûte, hautbois, violon solo, basson, dessinent la dentelle de la fatalité.
Ivan Fischer après une telle épreuve prend une pause, tant son engagement fut intense.
Le deuxième mouvement est un scherzo brassant trois danses typiquement et férocement viennoises : un ländler « normal », une valse, et un ländler très lent jusqu’à la déchirure. Ivan Fischer en fait presque une musique villageoise qui racle, grince, cajole, en marquant fortement les temps, comme une prémonition de Bartok de la Suite de Danses.
Le troisième mouvement est un cri ironique très obstiné – comme le note avec son humour noir Mahler , il est dédié « A mes frères en Apollon ». Les sarcasmes et la douleur cruelle sous forme de folie polyphonique de ce morceau enfanteront Chostakovitch. Ivan Fischer sait y mettre dérision et burlesque et il se prend à mimer la musique.
Le chaos final pris à une vitesse folle est sidérant, glaçant, comme le monde cruel qu’il évoque.
Le dernier mouvement est celui « de la douleur au monde », (Weltschmerz). Il va expirer goutte à goutte aux cordes seules. La musique s’efface à n’en plus finir citant l’avant-dernier des Kindertotenlieder. Tout est accompli et Mahler inscrit sur la dernière note de la partition « ersterbend » (en mourant). Il ne reste que le souffle, une éternité retrouvée dans l’immatériel, dans l’abolition du son lui-même.
Ivan Fischer servi par des pupitres de cordes exceptionnels ne se complaît pas dans un pathos déplacé. Il est plutôt rapide et sait faire émerger comme des troués dans le silence les instruments solistes. Il fait chanter les notes, déferler l’apogée sonore avant la dernière plongée dans le silence. Tout se tapit aux portes de l’inaudible.
La musique donne congé au monde. Mahler exprime alors un adieu apaisé et aussi une soif extatique de vivre, une réconciliation finale.
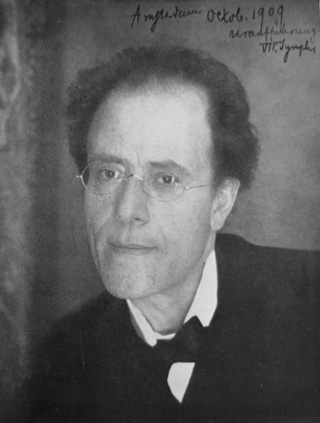
Musique qui consume, musique qui se consume, dernières paroles humaines jetées dans le vaste silence qui se brise, puis se referme. C’est l’attente d’un départ, une disparition en suspens d’où surnage l’essentiel de la vie passée. Le jour baisse peu à peu dans cette musique et le songe remplace la lumière pâlissante de la vie. La mort est là, aux aguets, sur ses gardes, et un trop grand frémissement de vie dans la musique la ferait bondir, aussi la Neuvième après ses révoltes, ses cris de rage, se dissout dans le renoncement du silence.
Mains longuement levées, Ivan Fischer tient le temps en suspension.
Le public, sans doute intimidé par cette œuvre et sa magnifique interprétation, nous aura semblé un peu réservé. Pourtant il se passera bien des lunes avant qu’un tel orchestre et un tel chef redonnent cette Neuvième de Mahler de façon aussi bouleversante.
Seul celui qui est capable de compassion est vraiment des nôtres. (Mahler)
Gil Pressnitzer
