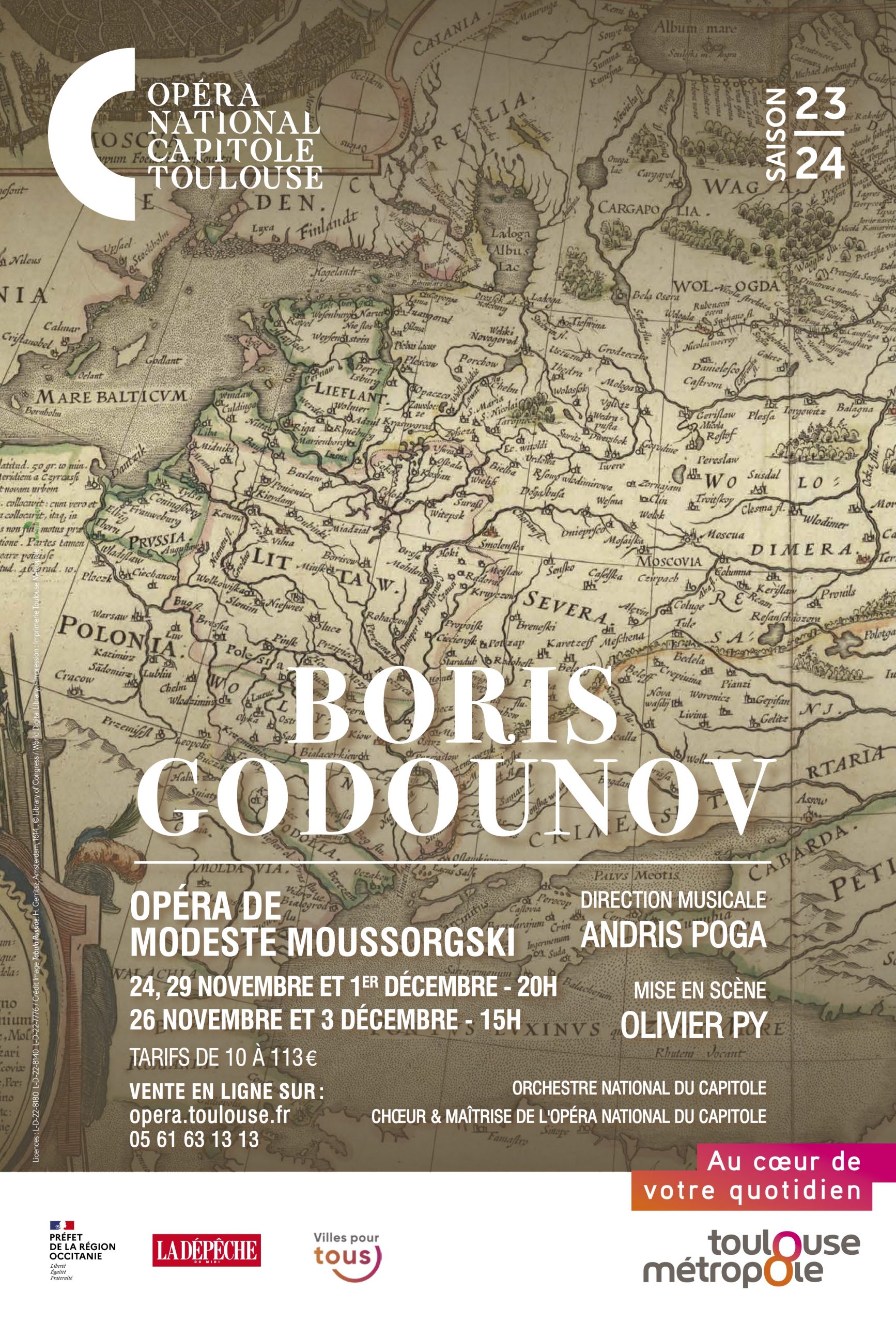Boris Godounov / Opéra national du Capitole © Mirco Cosimo Magliocca
Modeste Moussorgsky a écrit quatre opéras qui gravitent tous autour de l’histoire. Une histoire qu’ils révèlent sans jamais la parer d’aucune tranquillité factice. Un élément sur lequel Olivier Py s’appuie tout au long de ce Boris. « Le passé dans le présent, voilà ma tâche. Nous avons progressé, Tu mens ! tant que le peuple ne peut se rendre compte à quelles machinations il se prête, tant qu’il n’a pas acquis la volonté de se prêter lui-même à l’un ou l’autre dessein, il demeure figé sur place. »

Boris Godounov / Opéra national du Capitole © Mirco Cosimo Magliocca
Rappel : le compositeur s’est inspiré de Karamzine (voir l’article d’annonce) et de Pouchkine. À seize ans, ce dernier reconnaissait déjà avec un instinct infaillible la nature des conditions qui régnaient dans l’État russe, dans son poème : « Peuple muet qu’on pousse courbé dans la poussière, haïssant le tyran, mais craignant sa colère. »

Boris Godounov / Opéra national du Capitole © Mirco Cosimo Magliocca
Cependant, plus encore que Pouchkine, Moussorgsky s’attache à faire du peuple – un peuple opprimé asservi et réduit à une dépendance perpétuelle – un protagoniste de premier plan, un contrepoids à la figure du tsar. En 1875, il écrivait au peintre Ilia Répine : « Le peuple seul est authentique, entier, plein de grandeur et dépourvu d’artifice. »

Boris Godounov / Opéra national du Capitole © Mirco Cosimo Magliocca
Le peuple se montre ici dans sa misère, dans le retournement de ses opinions et de ses adorations ; peuple protagoniste, peuple omniprésent, jusque dans le plus infime de ses individus, l’Innocent (remarquable Kristofer Lundin) : et face auquel, scéniquement, vocalement aussi, il faut à Boris tout tsar et tsar qu’il est, poids double pour tenir, car le voilà, perméable, instantanément vulnérable à la voix de l’Innocent, tout comme d’ailleurs à celle de Pimène, et finalement aux deux qui lui disent vrai.

Boris Godounov / Opéra national du Capitole © Mirco Cosimo Magliocca
Le Boris de cette version est bien centré sur la psychologie du tsar, la véritable tragédie du remords, suivant pas à pas la déchéance psychique du tsar assassin. Pour le compositeur, le principe directeur de la création artistique était de rechercher, non pas la beauté, mais « la vérité, aussi amère soit-elle. » C’était son intention probable, telle qu’elle transparaît dans l’orchestration originale, de malmener, justement, les conventions. Une intention que Rimski-Korsakov n’a pas eu l’oreille assez fine pour la déceler puisqu’il a lissé, maquillé à l’excès les innombrables ruptures et discontinuités inscrites délibérément par Moussorgsky.

Boris Godounov / Opéra national du Capitole © Mirco Cosimo Magliocca
Par une attention très soutenue ! on pourra repérer que le rapport à la langue est pour le compositeur un élément essentiel. Il s’entend à merveille pour définir ses personnages par le biais de la langue qu’ils parlent. Il explore par la musique le psychisme de ses personnages, sans jamais glisser dans l’explicite démonstratif. Boris Godounov est le premier opéra peut-être dans lequel ce n’est pas la voix et sa prouesse qui font le rôle, mais la personnalité. Reconnaissons à Alexandre Roslavets que pour une prise de rôle, c’est une performance. Un rôle pareil se cultive aussi d’une production à l’autre, surtout quand le matériau est présent, et gageons que ce Boris sera capable du murmure hanté comme du tonnerre. Et merci à Olivier Py d’avoir libéré le personnage de son imagerie et de sa gesticulation aussi, de l’avoir en somme intériorisé.

Boris Godounov / Opéra national du Capitole © Mirco Cosimo Magliocca
Quant au choix de la version en question, Rimski-Korsakov aurait-il chuchoté à l’oreille de Christophe Ghristi ces quelques mots ? « Lorsque viendra le moment où l’original apparaîtra comme meilleur ou plus important que ma révision, l’on rejettera ma version pour jouer Boris d’après la partition originale. »

Boris Godounov / Opéra national du Capitole © Mirco Cosimo Magliocca