
A l’occasion de sa venue sur Toulouse, où il a présenté son premier film Titicut Follies et son dernier Ex Libris : The New York Public Library, Frederick Wiseman a aussi rempli la salle Raymond Borde de la Cinémathèque de Toulouse, lors d’une rencontre lançant son nouveau festival Histoires de cinéma. Et avant de discuter avec le public toulousain, il a accepté de répondre à mes questions.
Vos films s’écrivent au montage. Est-ce arrivé qu’un moment qui vous a plu au tournage n’y trouve pas sa place ?
Il y a toujours des moments qui me plaisent au tournage, mais malgré cela, je n’ai aucune idée de l’endroit où je vais les mettre dans le film car je n’ai aucune idée de la structure du film avant d’avoir vu tous les rushes, et surtout d’avoir monté individuellement toutes les séquences que je pense utiliser. Je ne peux penser à la structure que de façon abstraite. Il faut que je vois la conséquence si je commence par une scène ou une autre, quelle est la relation entre la première et la deuxième séquence, la relation entre la première et la dernière. Mon travail consiste à faire le meilleur film en termes de trame narrative à partir de toutes ces séquences. Comme je fais le montage sans point de vue idéologique, la structure est la dernière chose qui arrive. Dans tous les films, il y a deux voies. La voie littérale est ce qu’il se passe, quels sont les mots, comment sont les vêtements, et la voie abstraite regroupe les idées plus générales qui sont suggérées par les gens. Le vrai film est le croisement des deux. Autour de la poésie et de l’histoire des personnes afro-américaines, comme vous l’avez en effet souligné dans votre article, il y a d’autres idées, dont vous avez aussi parlées, qui sont le contraire de Trump.
Donc, une fois vos rushes montés, comment faites-vous concrètement pour les organiser ? Par exemple avec des post-it que vous repositionnez sur un tableau ?…
Pas du tout. Pendant le montage, tout est dans ma tête. Je nomme les séquences « bureau du chef », « débat sur le racisme », « couloir » et je rentre ces noms sur l’ordinateur. Quand je commence à chercher la structure, je fais toujours un ordre, même provisoire, à l’écrit. Écrire m’aide à structurer. Pour Ex Libris, j’ai monté pendant huit mois les séquences individuelles qui sont alors dans une forme presque finale. J’ai donc une très bonne connaissance des séquences, je peux donc faire des changements assez vite. Le premier assemblage de séquences s’est fait très rapidement, en trois ou quatre jours, mais après ces huit mois de montage. Cette première structure est généralement trente à quarante minutes plus longue que la version définitive. Huit semaines ont été nécessaires pour trouver le rythme à l’intérieur d’une séquence et le rythme entre elles. Les romans que je lis m’aident beaucoup pour trouver le rythme, plus que des films. Je joue beaucoup avec l’ordre à ce moment-là. Et après cet assemblage que je crois être définitif, je revois tous les rushes, pour être sûr de n’avoir rien manqué. Donc pour répondre à votre question précédente, non (rires).
Avez-vous besoin d’un regard extérieur à qui vous montrez votre montage ?
Non, jamais. ça m’embrouille. Depuis que j’ai commencé à monter en numérique, j’ai un assistant pour les derniers trois ou quatre mois, mais c’est moi qui monte. J’ai essayé ça pour mon premier film, peut-être le deuxième, mais après jamais. Cela ne m’aide pas, parce que je trouve toujours que l’autre a raison, et je veux que ça reste en circulation dans ma tête. Personne n’a une connaissance des rushes comme moi, et n’a aucune idée des choix à faire. Ce n’est pas le cas pour tout le monde, mais c’est la meilleure façon pour moi.
Comme vous trouvez la structure au montage, quelle est votre préparation avant le tournage ?
Je ne fais aucune recherche. Pour Ex Libris, par exemple, j’ai passé une demi-journée à la bibliothèque centrale à la 46ème rue. Une après-midi, j’ai visité trois des antennes annexes. C’est tout, et deux mois après j’ai commencé le tournage. Pour moi, le tournage est le repérage, parce que rien n’est mis en scène, c’est très lié aux choses que je tourne par hasard et on doit être prêt pour tourner très vite. Pour Ex Libris, par exemple, on m’a envoyé la liste de tous les événements, la venue d’Elvis Costello ou les concerts dans les annexes.

Ça me donne une idée des choses spéciales qui passent. Pour les choses quotidiennes, j’arrive et je prends le risque. Mon modèle, c’est Monte Carlo, le casino : on prend le risque de prendre le pari. Si on y arrive, on a gagné, c’est toujours comme ça. J’ai su que chaque mercredi à 9h00 il y avait une réunion des chefs. J’ai demandé à venir, on m’a dit oui, et chaque mercredi où j’étais là, j’ai pu assister à cette réunion. Mais je n’avais aucune idée en amont de leur agenda. Je filme les réunions et j’espère trouver quelque chose que je peux utiliser. Mais même après cette réunion, je ne suis pas sûr si je vais l’utiliser, ni comment je vais l’utiliser parce que toutes les séquences dans le film sont réduites, même les plans de couloir sont beaucoup plus longs, je ne choisis qu’une petite partie. Les réunions durent 90 minutes, j’en utilise sept ou huit si je choisis de l’utiliser. Ce n’est pas huit minutes consécutives, c’est 30 secondes ici, 20 secondes là, réunies par le montage pour créer une certaine fiction. Je crée l’illusion que la réunion s’est passée comme ça, mais ce n’est pas vrai. C’est un exemple de l’aspect fictionnel, et de la structure fictionnelle : je peux commencer le film par une séquence tournée le dernier jour, et le terminer par une séquence tournée le premier jour. Mais je ne joue pas avec la chronologie à l’intérieur des séquences, je ne commence pas une séquence avec quelque chose passée à la fin.
Raymond Depardon disait que pour 12 jours (entretien à venir), il a aussi réduit à l’écran les entretiens qui sont en vrai beaucoup plus longs.
Le montage n’est pas réussi si vous le voyez. Il faut donner l’illusion que 20 secondes se soient passées comme dans le film, même si ce n’est pas vrai.
Quelles sont les retours des New-Yorkais sur Ex Libris ?
Il est sorti à New York il y a sept semaines. Les critiques sont bonnes, je suis allé deux fois en salle parler avec les spectateurs comme ici. Ceux qui me parlent sont ceux qui aiment le film, ceux qui ne parlent pas je ne sais pas s’ils aiment (rires). Je ne suis pas un expert en bibliothèques américaines, mais je sais que c’est la même chose à Boston, Chicago, San Francisco… La New York Public Library est un endroit où les personnes font un travail intéressant, et aident les autres. Il y a beaucoup de gens comme ça, c’est le bon côté de l’Amérique. Toute l’Amérique n’est pas comme ce que voudrait Trump, heureusement.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus ?
J’aime le tournage et le montage, mais pour des raisons différentes. Ce que je n’aime pas du tout, c’est chercher l’argent, ça, c’est plus emmerdant. Le tournage est très intensif, très sportif, très instinctif et le montage plus intellectuel, c’est une combinaison des éléments rationnels et irrationnels. C’est plus une étude, je peux voir une séquence 20 fois pour trouver le moyen de le couper. Alors que trouver les financements, c’est très difficile, encore plus maintenant qu’au début car il y a davantage de gens qui demandent l’argent alors qu’il y en a moins, en Amérique. Beaucoup de gens pensent que c’est facile pour moi car j’ai fait beaucoup de films, mais il y a 25 ans c’était beaucoup plus facile. Mais en cherchant, j’y arrive.
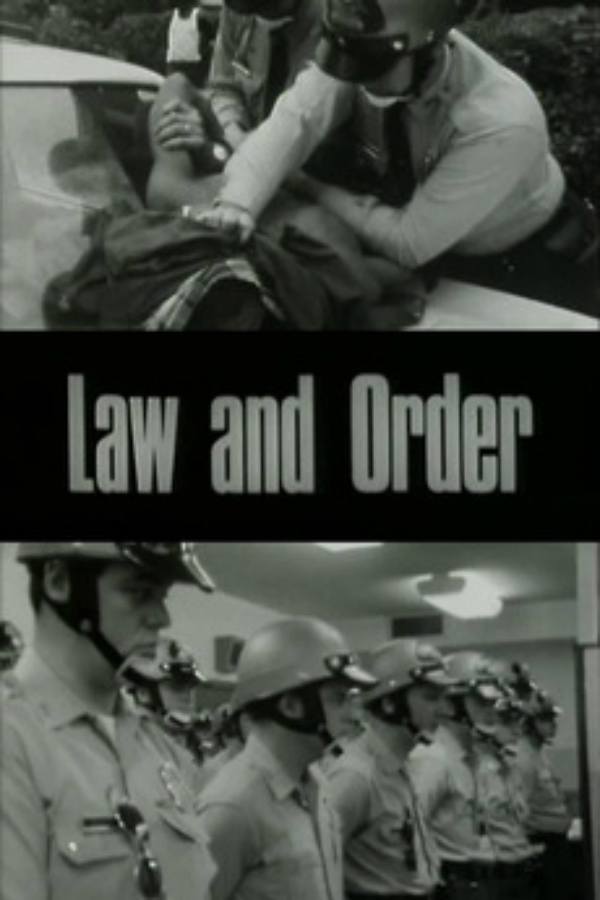 Tous vos projets se sont-ils concrétisés ?
Tous vos projets se sont-ils concrétisés ?
Oui, en 1968 j’ai commencé à tourner le film qui est devenu Law and Order, c’était à Los Angeles. Mais après une semaine à Los Angeles, on m’a dit que je pouvais faire tout ce que je voulais sauf aller dans les voitures, et comme il n’y avait pas les policiers qui marchent dans la rue à l’époque, ça détruisait complètement l’idée du film. Je suis allé à Kansas City Missouri où le chef me donnait une permission de faire tout ce que je voulais. C’est la seule fois que j’ai eu un tel problème.
Comment vous viennent les idées de films ?
Aucune idée (rires). Je vous donne un exemple : j’étais chez le dentiste il y a presque 30 ans et j’ai lu dans People Magazine quelque chose autour d’une agence de mannequins. Je me disais que c’était intéressant, j’avais le bon âge pour tourner parmi les mannequins. J’ai téléphoné à leur bureau et j’ai fait le film. Ça c’est l’exemple le plus extrême, le plus drôle. C’est toujours un peu comme ça. A la fin d’un montage, j’ai toujours besoin de penser au prochain film. Durant celui de In Jackson Heights, j’ai pensé « Pourquoi pas une bibliothèque ? ». Comme la bibliothèque de New York est l’une des trois plus grandes du monde, j’ai contacté Tony Marx que vous voyez dans le film, c’est le président. Je suis allé le voir et il a tout de suite dit oui. J’ai été étonné. Mon grand secret à vrai dire, c’est que je demande la permission. En général c’est très très facile en Amérique de l’obtenir. Il n’y a eu qu’une ou deux fois que c’était compliqué. J’envoie simplement une lettre ou je téléphone pour demander un rendez-vous où j’explique ce que je veux faire. La plupart dise oui tout de suite. C’est très bien pour moi, pas toujours pour eux, mais en général ça va (rires).
Vous connaissez déjà le sujet de votre prochain film ?
Oui, mais je n’aime pas en parler. Je suis superstitieux. Mais je peux vous dire qu’il se déroulera en Amérique (rires).
Lire aussi la chronique de Carine Trenteun sur Ex Libris : The New York Public Library.
Merci à Jérémy et Annie de l’American Cosmograh de Toulouse, le plus vieux cinéma du futur ! et à la Cinémathèque de Toulouse, qui ont rendu cette rencontre possible.
