Il faut lire Les Inattendus, oublier son étiquette de ‘roman’ qui annonce le déroulé d’un récit bien charnu, piqué de coups de théâtre sur la perspective fuyante d’une tragédie existentielle. Et pourtant, à lire et à relire Les Inattendus, sans y détecter aucun de ces ingrédients ou issues convenues, on ressort irradié d’une indéniable conviction existentielle.

J’arrive à cet ouvrage en suivant un petit fil d’Ariane étrange, comme au sortir d’un songe, une dérive lente, un mouvement infime comme pour me rattraper du vertige initié à la vue d’une photographie. Une image peut capter de la sorte : on s’y plonge, elle magnétise le regardeur, le décalage se forme et il vous happe. Quelque chose, une personne, me parle, résonne, et je la suis dans l’interstice. Voilà tout. D’Eva Kristina Mindszenti je suis la trace d’encre de chine jusqu’à cette goutte venue tracer quelques signes sur le papier d’un livre. Un livre ayant vécu sa vie de livre, honorable : édité (Stock 2007), étiqueté (Roman), couronné (Prix Anna de Noailles de l’Académie Française), célébré (sans doute) et aujourd’hui épuisé.
Peut-on spéculer sur une étoile filante ? Car c’est ainsi que le web – le bouquiniste du 21e siècle – traite Les Inattendus : des occasions variant de 0.90 cents (« Tu ne vaux rien, étoile morte ») à près de 60€ (« Tu es star, tu es rare, tu seras chère »).
Qu’y a-t-il à comprendre ?
Rien. Il faut seulement lire Les Inattendus.
Dans ma lecture, les éléments factuels identifiés peinent à ébaucher une histoire. Les voici tout de même : la Hongrie – tendue entre ses archaïsmes et la chute du Mur toute proche, l’hôpital-mouroir pour des « enfants-Tchernobyl », et la traversée de ces étendues glaciales par une jeune femme au plus près de ses instincts. Il n’y a rien à raconter. Il n’y a qu’à la suivre, elle : attirée, révulsée, attendrie, drôle, dévastée, réconfortée par la force de son seul amour : le poète qui murmure.
Cette lecture surprenante se vit à même la peau, comme l’expérience de l’eau fraîche dans le torrent d’altitude commence par engourdir, puis force à réagir : s’agiter, nager, s’adapter à un nouvel état sensoriel. On peut être déboussolé un moment par l’absence du moteur romanesque. Le récit, pauvre comme son décor, ne fait qu’aligner les gestes de la trivialité du quotidien, les émotions brutes, et les phrases qui fusent avec l’amertume d’un aveugle-sourd privé de lire son passé, rendu à son seul instinct pour franchir chaque minute de sa vie.

La clé de cette expérience c’est de l’aborder comme une méditation. Oublier ce travers humain de l’interprétation, de la surcouche conceptuelle, ne pas chercher à se raccrocher à un quelconque signal gps : on se fiche bien de là où on va.
La clé c’est de ne pas lâcher le fil du verbe, de coller à la musique des mots, à la respiration qui s’installe par la scansion des phrases courtes. Aux mots coupés. Aux mots répétés. Aux chuchotements. Aux minuscules incantations qu’on s’administre quand on marche seul, depuis longtemps. Eva Kristina Mindszenti marche-t-elle depuis longtemps ? Que traverse-t-elle ou s’apprête-t-elle à traverser ? Nul besoin de le savoir : c’est son expérience qui nous rend la nôtre. Avec la fausse froideur des minutes d’un procès, Les Inattendus donne voix à ce récit des instants de pure solitude dans le bruit du monde.
C’est un récit puissant, initiatique, celui qui parvient par ce chemin émotionnel à rétablir que la conscience de l’instant est le socle de la compréhension existentielle. C’est le cadeau du livre, que de nous rendre cette conviction apaisée, c’est comme recevoir l’amour d’un poète.
Le poète murmure. Je l’entends. János Arany m’aime. Ses livres existent pour sauver des gens comme moi. Son existence a trouvé sa destination. (…) Un poète n’est pas un intellectuel. Il creuse. C’est son métier. Son front perle de sueur. Il n’est pas insensible aux changements climatiques. Il creuse, dans cette canicule, il creuse, au cœur d’une ère glaciaire. Le ciel est terne. Il creuse encore, et, sous la pluie, excave, enfin, un sentiment abîmé. Il s’arrête de creuser. Il a trouvé. Le silence est parfait. Plus rien d’autre ne compte. Le poète recueille le sentiment avec délicatesse. Muni d’un canif, il le nettoie. Un poète est avant tout un homme habile de ses mains. A la fin du travail, le sentiment retentit de sa splendeur initiale. Comme au premier jour. Les poumons brûlent, la lumière éblouit. Il grelotte. Très vite, un nom lui est donné. Le sentiment est né. Il est terrifiant. Un géant qui ne maîtrise pas sa force. Son exubérance trahit le repos ambiant. Il faut l’abîmer de nouveau, il faut l’enterrer. Le mettre hors d’état de nuire. Les poètes n’auront jamais fini de creuser. D’excaver des sentiments, forcément insupportables. Un sentiment n’est pas naturel. Ressentir n’est pas aisé. C’est un travail pénible. Le poète le sait. C’est pourquoi il distille nos émotions dans des livres. Si je n’avais pas lu je serais froide, je serais vide. Je serais, je le sais, vide de sens. János Arany, tu veilles. Grâce à toi, je suis sauve.
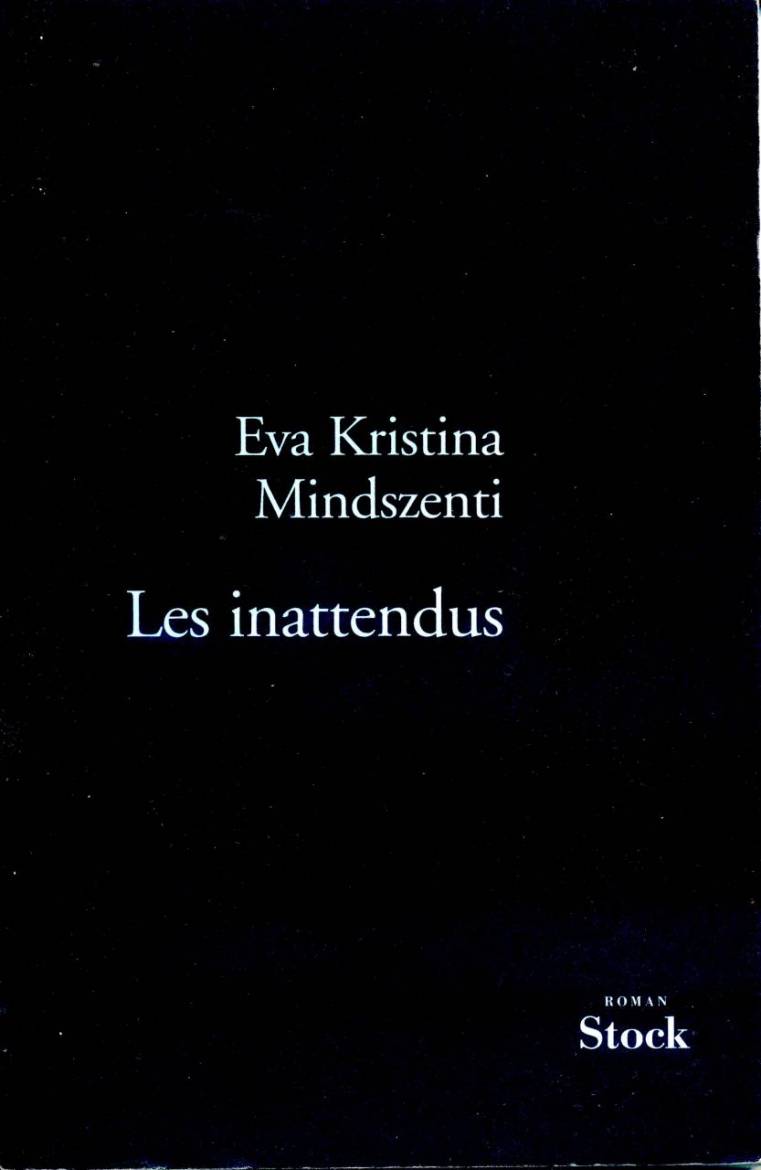
Pierre David
Un article du blog La Maison Jaune
